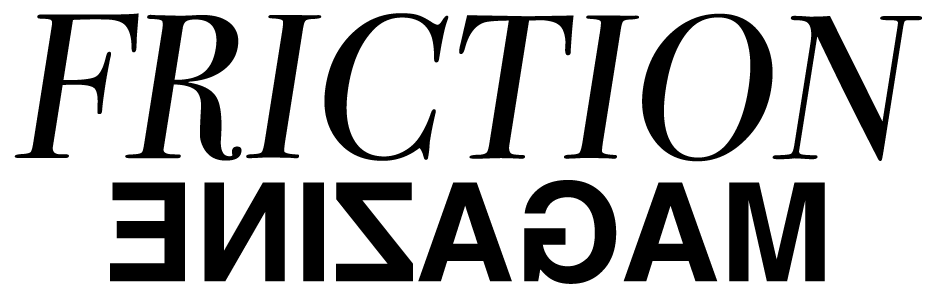Dans un contexte où l’engagement militant est à la fois plus nécessaire que jamais et parfois source d’épuisement, nous avons souhaité échanger avec Sarah Durieux à l’occasion de la sortie de Militer à tout prix aux éditions Hors d’atteinte. Sans prétendre détenir toutes les réponses, elle propose une réflexion salutaire sur nos manières de lutter, de nous organiser et de prendre soin de nous-mêmes et des autres. Entre convictions profondes et questionnements honnêtes, elle explore les tensions qui traversent les collectifs militants et partage des pistes pour inventer des formes d’action plus justes, plus inclusives et plus durables.
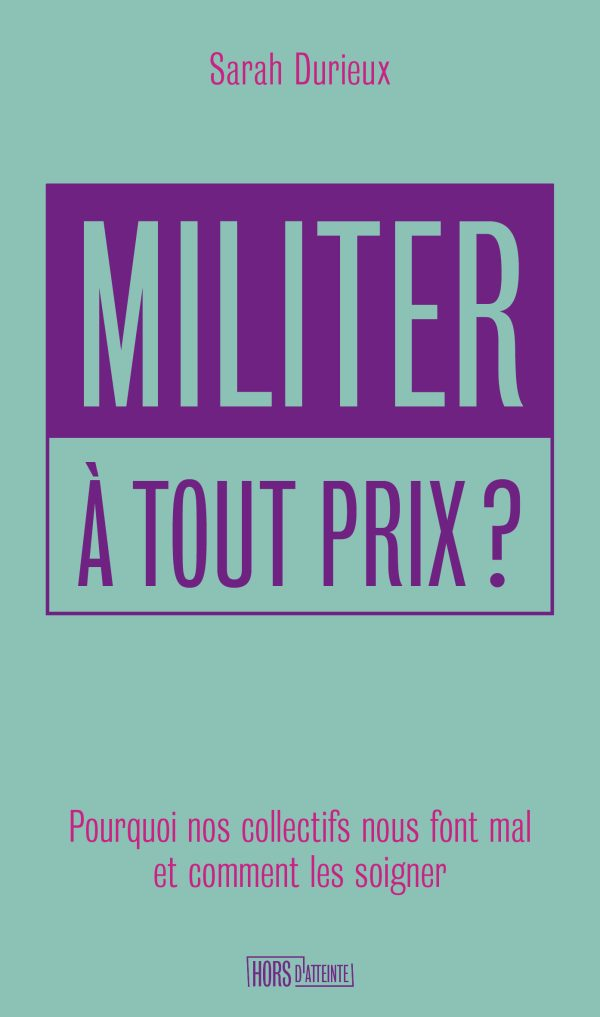
Pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs et lectrices : quel a été votre parcours, et comment en êtes-vous venue à interroger le militantisme ?
Je suis militante féministe, activiste et organisatrice. Je ne suis pas issue d’une famille engagée politiquement dans des partis ou des syndicats ou associations, et j’ai commencé moi même ma politisation assez tard. J’ai grandi un environnement familial où la violence patriarcale était présente, mais aussi avec l’héritage traumatique de mon grand père, homme juif polonais qui a échappé à la Shoah, ce qui n’a pas été le cas d’autres membres de notre famille. Ma politisation a été le résultat de mon travail notamment chez Change.org où j’accompagnais des personnes directement concernées par des problématiques qu’elles politisaient rarement et qui lançaient des pétitions comme dernier ressors. J’ai donc appris au contact de ces personnes mais aussi d’autres acteurices du mouvement social qui soutenaient ces mobilisations : associations, syndicats, partis politiques. Cette posture à la croisée de mondes militants différents, celleux qui se revendiquent comme tels et celleux qu’on peut appeler les « néo-militant•es » m’a beaucoup appris. Après une quinzaine d’années à évoluer dans ces milieux, j’ai ressenti une forme de malaise, d’abord parce que je trouvais que nous avions une approche parfois antinomique avec les valeurs que l’on défendait, et qu’on reproduisait certains mécanismes de domination que nous dénoncions. J’en ai moi même fait l’expérience et cela m’a poussée à vouloir quitter ces espaces. C’est parce que je crois foncièrement que nous pouvons agir ensemble autrement que j’ai voulu écrire ce qui pour moi est à la fois une réflexion éthique sur nos manières de militer mais aussi une proposition stratégique pour permettre à plus de personnes de nous rejoindre pour développer leur autonomie politique et nos victoires collectives.
Votre livre s’intitule Militer à tout prix : quel « prix » pensez-vous que l’engagement militant demande aujourd’hui à celles et ceux qui s’y investissent ?
Nous militons trop souvent au prix de notre santé, de nos liens, de nos ressources mais aussi de nos victoires.
Militer peut être un merveilleux espace où l’on prend conscience de son propre pouvoir, où l’on peut trouver camaraderie, amour, soutien.
Mais cela reste beaucoup trop rare pour une grande partie des personnes qui s’engagent dans l’action politique.
La violence du système que nous combattons se répercute sur nous mêmes et nous reproduisons cette violence dans les espaces militants. Et cela nous coûte beaucoup en terme de santé : de nombreuses personnes s’épuisent littéralement, on parle de plus en plus de burn-out militant et plus généralement de dépression qui ne sont pas le seul fait du militantisme mais que le militantisme peut accélérer. Cela a un coût important sur nos capacités à faire solidarité, à reconnaître dans nos pairs des personnes qui peuvent nous comprendre, nous soutenir. Que nous pouvons être ensemble sans devoir continuellement se retrouver en position compétitive, ou à la recherche d’une pureté militante que l’on atteindra jamais, ou notre loyauté et notre engagement sont évalués au regard de notre productivité ou de notre visibilité.
Par extension cela a un prix sur nos capacités à remporter des victoires : des espaces militants qui ne sont pas accueillants génèrent de la mise en retrait et nos mouvements s’appauvrissent de personnes qui ont beaucoup à trouver et à donner pour nos luttes.
Vous montrez que même les collectifs militants peuvent reproduire des logiques de domination. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?
La culture de domination, qu’elle soit patriarcale, capitaliste, validiste ou de suprématie blanche c’est l’air qu’on respire. On ne peut y échapper que par une action résolue qui nécessite compréhension, curiosité et remise en question.
Malheureusement, pour beaucoup d’entre nous, militer contre ces dominations on en être victime supposerait que par définition nous ne pouvons le reproduire. C’est une de nos erreurs les plus néfaste. Personne n’est à l’abris de reproduire des comportements sexiste s’iel milite pour l’égalité des genre s’iel ne fait pas un travail réflectif sur ses pratiques.
De plus, la culture militante ne nous apprend pas à douter ou à nous remettre en question. Elle nous apprend à être convaincu•es que nous sommes dans le camp du bien et notre seul objectif est d’imposer notre vision. Il est donc d’autant plus difficile de considérer que nous puissions avoir des biais que nous devons corriger.
Enfin, comme dans tout groupe social, l’espace militant reproduit des hiérarchies sociales classiques qui par définition reproduisent de la domination.
Ce que j’essaie de discuter dans ce livre, ce sont les symptômes de cette culture de domination qui passent souvent pour quelque chose d’immuable et qui contribue à la mise à l’écart ou à la souffrance de certaines personnes qui militent : culture de l’hégémonie, valorisation du quantitatif ou de la transaction, culture de l’urgence qui emprunte au système capitaliste. Modèles hiérarchiques, binarité et survalorisation de la médiatisation qui emprunte aux systèmes patriarcaux et de suprématie blanche …
Ces modes d’organisation et ces modes de collaboration militants ne sont pas reconnus comme des outils de domination ce qui rend difficile leur évolution.
À partir de votre expérience, quels sont les signaux d’alerte d’un collectif qui commence à se fragiliser de l’intérieur ?
La fragilité d’un collectif se traduit généralement par trois types de réactions des membres d’un groupe : les conflits néfastes insolubles (c’est-à-dire qui vont au delà d’un conflit sain qui fait avancer le groupe), le désengagement de certaines personnes qui vont rester passives même si elles ne quittent pas le groupe provoquant la centralisation du pouvoir et de l’engagement entre les mains de quelques personnes, et le fait que des personnes quittent le groupe. Ce sont des réactions classiques dans tout espace collectif. On parle de « fight, fawn, flee » en anglais.
Lorsque ces dynamiques se mettent en place, c’est souvent le résultat d’une non prise en charge collective des dysfonctionnements dans le groupe : violences sexistes, classistes, racistes mais aussi désorganisation du travail, surcharge militante pour certaines personnes ou centralisation du pouvoir et manque de démocratie collective. C’est aussi souvent le résultat de la re-traumatisation de certaines personnes qui arrivent avec des traumatismes liés aux oppressions systémiques et qui n’ont pas la possibilité de trouver dans le groupe un espace de soin ou suffisamment sûr.
Dans des groupes avec une mixité sociale / raciale / de genre … la mise en retrait des personnes les plus marginalisées est un signal. Les personnes qui sont les plus victimes de violence hors espace militant vont très rapidement sortir des collectifs pour s’épargner.
Pourquoi est-il si difficile d’agir durablement et sainement en groupe, même quand l’objectif commun est émancipateur ?
Tout comme le marché libre ne peut répondre aux enjeux de redistribution des richesses dans la culture capitaliste, le travail militant ne peut générer de pouvoir collectif si aucune régulation n’est mise en place. Le problème est que beaucoup de collectifs ne font pas ce travail et ne réfléchissent pas leurs modes d’organisation.
Une grande partie des personnes qui militent arrivent avec de multiples traumatismes et espèrent parfois trouver dans l’espace militant un lieu d’expression, de reprise de pouvoir et de contrôle sur sa vie. Cela peut donc se traduire par des dynamiques d’accaparement, de recherche de reconnaissance, de mise en compétition.
D’autre part, en utilisant des modes d’organisation inspirés de la culture patriarcale (hiérarchiques, centrés sur la productivité et la visibilité etc) on contribue à affaiblir nos ressources collectives et individuelles sur le long terme.
Dans Militer à tout prix, vous proposez des pistes pour sortir de ces logiques destructrices. Quelle serait, selon vous, la première étape essentielle ?
Commencer par adopter deux postures fondamentales, à titre individuel et collectif : la curiosité et l’humilité. Si l’on est capable de chercher à comprendre les personnes qui militent avec nous, nous aurons beaucoup plus de facilités à trouver des moyens d’actions qui sont inclusives, nous pouvons limiter les violences systémiques qu’on peut reproduire sans le réaliser, et nous avons aussi la possibilité d’être plus efficace en cherchant à résoudre les conflits plutôt que d’avoir raison.
Il est aussi fondamental, lorsque l’on crée un collectif, ou si l’on décide de travailler sur un mode d’organisation plus sain, de définir collectivement la stratégie du groupe afin de bien définir ses objectifs en fonction des ressources dont on dispose, afin de limiter la surcharge de travail et d’éviter d’être sans arrêt de la réaction.
Enfin, parler ouvertement des différents rôles dans le groupe, décider ensemble de qui fait quoi pour éviter la reproduction des exclusions de personnes en fonction de leur capital social, culturel, de leur classe, race ou genre.
Vous avez mené de nombreux entretiens pour cet ouvrage : y a-t-il un témoignage qui vous a particulièrement marquée ou transformée ?
15 personnes ont accepté de répondre en leur nom et j’en suis très reconnaissante. Parler de ces questions n’est pas facile car on est souvent accusé de nuire à la cause, mais aussi parce qu’on considère encore aujourd’hui que poser la question du bien-être militant est annexe ou que cela serait égocentrique d’en parler.
J’ai aussi été très touchée par les dizaines de conversations que j’ai eues avec des personnes qui n’ont pas osé prendre la parole publiquement. Il y a de véritables histoires de souffrance et de déception militante qui ont besoin d’être entendues. Le témoignage d’une personne m’expliquant qu’elle a arrêté de militer parce qu’elle a vécu plusieurs harcèlements en ligne m’a particulièrement touché car je pense que c’est une stratégie classique qu’utilisent les mouvements autoritaires pour faire taire leurs opposants. Et cela m’attriste énormément que ce genre de méthodes puisse être adopté par des personnes de notre camp politique.
À titre personnel, comment avez-vous pris conscience de vos propres comportements problématiques, et comment travaillez-vous dessus aujourd’hui ?
Ma prise de conscience s’est faite à mesure que j’ai perdu confiance en ma capacité à faire partie du groupe. J’ai toujours été « au service » de groupes militants que j’accompagnais chez Change.org. J’avais une place claire et définie dans cette galaxie militante. Lorsque j’ai quitté ce travail, j’ai ressenti très fort la culture de la compétition dans cet espace. Parce que pour beaucoup de personnes, comme moi, militer permet de réparer nos traumatismes, en l’occurrence pour moi un sentiment d’effacement et d’illégitimité liées aux VSS que j’ai vécues. On est donc prêtes à beaucoup pour garder ce sentiment qu’on a du pouvoir. J’ai réalisé que je reproduisais ce que je déplorais chez les autres pour pouvoir rester la tête hors de l’eau.
Aujourd’hui je fais preuve d’autant plus d’humilité que je sais que je suis capable de reproduire ces comportements lorsque je suis mise en danger. Je vois pointer ces réactions en moi. J’essaye d’en parler le plus possible pour faire perdre son efficacité à la fable que je me raconte que je n’aurais de valeurs que si je produis, tout le temps, que je me met au service des autres même s’ils me traitent mal, que je refuse de prioriser le soin pour prouver que je suis radicale.
En 2025, avec l’urgence écologique, les tensions politiques et sociales, comment voyez-vous évoluer les formes de militantisme ?
Je pense que notre culture militante n’a pas beaucoup changé depuis 1789 ! Il est temps d’imaginer un autre mode de militantisme, qui n’emprunte plus à la culture masculiniste, viriliste, qui valorise le militantisme quand il nous fait mal. Le monde autour de nous est suffisamment violent. Nous pouvons faire du militantisme un espace où l’on retrouve de la force en travaillant sur des changements concrets qu’on peut produire dans nos vies, plutôt que de rester dans une posture cynique et souvent théorique de la politique.
La fascisme est à nos portes et il est donc indispensable de travailler à faire de nos espaces militants des endroits où l’on construit des solidarités puissantes et durables. Il faut que nous passions de la recherche de l’hégémonie politique pour notre collectif a une stratégie d’interdépendance entre une myriade de collectifs plus fluide et donc plus résistants aux attaques, mais pour cela nous devons nous faire confiance, et la confiance, cela ne se décrète pas, cela se travaille.
Pensez-vous qu’un nouveau rapport au collectif est en train d’émerger chez les jeunes militant·es, notamment sur les questions d’inclusivité et de durabilité des luttes ?
Les militant•es les plus jeunes bénéficient d’une avance considérable sur la génération précédente. Les outils d’organisation collective sont plus divers, le numérique nous permet de nous connecter plus rapidement et plus largement. Mais nous ne devons pas oublier le travail de terrain pour éviter de rester entre personnes convaincues et aller chercher celleux qui ne sont pas encore avec nous.
Le rapport au collectif peut aussi souvent être peu développé, notamment avec une individualisation des luttes par la figure militante sur les réseaux sociaux, déconnectés de collectifs se personnes concernées.
Quelles stratégies ou postures individuelles vous semblent essentielles pour continuer à militer sans s’épuiser dans les années à venir ?
Nous devons être plus stratégiques pour investir notre temps dans les actions qui servent nos objectifs. Le cœur du modèle autoritaire et réactionnaire consiste à nous obliger à réagir sur des sujets auxquels on s’oppose, plutôt que d’imposer nos messages et nos priorités.
Cela nécessite une discipline qui n’est pas toujours facile à gérer tant les attaques sont violentes et s’attaquent à notre dignité.
A titre individuel, il est indispensable de se poser la question de pour quoi on milite. Qu’est ce que l’on recherche. Être clair sur la différence entre la nécessité et la recherche de réparation, non pas pour juger ce qu’il serait bien ou mal de faire, mais pour comprendre nos réactions et faire le tri pour prioriser là ou mettre notre énergie : tenter de prendre une place ou en faire aux autres ? Faire en sorte de renforcer nos luttes ou uniquement son collectif ? Ce sont des questions que nous devons sans cesse nous poser.
Plus largement, penser à la fois notre éthique militante (renforcer le soin et la compréhension plus que la guerre et le rejet) et nos modes d’organisation sont indispensable pour durer.
Si vous pouviez transmettre un message aux futures générations militantes, quel conseil leur donneriez-vous pour construire des collectifs plus justes ?
Prenez le temps. Souvent, on veut se lancer vite, passer à l’action immédiatement. Mais les collectifs les plus solides sont ceux dans lesquels on a compris qu’il n’y a pas de collectif sans individus, et que les liens entre ces individus sont le carburant le plus efficace pour construire du pouvoir.
Commencez par vous connaître, par comprendre ce qui vous rapproche, pour que vos luttes soient ancrées dans vos histoire et vos valeurs avant tout.