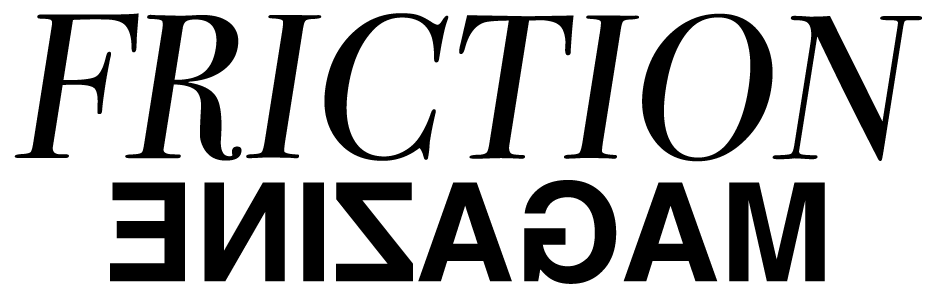« Il était une autre fois…» C’est par cette légère mais décisive torsion de la célèbre formule que s’ouvre Il était une autre fois de Mathilde Forget illustré par Célia Housset. Une variation presque discrète, mais qui dit tout : ici, on ne racontera pas les contes comme on les a toujours entendus. Ici, on réinvente. Mathilde Forget s’inscrit dans une tradition très ancienne, celle de la réécriture (propre aux contes eux-mêmes) mais elle en revendique une version actuelle, engagée, queer et féministe. Sous sa plume, les figures archétypales vacillent : les fins heureuses ne passent plus forcément par le mariage, les rôles de genre sont remis en jeu, et les enfants, loin d’être tenus à l’écart des questions sérieuses, sont pris au sérieux. Ce recueil est un espace de métamorphose, où l’on parle d’identité, de secret, de liberté, de lutte des classes même, avec poésie, humour et sens du récit. Dans cet entretien, l’autrice revient sur la genèse de ce projet, son lien très intime à l’enfance, ses inspirations revendiquées ou inattendues, et sa conviction profonde : les histoires ont le pouvoir de donner forme à d’autres possibles.
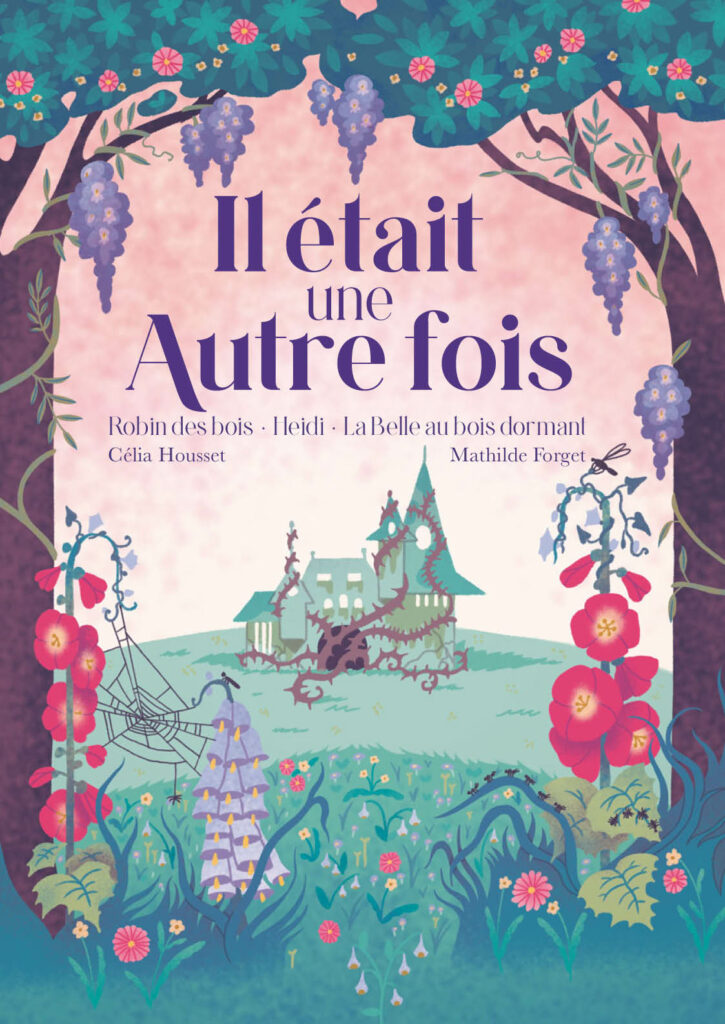
Le livre s’ouvre sur une inversion du célèbre « Il était une fois » : pourquoi ce choix de titre, Il était une autre fois ? Qu’as-tu voulu signifier par cette variation ?
Mathilde Forget : C’est Anne-Fleur Multon, l’autrice du premier tome, qui a trouvé ce titre et je le trouve très bien. J’aime l’idée de partir de la célèbre phrase d’ouverture des contes classiques en la détournant légèrement afin d’annoncer l’exercice de réécriture. C’est un beau titre pour parler de l’importance d’inventer de nouvelles fictions, de nouvelles représentations à partir d’anciennes encore très ancrées dans notre société actuelle.
Tu réécris des contes connus en bousculant les stéréotypes de genre, les normes sociales ou les fins attendues. Qu’est-ce qui t’a donné envie de t’emparer de ces histoires, souvent très codées, pour les tordre ?
J’ai d’abord répondu à une commande. Les éditions On ne compte pas pour du beurre m’ont proposé de réécrire trois contes célèbres en les rendant plus queer et féministe. Avant toute chose, je me suis demandée si j’étais capable d’écrire pour la littérature jeunesse, c’est une littérature que j’estime beaucoup et c’était ma première expérience. J’ai eu peur de ne pas être à la hauteur mais je me suis souvenue que mes premiers textes, ceux écrits pour mon premier roman, étaient très ancrés dans un imaginaire de l’enfance. Cela m’était presque reproché. Alors j’ai dit oui. J’ai décidé de ne pas adapter mon écriture, ma langue, sous prétexte que je m’adressais à des enfants. En revanche, j’ai travaillé davantage mes arcs narratifs, car l’histoire et ses rebondissements sont une grande partie du plaisir de lecture chez les enfants. Ensuite, je me suis amusée. Car je pense que s‘il y a du plaisir au moment de l’écriture, il peut y en avoir ensuite pour le lecteur. J’ai donc choisi des contes dont les univers, les personnages etc … me permettaient à la fois de développer une certaine poésie, et des enjeux plus politiques.
Quel regard portes-tu sur les contes traditionnels (et la lecture qu’en a fait Disney…) : peut-on encore les lire aujourd’hui ?
En les reparcourant pour Il était une autre fois, j’ai pris conscience de la dureté de certains, comme La petite fille aux allumettes. Ces contes sont souvent terribles. Je pense bien sûr qu’on peut continuer à les lire, mais c’est vrai que tout ce qui se passe autour de la réécriture, des réinterprétations de ces contes est vraiment intéressant et réjouissant.
Concernant les films Disney, j’en regardais beaucoup enfant. Je garde un très bon souvenir de La Belle et la Bête par exemple que je visionnais en boucle. Je me savais lesbienne très jeune et je n’avais aucune représentation, je me demandais même si cela existait, alors les personnages féériques, le personnage de la bête par exemple, me permettaient de m’identifier, de penser mon existence possible.
Le genre du conte est très lié à la tradition orale et à l’idée même de réécriture. Est-ce qu’en écrivant ce livre tu l’as pensé comme inscrit dans cette tradition et cette histoire générique ou au contraire tu revendiques une rupture nette ?
Je ne l’ai pas pensé comme une rupture. Car dès le départ, je voulais garder certains codes et structures. C’est cela qui m’intéressait, poursuivre l’exercice de réécriture à l’origine des contes traditionnels.
Est-ce que le livre Contes d’un autre bois de Mélie Boltz Nasr a influencé ton travail de réécriture ?
Je ne connais pas ce livre, je vais regarder ! Ce qui m’a le plus inspirée c’est mon rapport à l’enfance, et mon expérience de petite lesbienne. Je voulais m’adresser aux enfants en priorité.
Ce recueil s’adresse à un jeune public, mais il parle de sujets très forts : identité, liberté, transformation.
Comment as-tu trouvé le bon ton pour ne pas édulcorer, tout en restant accessible aux enfants ? En fin de compte, les contes sont-ils vraiment des récits pour les enfants ?
La violence et les questions philosophiques font partie de la vie des enfants, je ne suis donc pas certaine que cela soit intéressant pour eux de les effacer des récits. En revanche, il faut les accompagner en donnant de l’importance à l’espoir, le faire exister. C’est à cela que j’ai pensé.
Quel est le conte que tu as préféré réécrire, ou celui qui t’a le plus surprise dans sa réinvention ? Et pourquoi ?
J’ai peut-être préféré la réécriture de « Robin des bois », cela me plaisait une histoire sur la lutte des classes adressée aux enfants. Mais c’est « La belle au bois dormant » qui m’a le plus étonnée, car je me suis rendu compte que les parents de la belle préfèrent faire détruire tous les fuseaux du royaume que de lui raconter son histoire. C’est aussi un conte sur le secret dans les familles et cette idée qu’il protège les enfants, ce qui est faux à mon sens. Cette idée que tout peut se faire en dehors d’eux, même quand cela les concerne de si près.
Si tu pouvais glisser un petit mot aux enfants (et adultes !) qui vont lire ce recueil, qu’aimerais-tu leur dire ?
D’aller découvrir les contes de Madame de Murat ! Elle a, avec d’autres autrices, inventé au XVIIème la forme littéraire du conte, dans un geste littéraire et politique très queer.
Il était une autre fois, Mathilde Forget & Célia Housset, On ne compte pas pour du beurre