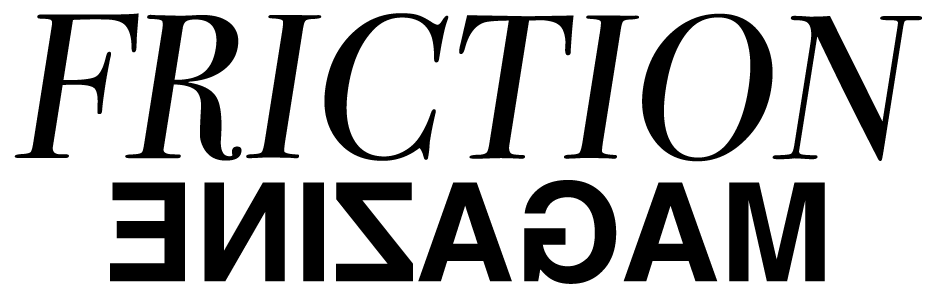On avait découvert Itziar Ziga avec Devenir Chienne, grosse claque dans la face du patriarcat sous forme de manifeste féministe radical et jubilatoire qui célèbrait une féminité débridée, indocile et viscéralement subversive. Cette année, les éditions Cambourakis dévoilent L’heureuse et violente vie de Maribel Ziga, un hommage incandescent à la mère d’Itziar Ziga, figure indomptable et révolutionnaire. À travers ce récit, l’autrice esquisse le portrait d’une femme libre, excessive et insoumise, qui a traversé la vie avec une intensité rare, entre joies féroces et luttes viscérales.
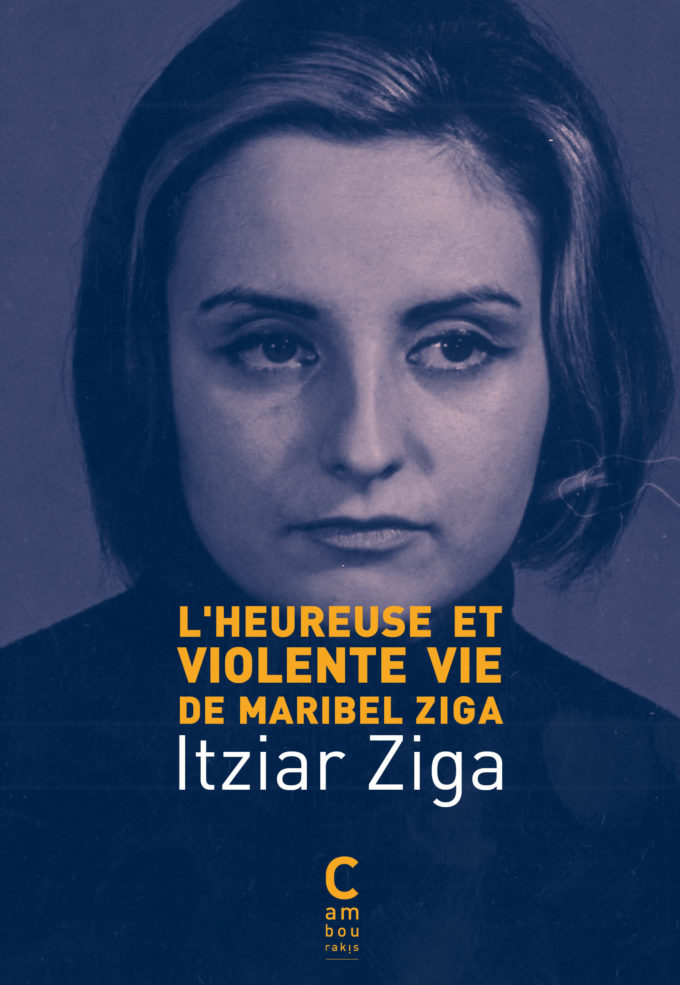
Si ce récit n’a pas la même flamboyance que Devenir Chienne, il dessine des lignes de force politiques avec à la fois une grande honnêteté et une douce pudeur. La vie de Maribel Ziga n’est finalement pas si exceptionnelle. Ce récit est celui d’une femme battue, exploitée par le patriarcat et la société franquiste dans laquelle elle a grandi. La beauté du récit d’Itziar Ziga est justement de ne pas en faire une figure d’exception et l’histoire de cette mère est l’histoire de centaines de milliers de femmes qui subissent la domination masculine. Et c’est bien parce qu’elle est tristement banale que cet ouvrage est lumineux. Avec un sens de la formule qui permet de capter de façon toujours juste ce qui se joue derrière les violences subies par l’une, l’autrice parvient à tracer en filigrane les contours d’un manifeste politique.
Maribel Ziga n’est pas une héroïne flamboyante échappant aux normes, mais une femme comme tant d’autres, prise dans l’engrenage des dominations masculines, amoureuse d’hommes qui la détruisent, contrainte d’accepter ce que la société lui laisse comme espace de survie. Pourtant, ce récit n’est ni misérabiliste ni résigné : en racontant cette vie faite d’ambivalences, entre éclats de joie et violences subies, Itziar Ziga met en lumière la banalité tragique de la condition féminine et souligne que la révolte ne se joue pas uniquement dans les parcours d’exception, mais aussi dans ces existences marquées par la soumission et la résistance diffuse. Ce n’est pas Maribel elle-même qui incarne une libération, mais le regard que sa fille porte sur elle, et la manière dont son parcours permet d’articuler une critique plus large du patriarcat.
Le livre ne se contente pas d’un témoignage intime : il trace des lignes de lutte collective en ancrant l’émancipation des femmes dans la solidarité plutôt que dans une illusion d’indépendance individuelle. Maribel Ziga n’a pas pu se libérer seule, et c’est précisément ce constat qui donne une portée politique au récit. À travers l’histoire de sa mère, Itziar Ziga montre que la sortie de la violence patriarcale n’est pas une question de volonté personnelle, mais une nécessité collective, un travail de sororité et de soutien mutuel. Ce n’est pas l’image d’une femme triomphante qui se dessine, mais celle d’un féminisme ancré dans le réel, conscient de ses contradictions et de ses impasses, mais aussi porteur d’une rage et d’une tendresse qui nourrissent l’action.
Ziga, par ailleurs,inscrit son féminisme dans une analyse plus large des oppressions croisées, liant indissociablement la lutte des femmes à celles contre le racisme, le capitalisme et le colonialisme. À travers le parcours de sa mère, une femme issue d’un milieu populaire et soumise aux violences économiques autant qu’aux violences conjugales, l’autrice montre comment les structures de domination s’entrelacent et enferment les femmes dans une précarité qui les rend vulnérables à la brutalité des hommes et à celle du système. Maribel Ziga est une femme exploitée, non seulement par les hommes qui l’ont battue, mais aussi par un ordre social qui ne lui offre ni échappatoire ni véritable autonomie. Cette réalité rejoint celle des femmes racisées, des migrantes et des travailleuses précaires, dont les luttes sont trop souvent invisibilisées dans un féminisme blanc et bourgeois. Ziga refuse toute lecture individualiste de l’émancipation et rappelle que la liberté des femmes ne pourra être totale qu’en abattant toutes les structures qui les maintiennent sous contrôle : le patriarcat, mais aussi le capitalisme et les héritages coloniaux qui continuent de peser sur les plus marginalisées. En ce sens, L’heureuse et violente vie de Maribel Ziga s’inscrit dans un féminisme radical et intersectionnel, où la solidarité ne se limite pas aux femmes entre elles, mais s’étend à toutes celles et ceux qui subissent la violence des systèmes oppressifs.
Avec L’heureuse et violente vie de Maribel Ziga, Itziar Ziga livre un récit intime et politique, ancré dans une critique radicale du patriarcat, du capitalisme et du colonialisme. À travers la vie de sa mère, elle déconstruit l’illusion d’une émancipation individuelle et insiste sur la nécessité de luttes collectives. Loin du manifeste flamboyant, son écriture explore les ambivalences d’une existence marquée par la violence et la résistance diffuse. Ce livre puissant rappelle que la liberté ne se conquiert pas seule, mais par la solidarité et l’interconnexion des luttes. À lire absolument !