Le langage, cet outil politique


Le langage n’est pas neutre. Il façonne ce que l’on peut dire, et comment on le dit. Il nous fournit la chair de notre vision du monde, des fragments avec lesquels nous exprimons tout sentiment et toute idée. En même temps, il dessine les bords de cette vision, là où l’expression se tarit. Là où nous tentons en vain d’agripper les mots, en pure perte.
Et ce langage est un produit du pouvoir. La vision du monde qu’il construit n’est pas anodine, ce n’est pas le produit d’une histoire aseptique ou immatérielle. C’est celle de l’idéologie dominante, de cette série de croyances qui, imperceptibles, sous-tendent la société capitaliste pour la pousser en avant. Ainsi le ‘quoi’ et le ‘comment’ du langage – les idées qu’il véhicule, les images qu’il étale devant nos yeux, les espaces de parole qui nous sont ouverts – sont déterminés par celleux qui sont au pouvoir.
Tout ce que l’on dit, tout ce que l’on tente de dire, tout ce que disent les médias et les politiques, tout discours et tout texte reprend et reproduit cette vision du monde. Le langage, c’est un outil politique extrêmement puissant, une manière de passer sous silence tout ce qui contre ou conteste l’idéologie qu’il prône. En d’autres termes, lorsqu’elle s’énonce dans ce langage, la critique s’estompe au moment où elle s’articule.
En tant qu’il véhicule l’idéologie du système capitaliste, le langage exclue d’office l’expression de tout vécu qui sort de la norme cis, blanc, hétéro, valide. D’où l’invention des termes pour décrire nos identités et les formes de violence que l’on nous fait. D’où le geste de récupérer des mots qui, jadis, nous pointaient comme cibles. Le langage nous efface ou, plus précisément, efface nos réalités, nous repeint à ses couleurs : nous le reconnaissons implicitement dans toutes ces tentatives de se recréer une langue.
Et si cette idéologie rejette toute personne hors-norme, elle tend également à écarter la voix des malades. Il n’y a pas de place pour le vécu de la maladie dans une société étayée par la logique de la productivité maximale. Être malade, c’est incarner les limites du projet capitaliste, la faille au cœur de cette logique. Encore pire si l’on affirme son vécu de la maladie, si l’on réclame l’ « être malade » comme identité politique.
« La douleur physique fait plus que résister le langage : elle le détruit activement. Ce qui implique un retour immédiat à un état antérieur au langage, aux bruits et aux cris que fait un être humain avant d’apprendre à parler ».
Elaine Scarry
Physical pain does not simply resist language but actively destroys it, bringing about an immediate reversion to a state anterior to language, to the sounds and cries a human being makes before language is learned.
Il n’y a pas de mots pour exprimer la douleur. On l’a reconnu. Qu’elle soit la douleur de la maladie, des règles, des violences sexuelles, il ne nous reste rien. Malades, tordu·es par la douleur, traumatisé·es : le langage se désarticule dans nos gorges, on s’étouffe avec le non-dit. Parfois, on arrive à articuler une idée. Nous nous fabriquons des mots. Nous écrivons des poèmes. Pour poser, ici et là, les parpaings rugueux d’un édifice toujours à construire. Mais ce sont des moments rares.
En nous faisant passer sous silence, le langage nous arrache la narration de nos propres histoires. Là où l’absence des mots pour exprimer la maladie désigne le biais d’un langage trop pauvre, on préfère croire qu’il n’y a tout simplement rien à y dire. Et, inéluctablement, l’histoire de la maladie passe à la troisième personne. S’élabore dans le plagiat des vécus et des corps. Et les malades – muselé·es, mutilé·es – n’y peuvent rien.
Le silence des « autres »
À la place d’un discours humain, réel, qui pourrait communiquer la maladie telle qu’elle se vit, telle qu’elle s’étend dans le temps, on nous alimente au compte-gouttes d’histoires plates d’une maladie qui s’en va, qui ne laisse pas de trace. D’une maladie lavée de douleurs et de fluides. On nous raconte des légendes, des mythes où le héros surmonte sa maladie, reprend sa place dans la société. Où il devient productif encore une fois.
On nous prépare le terrain. Il y a le bon malade, celui qui ne se plaint pas, qui garde la pêche, qui guérit, qui regagne ses forces, et qui, par ailleurs, est rarement femme, et encore plus rarement racisé, ou pauvre, ou gros. Et puis il y a les autres. Celleux que l’on écartait déjà pour cause de race, ou de genre, ou de corps. Celleux qui sont malades et qui ne se taisent pas, qui hurlent et qui se plaignent. Celleux dont les corps sont et seront marqués à jamais par la maladie. Celleux qui refusent la logique de la productivité.
Il faut les taire, coûte que coûte. Car cette histoire de la maladie qui inquiète, qui dégoute, qui bouleverse, qui humanise aussi, incarne un défi pour le système capitaliste qui exige de nous de créer, d’investir et de s’investir, de (re)produire sans fin : et c’est pourquoi il faut la faire taire. Pour que la figure du/de la malade soit vide. Inhumaine. Aseptisée. Pour que personne ne puisse s’identifier. Pour qu’il n’y ait pas d’empathie. Pas de sympathie. Pas de connexion. Pas de partage.
Parce qu’il faut que le/la malade soit autre. Qu’iel soit pas nous. Enfin, à part le bon malade, le malade qui guérit, ou qui se tait. Il joue son rôle de bon citoyen sans vergogne. Il sert d’exemple à ses compatriotes. On l’accueille gracieusement dans le « nous ». On peut s’identifier à ce malade qui représente les valeurs de l’État. On veut qu’on s’y identifie. Qu’on se façonne à son modèle.
Mais les malades qui font du bruit, qui refusent la logique de la guérison, celleux-là sont écarté·es du « nous » qui se dit universel. Tout comme les noir·es, les arabes, les queers, les personnes en situation de handicap ; tout comme les gros·ses et les moches ; tout comme les femmes qui portent le voile et la burqa : la société se divise en deux entre celleux qui sont complices et celleux qui ne peuvent pas l’être.
Et le langage, comme outil politique qui cache son rapport au pouvoir, comme ce par quoi l’on pense le monde, bétonne cette distinction. Il parle au nom de « nous » afin de noyer les voix des « autres ». Ainsi il se permet de reprendre les histoires et les corps que nous nous tuions à articuler. Il les passe à la lessive. Il les repasse au fer. Il les plie, les range dans son armoire. Tant de figures à sortir quand il le faut.
« On ne comprend pas que je sois désormais incapable de vivre comme avant. On exige de moi que je mente. L’aporie de l’existence sociale et la maladie m’impose des silences si je veux rester auprès des autres. Je tais ma douleur aux proches, aux amis ».
Claire Marin
Et nous, les autres, nous nous retrouvons les mains vides. Pas de stylos, pas de papier, pas même de langue ou de trachée pour dire ce que l’on a à dire. On nous offre des mots pour décrire nos corps. Des mots désinfectés qui ne sauraient porter le sens du subjectif. On nous pèse, on nous mesure, on nous fouille l’intérieur. On parle de nos corps et de nos sensations dans une langue étrangère, la langue des médecins, celle des pathologies et des drogues.
Avec soin, les mains gantées, la médicine ampute la langue qui tendait déjà par un fil. Elle enlève le larynx, recoud les lèvres, et tout ça au nom de la science.
Comment dire la douleur en milligrammes ? Comment articuler l’insomnie sur une charte ? Comment désigner la violence faite au corps en latin, ou en grec ? Le dossier médical est un mensonge (le casier judiciaire, lui aussi). C’est tant de notes, tant de résultats, tant de graphies qui ne disent strictement rien sur le corps que l’on est. Ils parlent du corps comme machine, corps en panne, corps à réparer, corps objet. Corps pas-comme-il-faut. Corps inhumain. Pas du corps tel qu’il est ressenti.
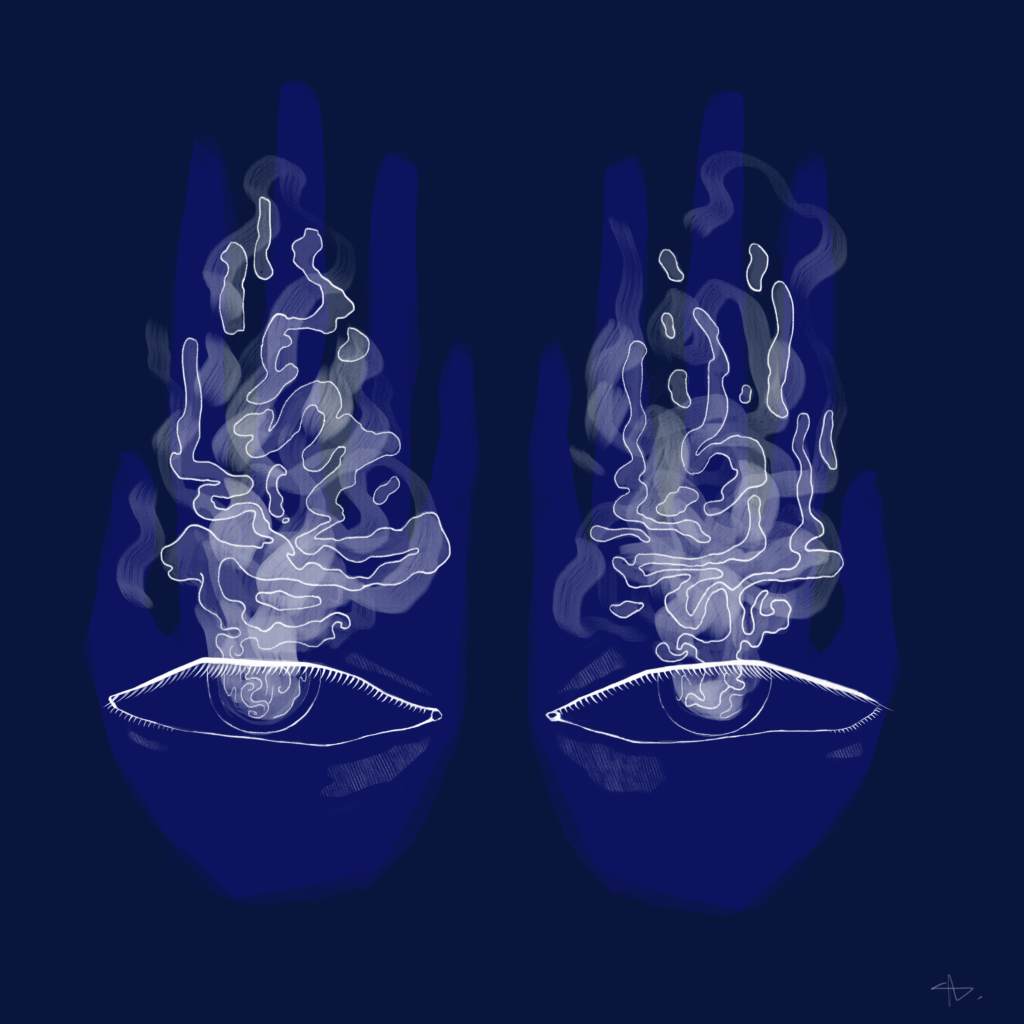
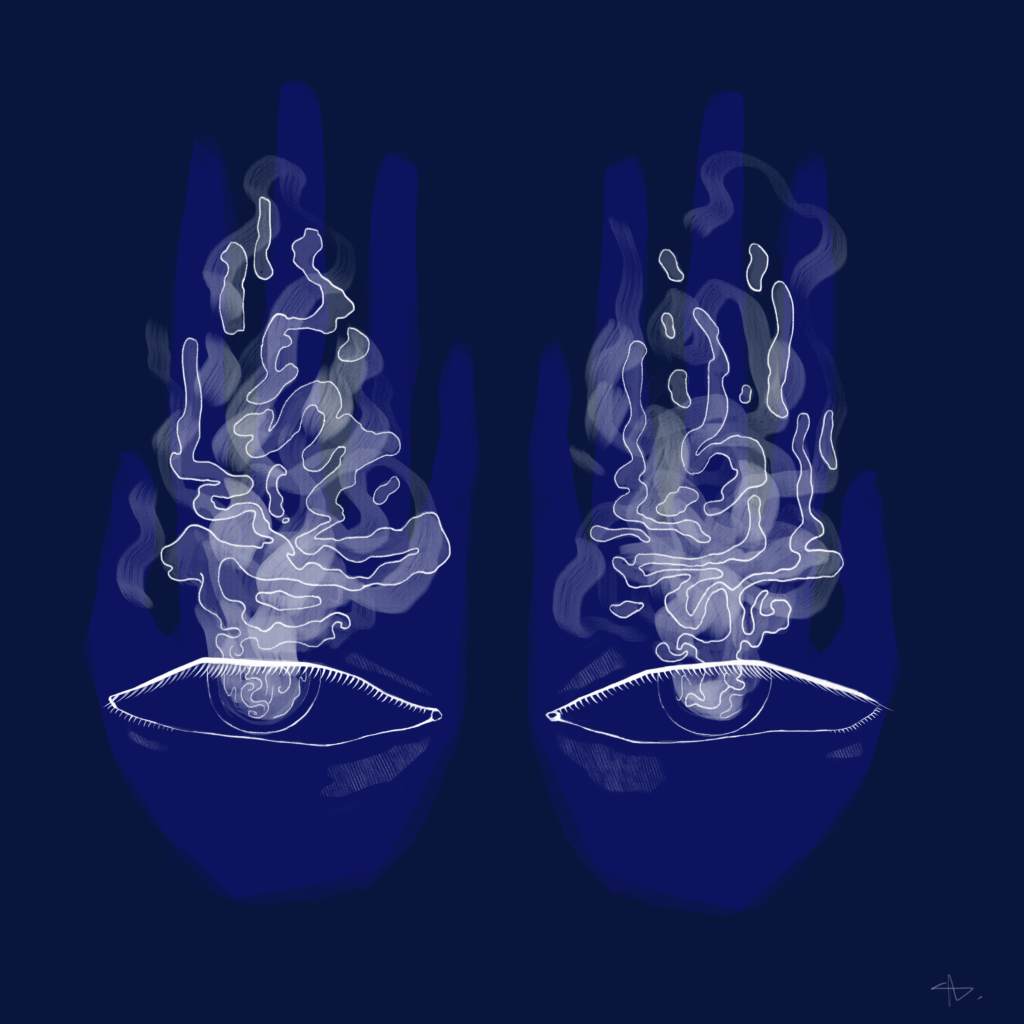
Les métaphores, cette poudre aux yeux
Au langage de jouer son prochain tour : la métaphore. Plus elle dessine une maladie convenable, plus elle efface la maladie réelle. Plus elle rend tangible la maladie approuvée, plus elle rend abstraite la maladie vécue. Plus elle humanise les bons malades, plus elle déshumanise les autres. La métaphore, c’est de la poudre aux yeux. C’est prétendre dissiper la fumée tout en mettant le feu ailleurs.
La maladie c’est une guerre. On lutte contre le cancer. On parle de victimes. On parle de battants et de battantes. Les médecins se servent de tout un arsenal thérapeutique. Et la maladie, c’est aussi une invasion. L’intrusion d’un corps étranger qui déstabilise, qui corrompt, qui détruit. Imperceptible. Une défaillance des frontières du corps. On le dit, tout ça. Nous aussi. Et bien plus. Souvent, sans s’en rendre compte.
Il y a tout un marché d’images et de métaphores qui se communiquent et se confirment dans le discours public autour de la maladie. Elles paraissent, peut-être, anodines. Mais c’est précisément là, le danger, dans leur banalité. Imperceptiblement, elles viennent remplir la figure du malade que l’on vient tout juste de vider du réel. Comme si rien ne s’est passé. Comme si elles avaient toujours été là. Comme si l’artifice qu’elles émanent était la réalité tout ce temps. Comme si c’était ça, la maladie, et rien d’autre.
Et puisque la métaphore a fonction de faire passer un message, cette naturalisation de la figure-artifice du malade implique une naturalisation des significations qu’elle incarne. Si la maladie est une affaire de guerre, c’est qu’il y a un ennemi. S’il y a des victimes, c’est qu’on doit parler de coupables. S’il y a invasion, c’est qu’elle vient de là-bas. Et tout d’un coup, la vision commune de la malade implique un ennemi, un tueur, un étranger.
C’est ainsi que la maladie, affaire intime et personnelle, devient une histoire à deux faces. Parce que la métaphore insiste sur la présence d’un ennemi dans cette affaire qui, par sa nature même, n’implique qu’un acteur : la personne malade. Il faut qu’il y ait un·e coupable, et c’est ellui le suspect numéro un, pas besoin de procès, on læ prend pour fautif·ve. Et puisque « nous » est synonyme de bon, d’innocent, la culpabilité place les malades fermement dans le camp des « autres ».
Et si le/la malade est coupable, c’est que l’on ne lui doit rien. Pas de sympathie. Pas de soins que l’on juge pas nécessaires. Pas d’explications qui prennent du temps. Pas de toucher attentif lorsqu’on lui manipule le corps. Pas besoin de l’inviter aux fêtes et aux réunions. Pas de protection sociale qui lui suffit pour vivre. Pas d’adaptation des lieux pour lui rendre la vie plus facile. Pas un sou de trop dépensé pour lui faciliter la vie.
« Voici un spectre des extrêmes de la douleur, de la laideur, de l’impuissance auxquels l’être humain peut se réduire. On nous rappelle la vulnérabilité vive de la vie incarnée et l’inévitabilité de notre mort. Il est bien normal de vouloir s’échapper à la maladie ».
Drew Leder
Here is a specter of the extremes of pain, ugliness, and helplessness to which the human being can be reduced. We are recalled to the acute vulnerability of embodied life and the inevitability of our death. It is natural to wish to escape from sickness.
Ça nous convient, aux « nous », d’avoir une raison de l’écarter. De toute façon, on n’avait pas envie qu’on nous rappelle que ça peut nous arriver aussi. On a besoin de croire à cette fiction, à ce que la maladie arrive parce qu’on a ouvert les portes. On s’acharne à la répéter, à la raconter aux autres, à faire passer le mythe à nos enfants. « Nous », on se glisse dans les habits neufs de l’Empereur, et on trinque à notre bonne santé.
Sur la nécessité de rendre autre
Voici les malades rangé·e·s aux marges avec les autres « autres ». C’est la face cachée de la logique de production : la logique de destruction. À détruire ? Tout ce qui trahit les vices du projet. De ce projet du capitalisme qui est en même temps le projet de la suprématie blanche, de l’Eglise chrétienne, de la famille hétérosexuelle, de la binarité des genres, du culte de la beauté, du fétichisme des minces, et bien plus. Et surtout, des corps perçus comme difformes, défaillants, corrompus, sales, mutilés. Des corps qui gâchent la vue.
Il ne suffisait pas de nous couper la langue. Il faut à tout prix nous couper du monde.
C’est l’enjeu du capitalisme : il n’y a pas assez pour partager. Pas assez d’argent, pas assez de maisons, pas assez d’amour. Enfin, il faut le croire, au moins. Pour que les gentes se différencient, s’opposent, s’arrachent les ressources des mains les un·es des autres au nom d’une hiérarchie de valeur créée par les mecs cis blancs qui voulaient bouffer du homard la conscience tranquille. Attention, hein, le remords ne se marie pas bien avec la saveur iodée des huîtres.
Mais ce n’est pas du homard que l’on sert dans les hôpitaux. Pas des huitres non plus. Tous les dispositifs de l’Etat tendent vers la reproduction de cette distinction entre « nous » et « les autres ». Et c’est précisément là la perle du capitalisme : toute la société s’entraine dans une lutte éternelle pour être reconnu·e comme « nous » et, pour se faire, pointe « les autres » du doigt. Le tour est joué.
Sauf que les dés étaient pipés dès le début. C’est la règle de la majorité. Ce n’est rien qu’une question d’arithmétique. On nous l’a appris à l’école : il y aura toujours plus de blancs, plus d’hétéros, plus de corps valides pour nous pointer du doigt. Ils ont mis toutes les chances de leur côté. Et lorsqu’on s’engage, lorsque les gays blancs pointent les noir·es, lorsque les lesbiennes cis pointent les personnes trans, lorsque les personnes trans binaires pointent les non-binaires, en pensant se sauver, iels s’assurent de leur perte.
Et les malades, bien sûr, seront toujours dans la minorité. Se verront confiné·es aux marges. Au moins le temps de guérir, si cela est bien possible. Certain·es retourneront, reprendront leur place aux rangs des « nous ». Se retourneront la peau marquée de piqûres de seringue et de plaies ouvertes pour se glisser dans la norme. D’autres ne pourront jamais. Encore d’autres étaient déjà exilé·es. Rien ne change.
Il y a que toute nouvelle maladie, toute nouvelle ethnicité non-blanche, toute nouvelle sexualité, enfin que toute nouvelle manière d’être un corps reprendra cette division lorsqu’elle arrive en Europe ou en Amérique du nord. Sa place est déjà faite. On l’attendait depuis longtemps. On était préparé. On se léchait les babines à l’idée de s’assurer sa place parmi les « nous » en désignant l’inconnu, l’étranger, comme autre.
Toute maladie épidémique qui fait peur … produit une distinction inquiétante entre les porteur·es putatif·ves de la maladie (ce qui, en général, veut dire les pauvres et, ici dans l’Ouest, les personnes à la peau plus foncée) et celleux défini·es – par les professionel·les de santé et les bureaucrates – comme « le grand public ».
Susan Sontag
Every feared epidemic disease … generates a preoccupying distinction between the disease’s putative carriers (which usually means just the poor and, in this part of the world, poeple with darker skin) and those defined–health professionals and other bureaucrats do the defining– as “the general population”.
On l’a vu avec le sida. Quelle belle occasion pour « nous » ! Quelle preuve magnifique qu’on avait raison de se diviser, de s’affirmer comme les bons, d’écarter les gays, les non-blancs, les personnes trans, les travailleur·ses de sexe, les toxicomanes. Et encore : quelle opportunité pour démontrer sa force ! Pour laisser des millions mourir sans en avoir rien à foutre, sans leur prêter la moindre l’attention, à part, peut-être, pour leur écrire un éloge sur un bout de journal : « Je te l’avais bien dit ! »
Et puis, une période de calme. Pas pour nous, les autres, hein, pour vous. Nous vous menacions, certes, à coup de projets de lois. Mais vous les avez ouverts et vous avez vu que ça ne change rien. Nous restons les autres, qu’on se marie ou pas. Et puis vous avez envoyé vos flics, vos chiens, vos bêtes à la tête vide qui nous battaient à coups de matraque. Qui nous coupaient le souffle. Nous avons compris qu’il fallait se la fermer.


Coronavirus : quoi de neuf ?
Tout ça pour dire, enfin, que l’avènement du coronavirus n’a rien d’une nouveauté pour nous les autres. Avec les premiers murmures d’épidémie nous avons entendu les grincements de la vieille machine que se remettait en marche. Par là, nous avons vu les politiques se passer les notes, se marrer entre elleux. Par ci, nous avons vu la suspicion se propager dans la rue. La multiplication des regards méfiants, des mains se serrant sur les épaules des enfants, des traversées subites des avenues à la vue de l’autre.
On aurait cru, peut-être, que tout ce discours sur les héros et les victimes indiquerait qu’on a épargné les malades, cette fois-ci. Que de toute façon, puisque tout le monde peut tomber malade, puisque les docteur·es en meurent, il n’y a rien d’une division. Après tout, ne parlons-nous pas en termes d’ « unité nationale » ? Ou même de « solidarité » ?
Certes. Mais unité des un·es implique exclusion des autres : on s’unifie en face de quelque chose, et le plus souvent, face à quelqu’un. Pour qu’il y ait unité nationale, déjà, il faut une nation. Et puis, il faut un terrain, un peuple, une figure, au moins, auxquels l’unité peut s’opposer. Et lorsqu’on parle de solidarité, il faut bien se demander « de qui avec qui » ? On adore utiliser ces grands termes tout en croisant les doigts derrière le dos.
Comprenez-le bien : « Nous sommes en guerre ». Tout le pays s’y déploie. On redessine le territoire dans de nouveaux traits. Les hôpitaux, c’est la première ligne. On y retrouve les soignant·es, nos soldats, destiné·es à devenir les héros ou les martyrs pour la cause. Les supermarchés, les pharmacies, les services dits essentiels : là on parle de deuxième ligne. C’est « toute la nation » qui est « engagée dans ce combat ».
On est soumis·e à l’assaut. Assailli·e sur tous les fronts. Dans l’imaginaire public, l’Europe se transforme en champ de bataille. Et qui dit guerre, dit aussi adversaire : étranger, hostile, sauvage, immoral, infidèle. Enfin, qui dit guerre évoque toute une série de traits qui s’opposent aux valeurs de la nation qui, par ailleurs, sont précisément les valeurs du « nous » par opposition aux autres.
Et pourtant, le coronavirus, ce n’est pas une guerre. Il n’y a pas d’adversaire qui agit, comme le suggère la métaphore de guerre, de plein gré contre les intérêts de la nation. Le coronavirus, ce n’est rien que ça, un virus. Si elle vient d’un autre pays, c’est par pur accident. Ça aurait pu naître en France, en Italie, en Angleterre. Ce n’est ni une arme biologique, ni un produit d’un peuple inculte. C’est un simple hasard de la nature.
Ou si ce n’est pas du hasard, si c’était prévisible, si l’on cherche à raisonner et à expliquer comment ça aurait pu se passer, on finit par se regarder dans le miroir. Les conditions propices à la mutation d’un virus sont une conséquence directe d’un capitalisme global qui prône la destruction de la diversité des écosystèmes. Un système créé par les pays occidentaux. Un système dans lequel ils continuent de jouer un rôle fondamental. Si l’on cherche vraiment à pointer le coupable, on se retrouve à se désigner soi-même.
Le virus : quel ennemi ?
On le sait. D’où un discours de l’invasion. On l’a dit : « … l’ennemi est là, invisible, insaisissable … ». Bien sûr que vous ne le voyez pas, l’ennemi. Ce n’est pas qu’il n’existe pas, que l’imaginaire de la guerre sert à vous rendre plus dociles, mais qu’il se cache. Qu’il se voile la face. Qu’il est non seulement étranger, hostile, infidèle, mais encore hypocrite, malin, diabolique. Il pollue, il corrompt, il nous empeste de l’intérieur.
Il faut qu’on le retrouve. De toute urgence. Tout le peuple s’engage dans la tâche. Le danger est partout : l’ennemi se dissimule, après tout. On soupçonne tout le monde de porter le virus. À son insu, peut-être : on fait une fixation sur les asymptomatiques. Ou même, le sachant, sortant dans la rue quand même, se mêlant aux personnes saines, soufflant le même air, occupant le même espace, quand même. Le glissement de la présomption d’innocence à celle de culpabilité se fait vite en temps de guerre.
L’ennemi prend forme dans l’imaginaire public. C’est l’homme qui tousse sans se couvrir la bouche. C’est les deux femmes qui se rencontrent sans se tenir à distance. C’est l’adolescent qui fait du skate dans la rue. C’est le vieux qui se pose sur un banc pendant trop longtemps. C’est l’inconnu qui s’est fait des réserves de papier toilette. L’œil de la suspicion leur tombe dessus, prend note, repart. La radio et les réseaux sociaux sont transformés en ritournelle des mêmes histoires d’atteintes au nouvel ordre public.
Subitement, l’ennemi s’empâte. Déjà, il était étranger, hostile, malin. Déjà, il polluait, il corrompait. Mais là, c’est flagrant, il est criminel, malveillant, impitoyable. L’ennemi, c’est l’antithèse de la moralité, de la bonté, de la vertu. Et si l’on arrive à suspendre la présomption de culpabilité, que l’on lui accorde le bénéfice du doute, il reste tout de même imprudent, ignorant, stupide. Dans tous les cas, il est dangereux.
Et pourtant, l’ennemi reste, finalement, sans face. Enfin, éventuellement, c’est un ennemi à mille faces. Et puisqu’il peut être tout, il incarne tout ce qu’on diabolise. Et puisqu’il peut être tout le monde, il s’incarne dans la figure de l’autre, dans les figures de tous les « autres » que l’on connaît déjà. Ce n’est qu’un petit pas à franchir, passer d’une division de la société entre les citoyens et l’ennemi à la division qui existait déjà, celle de « nous » – qui a toujours été synonyme de citoyen – et « les autres ».
« Étranger : rage étranglée au fond de ma gorge, ange noir troublant la transparence, trace opaque, insondable … Étrangement, l’étranger nous habite : il est la face cachée de notre identité, l’espace qui ruine notre demeure, le temps où s’abîment l’entente et la sympathie ».
Julia Kristeva
L’ennemi, on le connaissait déjà. Il était déjà dans notre sein. Dans nos écoles, dans nos rues, dans nos cours. L’ennemi, ça a toujours été le non-blanc, le non-hétéro, le non-valide, celui qui ne maîtrise pas notre belle langue, celui qui ne respecte pas nos valeurs, celui qui dit merde à la loi. Ça fait sens maintenant. Nous voilà rassuré·es.
C’est ainsi que le récit se déroule. Que se réécrit une histoire en cours, qui n’a jamais été écrite et qui, de toute façon, allait toujours s’écrire comme ça. Nous, les autres, on le voyait venir de loin. On a l’habitude d’être les boucs-émissaires. Vos regards méfiants n’ont rien de neuf. Votre présomption de culpabilité non plus. Queers, racisé·es, malades, en situation de handicap : nous avons grandi sous vos yeux perçants, nous avons toujours porté le fardeau d’une identité impropre, impie, inculte, ignoble.
Les vrais dommages collatéraux
Et pourtant, nous voyons le danger. Nous qui avons l’habitude des marges, de se draper des ombres, nous qui payions déjà bien trop cher le prix d’être hors-norme, nous ne nous faisons aucune illusion. Les coûts vont être énormes. Parce que cette fois, nous ne sommes plus la forme vague d’une menace toujours à venir, mais l’ennemi juré. Nous ne figurons plus comme la possibilité de la destruction de la société, mais de sa réalisation.
Nous étions déjà en situation précaire. Nous étions beaucoup à ne pas pouvoir se loger, se réchauffer, se nourrir. On travaillait à temps partiel, à contrat déterminé, au black. On avait déjà du mal à se payer les soins, à se les faire rembourser, et cela si même on arrivait à se faire soigner. On figurait déjà entre les plus précaires, les plus isolé·es, les plus à risque. On vivait déjà une violence extrême, dans la rue, au travail, à la fac, à l’hôpital, au commissariat, chez nous. Nous nous serrons les dents en attendant les coups.
Parce qu’une maladie, elle non plus, elle n’est pas neutre. On a beau la dépeindre comme phénomène purement biologique, comme confrontation de forces physiques. Mais cette confrontation se joue dans un corps qui s’inscrit dans une situation sociale et dans un environnement concret. S’il n’a pas pu accéder aux soins, s’il n’a pas pu se nourrir, s’il a subi des violences physiques ou sexuelles, c’est qu’il n’est pas une page blanche. C’est qu’il a déjà moins de ressources que les autres pour gérer un virus.
Que cela soit clair : nous allons mourir plus vite que vous. Quand on meurt dans vos prisons, vous diriez qu’on n’avait qu’à ne pas enfreindre la loi. Quand on meurt dans vos cliniques, dans vos maisons de repos, vous diriez qu’on était déjà vulnérable, que de toute façon, on allait bientôt mourir. Plutôt nous que vous, les bons, les sains, les innocents.
Et puis, quand on meurt hors de vue, qui va nous compter ? Qui va compter les corps des personnes sans domicile qui meurent à la rue, de faim ou de froid ou d’un manque de soins, parce qu’on continue à s’en foutre d’elles ? Qui va compter les corps des femmes abattues par leurs conjoints ? Qui va compter les corps des personnes qui se suicident après des mois de maltraitance, ou d’isolement ? Nous ne nous faisons pas d’illusions.
Parce qu’en tant qu’ennemi·e·s, en tant que coupables, nous ne méritons pas de sympathie. On ne mérite même pas de soins. Si nous tombons malades, c’est que nous l’avons toujours été, au moins dans l’imaginaire public. Bien fait pour nos gueules. Et la hiérarchie de valeur qui déterminait déjà nos possibles se transforme en hiérarchie de valeur des vies. Combien vaut une vie ? Si c’est la nôtre, très peu, à ce qu’il paraît.
« Sans doute, vous
Rafael Campo
Nous avez déjà vu au rayon des surgelés
Ou sur l’autoroute, où nous étions les cerfs
Que vous faillez tuer en conduisant trop vite […] ».
We may appear
To you, as déjà vu among the frozen foods
Or on the highway in the form of deer
You almost kill before your speeding car […]
C’est ainsi que l’on se permet de justifier des choix qui devraient être impossibles : de qui reçoit les ressources, de qui on soigne, de qui mérite un lit, de qui on va sauver, et de qui on va laisser mourir. Vous voyez, la fusion des deux schémas de division sociale n’a rien d’un accident : elle est le produit d’un système qui tend toujours à nous écarter afin de réduire notre droit à un traitement égalitaire, à la sympathie, enfin à l’humanité.
Inhumain·es, et interdit·es de réclamer notre humanité, nos vies ne valent rien.
Nous ne pouvons pas mourir. Pas en public, en tout cas. Parce qu’on n’y a jamais existé. Ou que quand on y figure, c’est en deux dimensions, le contour d’un corps sans émotions, sans désirs, sans peine. On l’a vu : le langage nous tait. Nous prive des moyens pour raconter nos vies. Et c’est là, précisément là, dans l’écart qui nous sépare de la société, cet écart de silence, chargé du non-dit et de l’indicible, qu’il nous porte le coup fatal. On jettera nos corps dans des tombes sans inscriptions, à oublier aussi vite que possible.
Vous, soufflant sur les braises du mythe national
Quand les choses se seront tassées – quand nos corps se seront entassés les uns sur les autres – on écrira. Pas nous, bien sûr, mais vous, vous écrirez. Vos politologues, vos chroniqueurs, vos romanciers, vos hommes d’Etat, vos femmes-fantoches, vos hommes de paille : tant de bouches versant des banalités dans la rue, des platitudes sur les écrans, des controverses à deux balles condensées en 420 caractères.
On s’assoira au coin du feu pour écouter les légendes. Les contes de fées. Tout un folklore, toute une cosmologie se diffusera, et bien plus vite que le virus n’a jamais pu, parce qu’elle pourra rentrer par les fenêtres, elle flottera sur les ondes, elle se projettera en chaîne. On se réchauffera les mains autour des flammes d’un mythe national qui brûlera plus fort que jamais à l’odeur de la chair cramée.
Quel mythe ? Quelles légendes ? Des médecins-héros, des infirmi·ères-martyres, des fonctionnaires-sacrifices. On y retrouvera l’idéal de la bonté, de la vertu, du « nous » qui n’a jamais existé et qui, pour se prétendre réel, ne fait que se vêtir de la peau de tant de figures synthétiques. On assistera, épaté·es, tétanisé·es, hébété·es, à un spectacle de marionnettes que l’on fait passer pour la réalité. Il n’y aura rien d’autre à dire.
Et pourtant, nous, les autres, nous saurons que vous n’avez pas tout dit. Nous regarderons autour de nous, dans la pénombre où vous nous avez exilé·es, et nous verrons ce que vous ne verrez jamais. Nos yeux se sont ajustés à l’obscurité, vous voyez. Des figures crépusculaires à tant d’yeux de chat. Hors de vue, on voit tout.
Déjà, on vous voit tirer les fils de vos pantins. Aux coulisses, on voit la farce que vous réalisez, le simulacre que vous mettez en scène. Nous, les queers, les étrangers, celleux au nez crochu, celleux qui gardent leur accent, on a l’habitude de jouer le méchant. On aurait pu écrire le scénario pour vous : pas de rebondissements, pas de surprises. Pas de répliques pour nous, les méchant·es. Pas de fin heureuse non plus.
Dans le meilleur des cas, on se fond dans le décor. La comédie se poursuit à tombeau ouvert et on fait de notre mieux pour s’écarter de son chemin. De s’effacer. De ne pas se retrouver sous le feu des projecteurs, à moitié maquillé·es pour dissimuler les bleues, les piqûres de seringue – on fera l’autre moitié plus tard, quand le sang aura séché. Parce que dans cette lumière, dans ce pastiche, dans cet inventaire de la toute-puissance du capitalisme, on est la proie rêvée. C’est de bonne guerre, n’est pas ?
« Mais là-bas, juste à contre-pente, je bute et l’autre, par gestes, attitudes, regards me fixe, dans le sens où l’on fixe une préparation par un colorant. Je m’emportai, exigeai une explication… Rien n’y fit. J’explosai. Voici les menus morceaux par un autre moi réunis ».
Frantz Fanon
Bâillonné·es, silencié·es, privé·es de mots et d’une place à la table : nous avons beaucoup à dire. Pour qu’on soit plus que les dommages collatéraux. Pour qu’on ne soit pas les méchant·es dans l’histoire. Pour que vous compreniez que nous aussi, on a souffert, on a perdu nos proches, on a saigné et on a pleuré. Pour que vous voyiez la violence qu’on a subie qui ne fait que se ramifier à coups de poings et de calomnies.
Pour récupérer enfin un peu de l’humanité que vous nous avez ôtée.
Pour pouvoir faire notre deuil. Pour pouvoir se faire traiter. Pour pouvoir se remettre au pieds. Pour pouvoir secouer la poussière de nos cheveux, de nos cils. Pour pouvoir tendre la main aux autres : pour les relever, pour leur essuyer les yeux, pour formoler leurs plaies et pour calmer les coups. Pour pouvoir s’apercevoir de la réalité, pas de cette parodie de l’histoire dont se vantent les puissants, mais de celle que nous vivons, celle qui nous fait vibrer de peine ou de plaisir : celle qui refuse le discours officiel par son être même.
Et c’est précisément dans les ombres, dans le fond, dans les parties blanches du script et des journaux que nous commencerons à l’articuler, cette réalité. Ou autrement, nos paroles naissent précisément là où vous pensiez nous avoir privé·es de voix. Dans cette terre aride, avec des outils émoussés ou aux mains nues, nous avons travaillé le sol, nous y avons versé nos larmes, nous avons semé les graines d’un langage neuf et fécond.
Qu’on se rattache la langue
On écrit là où on peut. Sur des coins de journal. Sur les capes de cigares que vous jetez à la rue. Sur le papier du chewing-gum qu’on mâche pour ne pas se bouffer la langue. Sur des tickets de train que l’on retrouve par terre. Dans les mots doux qu’on se passent entre les mains. Dans les notes qu’on se file sous la table. Et parfois, en gros, sur les murs de vos bâtiments impériaux, sur vos panneaux d’affichage, sur les fenêtres des voitures de première classe. Bref, partout, là où on peut, on griffonne nos marques.
C’est une écriture de fragments, une histoire à contre-sens, un dialogue qui avance par à-coups. Et dans le fractionnement, le fracas, la déraison, on refuse la logique du langage dominant. On refuse la monotonie abrutissante de sa prose. On refuse la chronologie de ses manuels d’histoires. On refuse l’aseptisation de ses métaphores fades. En un mot, on se fait insensé·e pour enfin créer du sens.
« … la poésie n’est pas un luxe. C’est une nécessité vitale. Elle génère la qualité de la lumière qui éclaire nos espoirs ainsi que nos rêves de survie et de changement, espoirs et rêves d’abord mis en mots, puis en idées, et enfin transformés en actions plus tangibles. La poésie est le chemin qui nous aide à formuler ce qui est sans nom, le rendant ainsi envisageable. Les horizons les plus lointains de nos espoirs et de nos peurs sont pavés de nos poèmes, taillés dans le roc des expériences de nos vies quotidiennes ».
Audre Lorde
… poetry is not a luxury. It is a vital necessity of our existence. It forms the quality of light within which we predicate our hopes and dreams towards survival and change, first made into language, then into idea, then into more tangible action. Poetry is the way we help give name to the nameless so it can be thought. The farthest horizons of our hopes and fears are cobbled by our poems, carved from the rock experiences of our daily lives.
La poésie, c’est notre botte secrète. La dague qu’on avait caché dans nos culottes. Qu’on se glisse entre les dents. On s’en sert pour découper des formes dans le tissu de la société. Pour taillader le bleu et le blanc et le rouge que vous accrochez partout. Pour percer l’étoffe de l’artifice et pointer les trous noirs du langage officiel, là où la masse des mensonges nous accable à ne plus pouvoir respirer. On fait péter la bulle.
Fragmentée et fragmentante, elle désarticule pour articuler. Imagée et imageante, elle floute pour mettre au point. Étrangère et étrangeante, elle dépayse le familier pour se faire sentir chez soi. Rassemblée et rassemblante, elle sépare pour rapprocher. Libérée et libératrice, elle s’enchaîne pour désenchaîner.
Notre poésie, elle est révolutionnaire. Au sens plein du terme. Elle est désir : pour les corps battus, drogués, balafrés. Pour les corps qui ne sont pas blancs. Pour les corps bouffés d’hormones. Pour les corps qui s’affament. Pour les corps qui ne bougent pas comme il faut. Et elle est douleur : des coups de poings, de matraques, de couteaux. Des corps saignants : douleur des règles, douleur du viol, douleur des agressions. Elle est la mesure exacte du langage dominant, son inverse, l’envers de sa peau. Et elle le sait.
Et cette poésie, elle n’a pas à s’écrire. Elle danse, aussi. Elle se met en scène. Elle enroule des pellicules, jauge la lumière. Elle pose devant l’appareil. Elle s’étale sur un lit. Elle s’ouvre les cuisses. Elle se les ferme. Elle se regarde dans le miroir. Elle mélange ses peintures, lave ses brosses avec soin. Elle laisse des messages sur des arrêts de bus et des pupitres. Au feutre indélébile. Elle envoie des sextos. Elle tourne des scènes de porno. Elle baise. Elle jouit. Ou pas. Et surtout, elle n’a rien à foutre.
Vous voyez, c’est inutile de nous découper la langue : on en fera pousser une autre. On trouvera un vocabulaire dans les poubelles. À base de légumes déformes, de fruits trop riches, de tout ce que vous avez du mal à avaler. On se construira une grammaire avec ce que l’on jette à la rue. Des bouts de bois et des cageots. On se fera des accords entre tout et rien. On aura, nous aussi, le temps parfait, mais le nôtre saura vraiment dire l’histoire.
Il s’agit d’un langage du véritablement universel. D’une unité réelle. D’une solidarité de pratique et pas seulement de principe. Un langage qui tient aux autres. Qui se tend la main. Qui compatît. Qui caresse. Qui respecte le consentement. Qui pose le corps comme inaliénable, comme intime, comme l’unique affaire de celui qu’il incarne.
Et c’est un langage de reconstruction. D’imagination. De rêves et rêveries. Un langage-phénix. Toujours en train de renaître de ses cendres. Un langage souple. À plier. À casser, si l’on veut. À tordre. À mastiquer entre les dents. Un langage à goûter. Qui sent bon. Qui sent la peau chaude, l’haleine de l’autre, la sueur, la clope. Qui diffuse l’odeur des repas conviviaux et des salles de danse. Qui brille dans la pénombre.
Un langage du non. Il le fallait. Comment repousser les mains errantes des hommes cis blancs valides qui croient que tout leur appartient ? Un langage qui refuse leur toucher, qui contre leurs coups. Un langage qui conteste la logique de la (re)production. Qui la remet en question. Qui la met à nu. Qui la tourne en dérision. Et qui, ainsi, fait effondrer la hiérarchie de valeurs. Ou plutôt, la regarde se dégonfler, une épingle entre les lèvres.
Mais, et surtout, c’est un langage du oui. Quand on veut, bien sûr. Un langage de regards qui s’attardent, de sourires qui dansent dans le coin des bouches, des dents se mordant les lèvres. Des signes de têtes, presque imperceptibles, des accords. Un langage qui accueille, qui donne, qui partage. Généreux. Chaleureux. Un langage honnête. Candide. Un langage de communication réelle. Qui traverse des différentes formes d’expression, qui s’en fout des fautes de grammaire, des accents. Qui dit tout, à tout le monde.
En un sens, il existe déjà, ce langage. C’est celui des poésies, des pornographies, du bénévolat, des dénonciations des agresseur·es sexuel·les. Mais il est avant tout un langage à construire. Et nous, les autres, c’est à nous de l’élaborer. De lui fournir des mots, des images, des espaces de parole. De lui infuser de nos histoires, de nos peines, de nos amours. De tout ce qu’on est. À nous de lui insuffler une véritable vie, la nôtre.
Illustrations : Arsène Marquis

