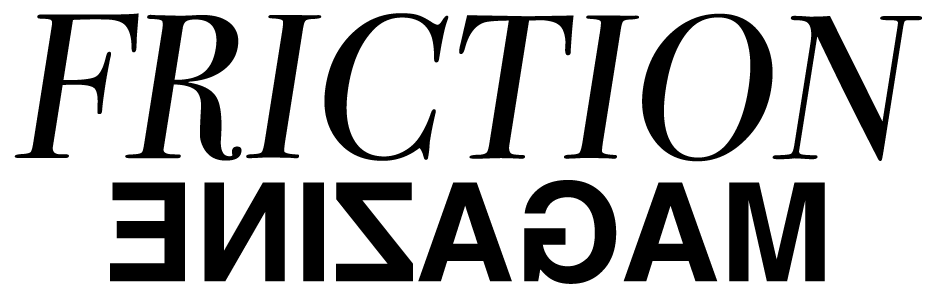Si Jean-Baptiste Phou a l’habitude d’évoquer son identité asiatique à travers son art, son homosexualité a rarement été au cœur de ses pièces ou de ses textes. Une réalisation qui a donné naissance au livre dont nous avons discuté il y a de cela quelques jours et intitulé La Peau hors du placard, publié aux éditions Seuil. L’auteur, comédien et metteur en scène signe un récit autobiographique délicat, honnête, et qui prend la forme d’une vie de voyages faits entre la France, l’Espagne et le Cambodge. Chapitre après chapitre, le jeune homme qu’il était raconte sa découverte de soi mais aussi le racisme qu’il subit, aussi bien venant de sa communauté que du monde hétérosexuel. Afin de revenir sur ce parcours mais aussi sur ce qui a changé aujourd’hui, nous lui avons posé toutes nos questions.
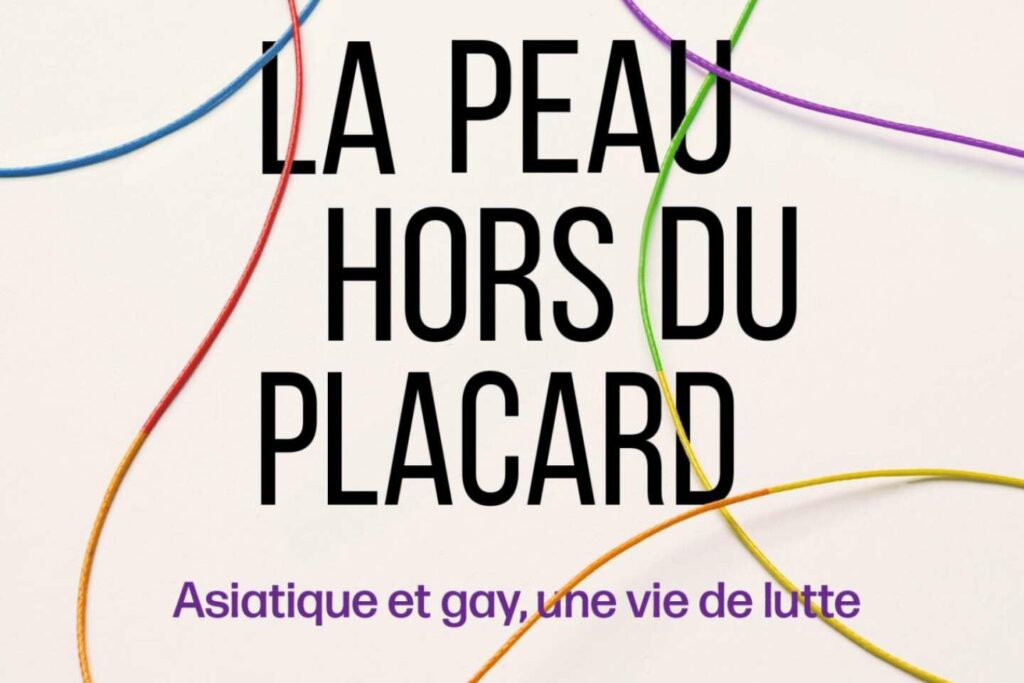
D’où vient le besoin d’écrire ce livre, déjà ? Qu’est-ce qui a été le déclencheur de sa rédaction ?
Avant d’être un livre, c’était un podcast. Ça s’appelait La couleur du désir, qui avait été posté sur un média qui s’appelle aussi Friction. C’était un ami qui avait lancé Frictions, Walid Hajar Rachedi et il m’avait demandé si je voulais parler de l’identité, du travail, de l’amour…
L’identité, c’est vraiment le thème sur lequel je bosse, par contre je me suis dit l’amour, je n’en parle pas ! Et je me suis questionné sur cette réaction. Pourquoi ? Je me suis rendu compte que si je n’en parlais pas publiquement, c’était qu’il y avait encore une espèce de honte ou de peur qui était associée à l’homosexualité. J’ai du coup décidé de coupler l’identité et l’amour. Je parle assez souvent de la question du racisme en tant qu’asiatique et des discriminations, notamment dans mon métier de comédien. Je me suis dit que ça serait intéressant de croiser ces deux choses-là, qu’est-ce que ça signifie d’être un asiatique gay.
J’ai envoyé ce podcast d’une quinzaine de minutes à Léonora Miano, une écrivaine qui dirige également la collection d’une maison d’édition. Lorsqu’elle a écouté le podcast, elle m’a fait part de son intérêt de le travailler ensemble pour en faire un ouvrage.
Tu évoques une première « rencontre » communautaire au centre LGBT de Paris où tu ne supportes pas le côté « pleurer ensemble ». Est-ce que tu penses que l’assignation au « se réunir pour dire à quel point on est malheureux » peut faire peur aux jeunes LGBT ? Est-ce que tu penses que c’est encore le cas pour la jeune génération d’aujourd’hui, ce sentiment d’absence de joie « queer » ?
C’est hyper délicat comme question. En plus j’avais quinze ans à l’époque et je ne peux absolument pas dire que c’était une généralité, heureusement. Même si c’est vrai qu’à mon époque, être gay, c’était souvent associé à un drame, à quelque chose de douloureux, de traumatique. Et le fait de le voir incarné devant moi, ça m’a rendu hyper mal à l’aise au lieu de me réconforter. C’était la seule issue que je voyais, il n’y avait pas le côté festif, il n’y avait pas le côté social. Je suis peut-être tombé sur la mauvaise journée, j’en sais rien mais c’est comme ça que je l’ai vécu à l’époque. J’avoue mon absence de connaissances sur ce qui se passe aujourd’hui dans le milieu associatif mais j’ai quand même l’impression, par ce que je vois sur les réseaux sociaux, qu’il y a un côté plus social aujourd’hui. On ne se réunit pas que pour parler de nos traumas – on le fait, il y a des groupes de parole qui existent – mais j’ai aussi l’impression qu’il y a des clubs sportifs, des groupes pour aller visiter des musées, faire du karaoké…
Il n’y avait pas ce genre de choses à ce moment-là de ta vie ?
Moi je n’y avait pas accès, je ne savais pas comment les trouver. Moi j’ai 43 ans donc à l’époque, pas d’Internet, d’applis : rien. C’était hyper limité pour avoir accès à l’info ! D’autant plus que je vivais en banlieue et pas à Paris.
D’ailleurs j’ai 26 ans, tu en as 40. Je suis gay toi aussi, d’origine cambodgienne tous les deux… Est-ce que tu penses qu’il y a quelque chose qui différencie nos générations dans le vécu de ces deux identités ?
J’aimerais bien que tu me parles de ton expérience car de mon côté ça va être surtout de la projection. Mais en tout cas, j’ai l’impression que pour les plus jeunes, ces questions-là sont conscientisées. On comprend mieux aujourd’hui qu’il y a des discriminations, des jeux de pouvoir qui sont en place, des jeux de domination. À mon époque, ce n’était pas du tout conscientisé, il y avait plein de violences, des discriminations, du fétichisme mais on ne mettait jamais ces mots là-dessus. Moi, si j’osais dire que c’était raciste, les gens me riaient au nez ou me disaient que c’était que des préférences, ce qu’on dit encore d’ailleurs. Il y a Grindr vs personnes racisées, ce genre de comptes qui font état de toutes ces pratiques hyper dures. Mais sur leurs posts, on voit les réactions des personnes racisées, on voit qu’ils dénoncent ce racisme. Au moins il y a un « droit de réponse » là où à mon époque, c’était complètement inaudible. Je ne sais pas si toi, tu corrobores ou pas ce que je ressens.
Le côté conscientisation, je pense que c’est hyper présent. On a plus d’outils pour dire ce qu’on vit. Moi, j’avais quand même beaucoup plus de remarques fétichistes sur les réseaux quand j’étais en début de vingtaine qu’aujourd’hui où j’en ai 26. Aussi parce que ma sociabilité a changé mais la société aussi. Mais ce qui a surtout changé, c’est moi. J’ai chopé des « endroits de confiance » en mon physique en tombant sur des hommes soit asiatiques, soit asiatiques métisses… Il y a plus de représentations et donc plus de moyens de sortir de la dépréciation personnelle. Par contre là où moi je bute, c’est qui dit « raciste qui a honte » dit racisme silencé, racisme qui ne se dit pas et parfois tu ignores si tu es rejeté pour ton ethnie ou pour des goûts personnels liés à autre chose.
Peut-être que ça, ça a changé. Parce que pour moi, à l’époque d’internet, sur GayRomeo, c’était hyper fréquent de voir « pas d’asiats, pas de folles ». C’était un truc qui était sur le profil, genre les deux tiers des gens écrivaient ça ! Quand j’ai commencé à tchater sur les réseaux, c’était hyper fréquent que les gens disent « désolé, pas branché asiatiques ». Même les mecs qui ne seraient pas intéressés ne vont peut être pas le formuler comme ça… En tout cas je trouve intéressant ce que tu dis sur la représentation, notamment pour la jeune génération. Parce que c’est vrai que moi, je n’avais pas accès en étant plus jeune à des représentations positives, séduisantes ou valorisantes d’hommes asiatiques. À part dans les films d’art martiaux. Mais bon, il fallait vraiment être un peu spécialisé. Aujourd’hui, c’est vraiment accessible avec les plateformes de streaming, avec Internet, tout ça.
Tu dessines un profil type du fétichiste asiatique à un moment, non sans humour et profondeur politique. Est-ce que c’était important pour toi de s’amuser de cette forme de racisme, de le tourner en dérision ? Pourquoi ?
Pour moi, l’humour est hyper important. Je préfère en rire parce que ces sujets-là, ils sont déjà suffisamment lourds à vivre au quotidien. Pour moi, c’est aussi les détourner, pas de dédramatiser loin de là, mais apporter un peu de légèreté. Et puis il y a aussi un peu de cynisme, un peu d’autodérision sur certaines choses aussi. J’essaye de rigoler en faisant des caricatures des gens qui me caricaturent. C’est plutôt ça que j’essaye de faire en tendant un miroir, en disant « voilà ce que ça fait de l’autre côté ». Est-ce que vous trouvez ça drôle ? Moi, je peux m’en amuser.
Tu racontes une relation qui t’as fait passer de te sentir « beau pour un asiatique » à « beau tout court ». Pour toi, qu’est-ce que cela raconte de nous en tant que communauté, de notre rapport au regard et à la validation masculine ?
C’est une grille de lecture possible. Moi, je le verrais un peu différemment. Pour moi, c’est plutôt que quelqu’un m’a vu pour moi. C’est plutôt ça, ce n’est pas que « quelqu’un m’a trouvé beau ». Mais quelqu’un m’a vu. Et c’est là où j’ai pu me voir différemment, en me disant que je ne suis pas qu’un asiatique. Je peux exister en dehors de ce label, être vu uniquement en tant que personne. C’est pour ça que ce moment a été déterminant. J’avais peut être 21 ans à l’époque, c’était la première fois que quelqu’un me disait « les gens te voient, te remarquent ». Là où moi j’ai toujours eu l’impression que j’étais invisible ou que si l’on me voyait, c’était qu’à travers ce prisme-là de mec asiatique où l’on me compare aux autres mecs asiatiques. C’est plutôt dans ce sens-là que je voulais parler de cet épisode.
Tu racontes justement un autre épisode qu’on va qualifier, faute de mieux, d’hypersexualité. Tu le rattaches à un besoin de se rassurer suite au sentiment de rejet, de ne pas se sentir assez désirable. Est-ce que tu peux m’en parler davantage de cette période-là ? Est-ce que tu penses que c’est une étape importante et est-ce que tu penses qu’elle est parfois nécessaire ou qu’il faut forcément en sortir à un moment ?
Pour moi, il y avait plein de raisons. J’avais 22 ans, j’arrivais en Espagne et ça correspond au moment où je sors de ce moment assez lourd, où je suis parti en Martinique, je me suis embrigadé dans une secte, je suivais un mec avec qui ça s’est très mal passé… C’était un retour à la vie. Et c’était une façon pour moi de jouir de la vie, jouir au sens littéral.
Alors, en même temps, effectivement, ça confortait aussi quelque chose, une façon de me rassurer quant à ma capacité de plaire. C’était aussi dire « j’ai 20 ans, je peux en profiter, merde » avec tout ce que ça peut comporter comme problèmes. Est-ce que profiter de la vie, ça veut forcément dire baiser à tout va ? Pas forcément. A ce moment-là de ma vie, c’était ce qui m’était accessible, ce que j’avais envie et je ne le renie absolument pas. Je voulais pousser au maximum les limites de mon corps. Une espèce d’euphorie, en plus dans un pays étranger… Ce côté « Pas d’asiatique. Pas de folle. », en Espagne, il n’existait pas.
Pour finir, est-ce que tu as un ou deux conseils lectures que tu nous proposerais ?
Il y a un classique, le livre de Didier Eribon, Retour à Reims. Beaucoup de gens de ma génération l’ont lu mais il reste encore hyper pertinent. Aussi bien dans le propos que dans la forme, je pense que Didier Eribon, Annie Ernaux, Edouard Louis, ils ont vraiment lancé un truc sur l’autofiction avec un regard sociologique. Retour à Reims est à part quand même, c’est la base.
Et je pense que c’est un très beau livre et qu’il mériterait d’être plus connu : Nous aurions pu être des princes d’Anthony Veasna So. C’est un écrivain cambodgien -américain, décédé après la parution de ce recueil de nouvelles. Il avait seulement 25 ans et sa plume est brillante. Il parle de cette communauté de cambodgiens-américains qui vivent dans le nord de la Californie, raconte cette jeunesse un peu désœuvrée avec des parents qui sont encore traumatisés par le génocide… Certains enfants sont dans des gangs, d’autres sont à la dérive, se cherchent… Et en plus comme l’écrivain est queer, il raconte aussi des histoires un peu queer.