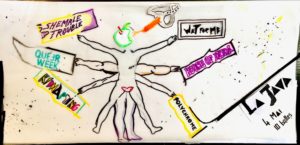Cliché is, in a sense, the purest art of intelligibility. It tempts us with the possibility of enclosing life within beautifully inalterable formulas of obscuring the arbitrary nature of imagination with the appearance of necessity.
Leo Bersani (cité par Yvonne Rainer dans Lives of Performers, 1972)
J’habite à Paris depuis 10 ans. Entre temps, j’en ai passé presque deux à Nantes (2015-2017). Quand je débarque, je connais à peine deux personnes dans la ville mais très vite, on m’intègre hyper facilement. En l’espace d’un mois, j’ai déjà ma « bande ». On est une quinzaine à s’entraider, à surmonter le cap de la précarité. J’ai pas de travail, parfois, quelques missions en intérim. Je vis avec 550 balles de chômage mensuel, mais je suis pas à plaindre : mes parents payent mon loyer (390€, un T2 de 35m2 en plein centre). Je suis très clairement l’exception parmi mes ami.es et me sens, de ce fait, honteusement privilégiée.
Je découvre la chourre, la glande, et surtout, des gens différents de ceux que j’avais rencontrés pendant mes années d’étude. Les journées défilent. Je les passe à me balader, mater des films, refaire les mêmes friperies, écumer la plage de temps en temps : la vie est douce.
Les week-ends sont des entre-nous. Plus question de finir dans des clubs perraves. Les heures passent en after, chez les un.es et les autres. On fréquente 3/4 bars (pour les concerts surtout), la Rumeur, le Chien, le Cafduc, et Bitche. Bitche, c’est les ateliers dans la rue éponyme. Mon premier concert de Noise, c’est là-bas.
« La nuit n’en finit pas, on passe les afters à se rencontrer et à se rencontrer encore, à refaire le monde, à épuiser nos salives et à fumer des fins de mégots. »
On dépense jamais grand-chose, les concerts sont à prix libres, on a quelques canettes de Lager au fond du sac et des biberons de Pastis, « quelques traces de speed sur une poubelle »—voir la chanson en titre de cet article. Je saigne le Cinématographe et sa programmation digne d’une Cinémathèque française, en mieux. Ici les séances pour les gens comme nous sont à 3 balles.
La nuit n’en finit pas, on passe les afters à se rencontrer et à se rencontrer encore, à refaire le monde, à épuiser nos salives et à fumer des fins de mégots. C’est cliché ? Rien àf, le cliché c’est « l’aboutissement au dehors de mouvements intérieurs qui sont assez complexes. Mais nous ne pouvons pas les exprimer[2]. » Preuve en est : je suis en train de me « radicaliser ». Je passe de bisexuelle sans conviction à gouine rouge[3]. Mais puisque toutes les bonnes choses ont une fin : ne trouvant pas de travail, je dois rentrer à Paris. Les « freaks » me manquent, mais je les retrouve à Nantes tous les 2/3 mois.
À Paris, les choses s’accélèrent doucement : en presque 3 ans, je m’insère dans le milieu transpédégouine militant. On me fait confiance, je suis prise au sérieux. Ma sexualité n’est plus seulement mon intimité, elle devient politique. Mon entourage s’étoffe à mesure que mes convictions se renforcent. Mes lectures, les conférences, les ateliers à la Mut’, les projections, m’aident à comprendre. J’apprends ce que c’est, « ne pas être une femme[4] ». Je prends conscience : c’était ça ma vie d’ « avant ». J’ai la haine. Le milieu hétérosexuel est mon carcan, je le fuis, quitte à virer certain.es relations. Je ne fréquente quasi plus de mecs straight, je les évite, je refuse tout débat avec eux : je n’ai pas vocation à les changer. Pourtant…
Il y a deux semaines, je retourne à Nantes. Là, je pige que rien ne change. Mes ami.es proches le restent, parce que pour la plupart radicalement féministes. Mais les autres :
Vous me foutez un mal de bide.

« Filer de la came à une meuf pour profiter d’elle après : c’est punk. »
Culture « punk », culture « freak », culture poubelle. Le milieu « punk » nantais c’est pour quelqu’un.es la haine de vivre et la haine des autres. Dans un petit cercle d’after, ou au plus grand jour sur Facebook.
Sous couvert d’une marginalité sociale—par ailleurs questionnable—la haine et l’insulte sont admises. Et parce que ces punks sont marginaux, ils peuvent rire de tout : les mots (et la violence) sont normalisés. Les pédés, les lesbiennes, les vegans, en prennent pour leur grade. Les « trans » qui sont pour eux des « trav », ne sortent pas de chez elles.eux. I.elles n’existent pas.
Dire « sale pédé » : c’est punk.
Servir, banaliser la culture du viol : c’est punk.
Se tatouer une croix gammée sur le bras : c’est punk.
Dire « connard de vegan » : c’est punk.
Abuser de meufs défoncées : c’est punk.
Filer de la came à une meuf pour profiter d’elle après : c’est punk.
A contrario : les meufs qui se maquillent mieux que Kim K, celles qui baisent plus que les mecs et qui en parlent d’une voix franche et forte : Anathème. Toutes des salopes. Excommuniées. On les taille par derrière. Par devant, on a la queue bien basse, entre les pattes.
À croire qu’on manque encore d’exemples—combien en faudra-t-il encore ? Laisser une meuf à l’agonie ivre morte dans la rue à 3h dum’, rire d’elle : punk. Admettre dans une soirée un type—ou 2, ou 3—dont les coups sur sa meuf sont notoires : punk.
Traiter un mec de pédé, ça n’engage pas que sa sexualité. Ça engage surtout sa virilité, et parfois sa force intellectuelle et/ou physique. En revanche, les lesbiennes comme moi, on les aime bien. On les aime bien, pourquoi ? « Parce que c’est les lesbiennes, après tout, c’est comme un mec, on peut parler de meufs et de cul devant elles ».
J’compte plus les fois où le rapprochement se fait. À force, tu prends le pli. Tu lâches un sourire gêné et puis, tu passes à autre chose. Les hétéros continuent de s’étonner de notre communautarisme, de mon radicalisme. Ces mecs-là, ce sont les mêmes qui pointent du doigts les freaks, qui s’habillent comme des pédales, mais qu’ils singent en soirée, sous prétexte de se déguiser.
Mais là, maintenant, j’arrive plus.

Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que je suis bien incapable de leur ressembler. En revanche, j’ai qu’une hâte, c’est que nous, les sales pédés et les grosses gouines, on continue de baiser avec amour et respect vos meufs et vos mecs, quand, vous, lesdits punks, vous n’aurez plus la force de rien. Et surtout, que vous commenciez à baiser entre vous, dans l’ombre. Vous portez le costume blanc du mec cis, parfois même petit bourgeois : vous combinez tous les privilèges, revendiquant haut et fort une marginalité. Mais la vraie marginalité, vous lui crachez dessus.
Alors écoutez-moi bien vous, les nouveaux misogynes, vous, les nouveaux antisémites : vos privilèges sont périmés. Aucun d’entre vous n’a eu la grandeur de les mettre au profit de nos luttes.
« L’underground n’est pas un mec blanc, cisgenre et hétéro qui joue du Noise dans une cave »[5].
L’underground n’est pas un mec blanc, cisgenre et hétéro qui prend de la coke du jeudi au lundi et trompe—ou tabasse—sa meuf, et ne s’en sent plus pisser de pouvoir.
L’underground n’est pas un mec blanc, cisgenre et hétéro qui se révolte à coup de « sale pédé » sur Internet.
Vous êtes devenus ce contre quoi le punk s’est révolté.
Heureusement, tous ne sont pas comme ça, ou beaucoup le seront, une brève partie de leurs vies. Heureusement encore, y’a des punks, qui ont compris, que l’inclusivité dans ce genre de milieu, c’est carrément jouable. I.elles se reconnaîtront.
Par Laura D.
Revu par Alice W.

***
[1] Voir : https://teenagemenopause.bandcamp.com/track/parmi-les-chiens
[2] Nathalie Sarraute, entretien avec A. Finch et D. Kelley, « Propos sur la technique du roman », in French Studies, n°3, vol. XXXIX, juil. 1985, pp. 306-307.
[3] https://www.cairn.info/revue-multitudes-2010-3-page-40.htm
[4] https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2003-2-page-97.htm
[5] Merci à Paul-Alexandre Islas @u.r.a.m.i pour ce post IG du 30/10/2017.