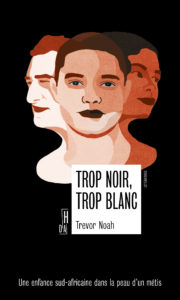Cet article concerne le travail sexuel librement consenti, entre personnes majeures, à dissocier de l’esclavage sexuel et de la traite des êtres humains, contre lesquels il est indispensable de lutter. Les personnes interrogées ne représentent pas la réalité de toustes les travailleur.euse.s du sexe. Elles parlent de leurs vécus, en tant que blanches, privilégiées et disposant de papiers. Elles ne sont pas représentatives de toustes personnes exerçant cette activité. Chaque travailleur.euse du sexe a son histoire, son parcours, hétéroclites, et tous sont légitimes. Il y a une urgence qu’iels se réapproprient elleux-mêmes leurs discours et fassent entendre leurs voix. Place à la parole des concerné.es.
Pourquoi dans une société coincée du cul, le travail sexuel est-il si mal vu ? Le considérer comme du viol tarifé n’est-il pas perpétuer les violences contre lesquelles les féministes sont supposé.es lutter ? Les raisons pour faire du sexe consenti sont multiples et dépassent le désir brut, volcanique, explosif. Et oui, baiser pour de l’argent pourrait même délimiter au mieux notre consentement. Le travail sexuel permettrait d’établir un cadre rarement discuté lors d’une rencontre d’un samedi soir bouré.e. Puis merde, chacun.e fait bien ce qu’iel veut de ses parties génitales, que ce soit par désir ou non, bénévolement ou non, par plaisir ou non.
Depuis plusieurs mois, je rencontre des travailleureuses du sexe en les questionnant sur leur rapport au consentement à travers leur travail. En octobre 2020, j’ai rencontré Klou, travailleuse du sexe à Bruxelles, mais pas que. Elle est également l’autrice de Bagarre érotique, une BD pro-pute. Tel un cheval de Troie, elle déclare la guerre au patriarcat. Fière et vénère, entre fascination et dégoût, elle est prête à brûler ce vieux monde. « La honte doit changer de camps. »
Je la rencontre dans son appart à Etterbeek, ce matin elle ne travaille pas, elle traîne chez elle, une clope au bec accompagnée d’un café noir. Loin des stéréotypes de Pretty Woman, elle porte des vêtements déchirés et décontractés. Un sourire en coin et sa boule de poil rousse à ses côtés, elle se lance, aussi enthousiaste que révoltée, dans une déconstruction des clichés. « Ce qui est relou c’est le capitalisme, le vrai problème c’est de devoir travailler ! Il faut sortir de l’image des putes qui ont plein de fric. » Elle restera toujours une prolétaire anti-système et a commencé le travail sexuel à cause de galères financières. Elle se roule une clope et l’allume. « On est grave des anarchistes dans notre façon de travailler, quand t’es pute t’es d’office anti-capitaliste ! » Elle sait ce qu’elle dit et pourquoi elle le dit. Après avoir été objectifiée, hypersexualisée, utilisée, l’industrie du sexe est pour elle aussi un renversement de pouvoir. Elle nous rappelle que la sexualité avec des hommes cis hétéro peut être dangereuse, monnayée ou non. Et au passage, elle peut aussi être très ennuyeuse.
« Baiser que des mecs pour du fric c’est un peu un moyen de se faire rembourser le patriarcat ! »
« Baiser que des mecs pour du fric c’est un peu un moyen de se faire rembourser le patriarcat ! » Anarchopute et anti-travail, Klou représente tout ce que ce système de domination voudrait abolir. En opposition à la femme hétérosexuelle réservée à son mari, pute et gouine, elle ne compte plus ses relations sexuelles. Elle s’en fout, fait ce qu’elle veut de son cul. Tout en se resservant du café, elle m’explique ne pas comprendre pourquoi vendre du plaisir est vu comme un crime « alors que d’autres vendent des armes sans qu’on les fasse chier. » Finalement, il vaudrait mieux vendre des armes à l’étranger que faire bander ? Elle ajoute qu’elle est évidemment consentante lors de ses rapports sexuels tarifés et qu’elle désire l’argent des hommes qu’elles dénigrent tout autant. Il ne faut pas croire que c’est une passion de sucer des bites, mais c’est toujours mieux que d’avoir un patron qui pue de la gueule. Mais pour l’État, le plus grand proxénète de la planète, c’est plus acceptable de dormir dans la rue, d’exploiter de la main d’œuvre en Chine, d’être précarisé.e jusqu’à la mort, que d’être travailleureuse du sexe. Au fond, iels lui foutent la panique.
Pour la philosophe Judith Butler, experte dans les théories queer, le consentement des travailleureuses peut être un choix stratégique dans une liberté restreinte par la domination masculine. Cela représenterait une forme d’autonomie au sein du système patriarcal, bien que structurée par des contraintes économiques pour des femmes précaires. En gros, vendre son cul sous le règne patriarcal, c’est un peu comme lui faire une balayette par derrière alors qu’il nous court après. Forcée de vivre dans ce système et en attendant de le changer, Lola*, travailleuse du sexe à Bruxelles, blanche ayant ses papiers, a choisi de bouleverser le pouvoir. Énervée et exaspérée par toutes les fois où elle a fait l’amour bénévolement alors que c’était nul, où elle a simulé sans être payée, où elle a subi les violences des mecs cis hétéro sans revanche. Pour une fois, elle renverse cela. « C’est eux qui doivent payer, pour l’instant je ne ferai plus rien gratuitement ». Mais encore, dans cette perspective butlérienne, la diversité des pratiques dans l’industrie du sexe peut intégrer une part de désir ainsi qu’une part de consentement, l’un n’allant pas sans l’autre. Il ne faut pas forcément opposer les deux et sortir d’une pensée binaire. Honnêtement, qui couche réellement par pur désir ? Je vous vois les couples hétéros qui baisent alors que votre désir est aussi rare que le soleil en Belgique et tout aussi mou qu’une frite froide ramollie.
Après plusieurs rencontres, je comprends que le travail sexuel permet de poser un cadre et des limites indispensables qui font des travailleureuses du sexe des expert.es en consentement. Iels négocient les pratiques sexuelles, ce qu’iels veulent ou ne veulent pas faire, pré-négocient des conditions, un prix, une durée. Ce contrat, il est rarement abordé lors d’une rencontre alcoolisée dans un bar et souvent dépassé lorsque l’envie de faire plaisir à sa/son partenaire est en jeu. Les raisons pour faire l’amour sont plurielles et peuvent aussi être poussées par la curiosité voire par un ennui démesuré. Pour Osmose, travailleur du sexe depuis huit ans, nomade depuis quatre ans, écrivain.e, agenre et activiste virtuel, le cadre professionnel du travail sexuel lui permet de se sentir en sécurité dans sa sexualité. «J’ai subi de nombreuses agressions sexuelles où je n’arrivais pas à dire non et ça arrivait surtout hors travail, dans les relations où il y a du romantisme ou une possibilité d’attachement. » De plus, la recherche de plaisir est souvent la raison principale d’un rapport sexuel et ne nécessite pas forcément un désir fulgurant. Les relations charnelles d’Osmose se composent majoritairement de ses client.es, « ma façon d’exercer est professionnelle mais aussi personnelle. Je ne sépare pas les deux. Quand je suis avec un client, il y’a de l’amour dedans, du désir et souvent du plaisir. » Et puis surtout, les limites consenties du travail du sexe sont fixées et verbalisées, ce qui est rarement le cas lors d’un rapport « bénévole » où elles sont donc plus floues et plus facilement franchissables. Sans compter que l’attirance peut au contraire influencer le consentement, la pression étant plus forte, les attentes fort présentes, l’envie de faire plaisir à l’autre prenant le dessus sur notre clairvoyance.
Pour les putains qui travaillent via Internet et discutent au préalable avec leurs client.es, « Quels sont tes tabous ? » est généralement la première question que posent les client.es avant même de fixer un tarif ou un rendez-vous. Les tabous et limites sexuelles sont donc la base du sexe tarifé. Pourquoi ne pas s’en inspirer lorsque l’on va faire du sexe avec quelqu’un.e pour la première fois ? Ne faudrait-il pas normaliser le fait de parler de nos tabous, les rendre sexy et en faire un atout ? Le champ des possibles d’une sexualité consentie est infini. Et celleux qui ne fantasment que sur le missionnaire du samedi soir c’est OK. C’est aussi OK de faire du sexe à plusieurs, attaché.e, soumis.e, payé, tant que c’est consenti. Chacun.e choisit si iel consent ou non. Ce qui est violent, c’est de nier la capacité à consentir d’une personne.
« Tout le monde peut comprendre que l’on peut désirer très fort quelqu’un.e mais ne pas vouloir coucher avec. Genre la copine d’une pote qui nous excite mais que l’on ne veut pas baiser pour ne pas blesser notre pote » explique Klou avec évidence. Et inversement, faire du sexe consenti avec une personne sans la désirer, ne fait pas de cette personne un.e agresseur.euse. La différence entre un.e client.e et un.e agresseureuse est que le.a client.e respecte le contrat et l’agresseureuse pas. Basta. Ce n’est pas une question de désir. Est-ce clair, ou je dois faire un schéma ? Comme si les travailleureuses étaient prêt.es à se faire violer pour de la thune ou à « vendre leur corps ». D’ailleurs iels insistent là-dessus, iels ne partent pas avec une partie de corps en moins après une passe, c’est bien la preuve qu’iels ne sacrifient pas leur corps. Par contre, il est possible de désirer une personne mais de ne pas consentir à faire du sexe avec elle. C’est un viol, une pénétration sans consentement, ce que la société nous a appris à occulter. Il arrive même d’aimer quelqu’un.e et de se faire violer par cette personne.
Morgane Merteuil, explique dans son livre Libérez le féminisme ! que « Lorsqu’on n’attend pas autre chose d’une relation que de l’argent, cela permet que tout ce que l’on va pouvoir recevoir en plus apparaisse comme un bonus (complicité, échange, intimité). Dans la vie privée en revanche, parce que le désir sexuel implique souvent d’autres enjeux, il n’est pas rare de ressentir une certaine frustration, voire l’impression de s’être fait avoir. »
La confusion entre le désir et le consentement est grave bordel ! Assimiler de manière systémique le viol à la prostitution est violent pour toutes les personnes ayant été violées et d’autant plus pour les travailleureuses du sexe victimes de viols. C’est complètement minimiser un réel viol. Et cela délégitimise les réelles violences vécues par les travailleureuses, étant donné que selon cette logique débile, iels en subissent tout le temps, durant toutes leurs passes. De plus, responsabiliser et culpabiliser les travailleureuses du sexe d’avoir été violé.e.s, c’est les considérer comme responsables. Honteux. C’est encourager la culture du viol, responsabiliser les victimes et déculpabiliser l’agresseureuse. « Rappelons ce que le mouvement #metoo a permis de faire émerger au grand jour : les abus sexuels sont massifs et structurels. Ils touchent la population en général, travailleuse du sexe ou non. Ce que cela révèle est bien que l’ensemble de notre société est affecté par le sexisme, et cette réalité concerne toutes les femmes » explique une Tribune collective de 130 travailleuses et travailleurs du sexe, prostitué(e)s, escorts en activité ou retraité(e)s dans un article du Monde.
22% des femmes ont été violées en 2020 par leur partenaire selon Amnesty International. S’il y autant de violences dans le cadre conjugal hétérosexuel, ne devrait-on pas abolir l’hétéronormativité ? Klou ajoute avec sarcasme, « en vrai, proportionnellement y’a plus de meuf qui se sont fait violées dans le cadre du mariage que dans celui de la prostitution. Franchement on devrait toutes payer notre cul plutôt que de se faire passer la bague au doigt, c’est grave moins risqué ! » Le fait qu’il y ait des violences dans les relations hétérosexuelles tarifées et gratuites prouve que c’est bien de l’hétéronormativité que vient la violence. Et consentir sans désir est possible dans le cadre conjugal ainsi que dans le travail du sexe. C’est de l’hypocrisie de croire que le désir est présent dans toutes les relations sexuelles gratuites. Lola préfère de loin la puterie au mariage, « mieux vaut voir un client de temps en temps plutôt que d’avoir un mec cis H24 dans son salon. » La liberté avant l’hétéronormativité. Son intimité, elle ne la place pas dans le sexe. Tout compte fait, en fonction des identités, l’intime peut prendre forme sous de multiples facettes. Et réduire l’intimité à la sexualité, c’est une façon d’objectifier les personnes sexisées, comme si iels n’étaient rien d’autres que des culs.
« Parfois j’ai des orgasmes avec mes clients ! » Et ouais, Klou arrive parfois même à jouir. Quitte à être payée autant kiffer, non ? Elle m’explique que c’est assez mécanique, il suffit qu’ils appuient au bon endroit, qu’elle se détende et le tour est joué. Pas besoin de désir pour jouir ! Elle précise également qu’elle pratique un travail du sexe blanc et privilégié, qu’elle parle de son expérience de personne disposant de papiers, sans vouloir glamouriser ni encenser la puterie. Finalement, l’industrie du sexe met à mal l’hétérosexualité obligatoire blanche cisnormative en convergeant des sexualités hors amour, hors gratuité, hors famille, des migrant.es, des personnes trans, non-valides, gros.ses, gays, racisé.es, tout ce qui dérange la société. Chaque personne ne peut-elle pas décider pour elle-même quel degré de sacralité elle met dans son cul ? Et où, quand et comment elle place son intimité, avec qui et dans quel but ?
Des violences dans l’industrie du sexe, il y en a certes. Mais elles ne sont pas plus ou moins présentes que dans le reste de la société patriarcale. C’est l’hétérosexualité imposée qui est violente. Le racisme qui est violent. La xénophobie qui est violente. L’homophobie qui est violente. La transphobie, le validisme, l’enbyphobie, c’est le patriarcat qui est violent.
A mes yeux, les travailleureuses du sexe apparaissent comme étant les personnes les plus aptes à éduquer sexuellement les jeunes et moins jeunes. Iels sont des pro-du-cul, vont révolutionner nos approches et pratiques sexuelles et sont des queen du consentement. Les travailleureuses de rue se réapproprient et s’imposent dans l’espace public, iels peuvent être de bons conseils pour imposer le port du préservatif ou même se protéger contre des IST. Luttons ensemble avec ces expert.es pour une éducation et économie sexuelles les plus libres et égalitaires possibles. Arrêtons de les juger, de les infantiliser, de les victimiser, de les stigmatiser et donnons-leur des droits, la parole et acceptons finalement leur autodétermination. Arrêtons de confondre ce qu’iels font avec ce qu’iels sont.
« Je te jure que je regrette le temps où j’étais Putain, où j’étais désirée, adorée, léchée, aimée, RESPECTÉE et payée… Oui c’était le bon temps ! Personne ne se foutait de moi à l’époque… ça leur aurait coûté trop cher, à ces Messieurs, c’était DÉJÀ assez cher comme ça. Maintenant c’est gratuit, alors on pisse gaiement sur la loque qui s’est offerte, pauvre chose ! » Grisélidis Réal, travailleuse du sexe, écrivaine, artiste et peintre suisse, Mémoires de l’inachevé (1954-1993)