Dans Ne plus tomber (en amour), récit d’une dissidence affective, Majé nous fait part de sa désillusion quant aux relations amoureuses parce qu’elles la fragilisent. Elle décide de s’extraire des rapports amoureux pour ne plus ressentir la douleur de la rupture et ne plus tomber dans le piège de l’amour. Majé est une militante anarchiste et féministe qui signe ici un texte à la frontière entre la narration et le manifeste politique.
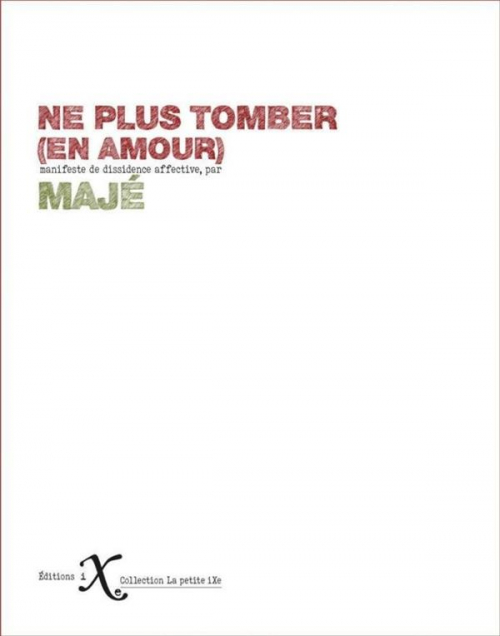
Dès son titre, « Ne plus tomber (en amour) » l’ouvrage insiste sur la chute. La parenthèse vient en expliquer la raison et renvoie à la métaphore traditionnelle tomber amoureux·se. L’annonce de l’idée d’un texte sur la dissidence affective, dans le sous-titre, associée au terme de « récit » le place quelque part entre la réflexion personnelle et l’essai politique. Si la lecture est facile et agréable, on peut s’interroger sur les postulats politiques qui nourrissent la réflexion de l’autrice. Son positionnement est clair, elle évoque d’ailleurs sa participation en 2004 à un événement de la Fédération Anarchiste et les biais qui traversent l’œuvre ne sont peut-être pas étrangers aux faisceaux idéologiques qui innervent les mouvements autonomes.
D’emblée, on peut se poser la question de la volonté de partir d’une idée aussi radicale que celle de détruire l’amour quand on aurait pu imaginer détruire le couple, ou, mieux, les formes de sociabilité hétéronormées et hétéronormatives. Les critiques féministes de la reconduction de l’idéologie amoureuse sont évoquées en fin d’ouvrage mais n’apparaissent qu’au terme de la réflexion, alors qu’il nous semble qu’elles devraient en être à l’origine. « De nombreuses critiques queers/féministes attaquent cette conception de l’amour pour le réinventer sans plus l’inféoder au patriarcat, en hijackant la contrainte à l’hétérosexualité, en brouillant les normes du genre jusque dans l’intime, pour imaginer des relations hétérosexuelles féministes et émancipatrices. » peut-on lire à la fin de l’ouvrage (p.75). Or il nous semble clair, d’une part, que les questions queers autour des relations amoureuses ne les envisagent pas que sous le prisme de l’hétérosexualité et d’autre part qu’il aurait fallu partir de là pour justifier de rejeter la relation amoureuse dans son ensemble.
Il semblerait que ce soit en raison de sa capacité à fragiliser les individus, ou à la fragiliser, elle, que l’autrice rejette l’idée même d’amour. Majé écrit : « La douleur immense de la rupture vaut-elle ça ? », en somme le jeu en vaut-il la chandelle ? Mais l’expérience de la perte n’est pas seulement liée à la perte amoureuse ou au chagrin d’amour. C’est l’expérience d’une rupture amicale, c’est l’expérience du deuil. Pourquoi renoncer à l’énergie positive que génèrent les différentes formes d’attachement ?
On peut s’interroger sur le choix d’une forme de critique généralisante et radicale qui s’exprime dans l’usage des présents de vérité générale par exemple ou l’emploi de termes très forts (on peut lire, page 29 les mots « exclusion » ou « ostracisme » pour désigner le rapport aux autres de celleux engagé·es dans une relation amoureuse). L’idée d’exclusivité de l’amour semble nier la possibilité de ressentir de l’amour pour plusieurs personnes (indépendamment ou pas des relations polyamoureuses d’ailleurs). Or l’amour n’est pas nécessairement la relation au sein du couple et ne s’inscrit pas nécessairement dans des rapports de domination. Les principaux problèmes mis en avant concernant l’amour sont la douleur de la perte, l’expérience de la jalousie et le rapport de possession. Mais ne peut-on pas, en renouvelant les formes de sociabilité et la conception de l’attachement envisager un amour libéré de ces problématiques? Si l’on peut dire que chaque couple a des problèmes qui lui sont propres, qu’il soit hétéro ou homosexuel d’ailleurs, ne peut-on pas dire qu’en réalité ce sont toutes les relations interpersonnelles qui exigent de remettre en question ses propres conceptions et croyances ?
Le texte mériterait donc d’interroger davantage les liens, l’égalité presque, entre le sexe et l’amour. Par exemple, dans les sexualités et sociabilités pédées cette équation ne va pas du tout de soi. L’évocation de l’ocytocine sécrétée pendant l’acte sexuel comme hormone de l’attachement (p.38) noue immanquablement la relation sexuelle à la relation amoureuse. L’autrice évoque bien, cela dit, une « perspective d’anarchie relationnelle – sans chercher à définir, classer ou hiérarchiser ce qui nous relie aux autres. Sauf que dans les milieux queers/féministes, le terme a pris le sens de relation amoureuse : c’est ce qui est sous-entendu quand on parle de « relations libres » ou qu’on utilise le néologisme « relationner ». » Il apparaît qu’il y a ici un autre présupposé politique, un angle mort de la réflexion, notamment dans le fait d’aborder les perspectives queers et féministes dans un même mouvement. La question de la dissidence identitaire puis sexuelle qui traverse les réflexions des mouvements, surtout gays, depuis les années 70 au moins, liant les cadres politiques du militantisme traditionnels et les cadres sociaux de la sexualité. Il est bien question dans le texte de « partager du sexe et de l’intime » ou d’« amitié sexuelle » (p. 68) par exemple mais on ne se départit pas de l’impression d’une hypocrisie qui consisterait à ne pas voir le sexe comme une quête d’autre chose que l’on devrait abandonner car inhérent à la relation amoureuse ou étant la porte d’entrée vers des sentiments amoureux.
L’autrice parle également du terme de lien qu’elle préfère à celui de relation et utilise également la notion d’apparenté·es (« je pense que ça vaut le coup de prendre le temps d’identifier nos figures d’attachement parmi nos ami·es ou apparenté·es…» p.51). La notion d’apparentement désigne, dans le dictionnaire, « le fait de s’unir ou d’être uni par des liens de parenté à une famille ou à une classe sociale » et métaphoriquement d’« avoir des liens communs avec quelque chose ». La question de l’apparentement suggère une connivence qui est la base de l’amour, me semble-t-il. Y faire référence peut apparaître judicieux dans la mesure où cette connivence renvoie à la tendresse même que l’on peut expérimenter en dehors de la relation amoureuse, voire de la relation de couple. Mais n’est-ce pas déjà de l’amour ? On aurait aimé que soient plus et mieux envisager les formes d’amour affranchies du couple monogame et de la famille. La confusion est trop grande pour nous entre l’évocation d’une forme d’attachement et le rejet radical de l’amour. En somme, de quoi parle-t-on exactement ?
L’autrice écrit dans la première partie de l’ouvrage : « J’ai cessé d’y croire » (p.41) et c’est sans doute le signe que l’ouvrage est une réflexion personnelle (ce que semble indiquer le sous-titre « récit ») plutôt qu’un texte de dissidence, qu’elle soit affective ou politique. À la fin de l’ouvrage, elle revient sur cette idée qu’il ne faut pas réinventer l’amour comme le prônent de nombreux·ses penseureuses queers et féministes mais le détruire. Toutefois, à la lecture, il nous est difficile de saisir la différence, car on ne peut nier que les relations fondées sur un attachement profond relèvent de l’amour, mais on concèdera qu’il ne s’agit peut-être pas de l’amour au sens traditionnel et romantique (celui des téléfilms, en somme).
Enfin, au-delà de la paronomase, l’enjeu politique du lien entre l’amour et la mort peut être dangereux. Si ce parallèle semble inscrit dans le langage, y faire référence, notamment aux derniers mots de l’ouvrage qui reprennent un célèbre slogan d’Act up (Silence = mort), peut sembler déplacé à ceux qui ont lutté pour leur survie contre un virus et une maladie qui a décimé leurs rangs. Justement, ce sont les gays qui ont réinventé l’amour, parce qu’ils n’avaient pas le choix. Les pédés méritent mieux pour conclure qu’une référence quasi métaphorique à un slogan qui renvoie à l’épidémie de VIH/SIDA.

