Charlotte Bonnefon publie ce 3 janvier, aux éditions Cambourakis, Nos invisibles, un livre faits de fragments, de courts poèmes en prose qui évoque celles dont on ne parle pas. Le livre retrace les parcours de femmes, celles d’Hassi Massaoud qui ont subi des attaques violentes suite à l’appel d’un imam intégriste les accusant d’immoralité. C’est en lisant un article sur ces violences et en voyant une photo dans le journal que Charlotte Bonnefon s’est lancée dans ce projet d’écriture. Il en résulte un livre à la poésie minérale et solaire qui dévoile autant qu’il tait les trajectoires de femmes sur lesquelles s’exercent les violences patriarcales.
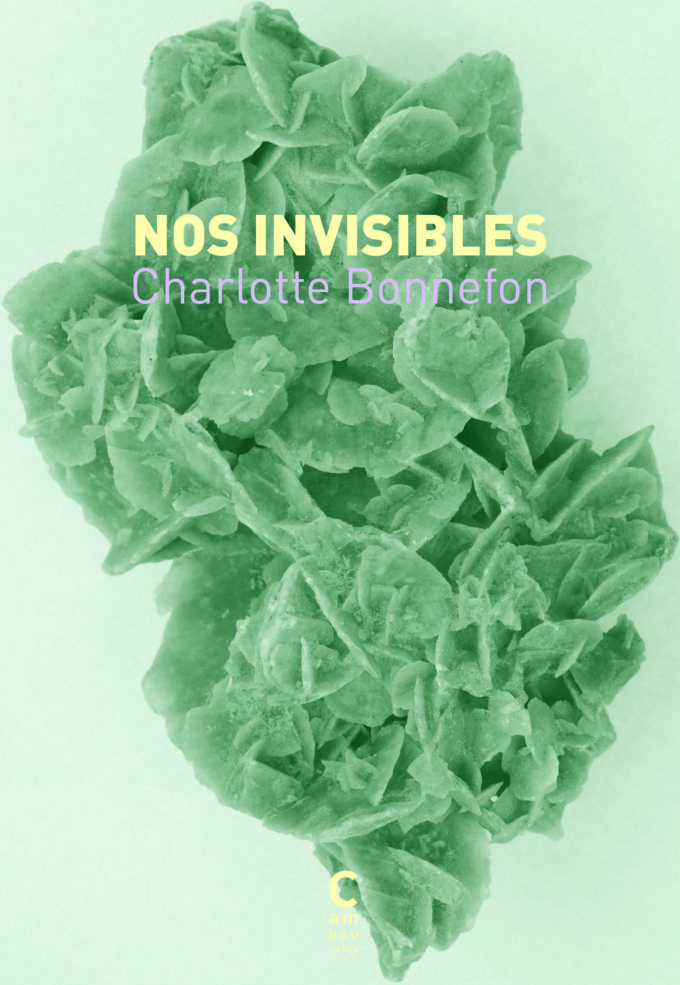
Les femmes d’Hassi Messaoud mais pas seulement : « Nos invisibles, c’est tout ce qui nous porte, qui agit en nous, que ce soit issu de notre expérience personnelle ou d’expériences partagées ou des choses qui peuvent être très lointaines mais qui résonnent avec notre histoire, notre sensibilité. » nous explique Charlotte Bonnefon. Il s’agit ici de « traverser la mobilité familiale » écrit l’autrice dans le recueil.
Le mouvement est omniprésent dans le texte, du début à la fin. C’est d’abord la mobilité de ces femmes, veuves, divorcées ou répudiées et qui se rendent à Hassi Messaoud pour travailler. Ces femmes, dans une extrême fragilité économique, se retrouvent à tout quitter pour chercher du travail dans la ville algérienne où se sont installées de nombreuses entreprises pétrolières qui offrent du travail à celles et ceux qui n’en ont pas. « Elles sont obligées de faire des choix personnels qui relèvent du sacrifice, et d’aller dans ce désert pour travailler dans des conditions qui sont pas toujours faciles. Elles sont obligées d’être dans une forme d’endurance, jusqu’à pouvoir un jour revenir. » Il y a donc la mobilité des femmes d’Hassi Messaoud mais Charlotte Bonnefon, en faisant ce travail d’écriture, se situe aussi et interroge les liens avec la mobilité de sa propre famille sachant qu’une partie de sa famille a quitté l’Espagne à la fin du XIXe s. pour vivre dans les environs de Oran. Il se dégage une grande chaleur des textes de Charlotte Bonnefon, quelque chose de minéral qui évoque le climat du bassin méditerranéen. « La mobilité, c’était aussi une manière de parler de la fragilité des femmes… Des mobilités géographiques, économiques mais symboliques aussi, d’un trajet qu’on fait aussi soi-même pour faire émerger des voix ou sa propre voix. »
Ces récits intimes entretiennent des liens forts avec le collectif qui apparaît dès le titre du pluriel, double, Nos invisibles avec ce substantif au pluriel mais également le déterminant possessif de première personne du pluriel. Justement, ce collectif transparaît dans l’usage des pronoms tout au long du texte : on passe de elles à je et à elle au singulier. La trajectoire personnelle s’inscrit dans l’histoire collective. « Il y a une forme de brouillage des identités et des frontières entre ce qui peut relever d’une histoire personnelle et ce qui relève, pas forcément d’histoires collectives, mais de différentes solitudes qui ont des motifs communs et qui résonnent les unes avec les autres. »
Les lecteurs·trices sont englobé·es dans ce collectif, notamment par le choix d’une écriture fragmentaire qui laisse des blancs, du silence et qui amène à faire résonance avec sa propre histoire dans la lecture selon les fragments et selon les moments. Il y a des enjeux de mise en page, aussi, comme si les blancs du texte étaient aussi parlants que le texte lui-même dans la mesure où ils nous laissent, à nous lecteurs·trices une grande liberté. « Ça laisse les phrases en suspens, comme s’il y avait un cheminement possible. Je pense que c’est un livre que l’on peut lire dans la continuité, mais c’est un livre que l’on peut lire comme un livre de poésie en allant piocher à différents endroits. » Ces fragments fonctionnent aussi comme des images, comme pourrait l’être une photographie. C’est une écriture de l’instantané qui donne à voir des moments de vies. « On entre dans l’image par les mots et quelque chose rayonne ou s’amplifie dans l’imaginaire des lecteurs et des lectrices. » Chaque blanc du texte est une respiration qui permet de passer au fragment suivant tout en laissant libre court à l’imaginaire des lecteurs·trices.
La question générique est difficile. À la question de savoir si elle l’a pensé comme un récit ou comme des instantanés photographiques, Charlotte Bonnefon nous explique qu’elle a d’abord pensé l’écriture d’un long poème en prose mais qui fait récit aussi en intégrant des parties beaucoup plus narratives. « La question du fragment était importante pour moi car j’avais l’image de quelqu’un qui circulerait dans une exposition où les œuvres se contaminent les unes les autres. » Il ne s’agit pas d’être dans un récit linéaire qui ne montre pas au lecteur, à la lectrice ce qu’il faut qu’il ou elle pense. C’est un texte dans lequel on navigue, tissant les liens entre les fragments qui nous parlent et résonnent en nous. Quand on lui demande comment elle qualifierait sa propre écriture, Charlotte Bonnefon revient sur l’idée d’une écriture de la sensation, quelque chose d’à la fois très physique et cinématographique : « presque du cinéma des mots ».
À la lecture, on ne peut pas ne pas penser à M. Wittig lorsqu’elle écrit : « Fais un effort pour te souvenir. Ou à défaut, invente. » : l’écriture vient ici combler les blancs de l’histoire. Au départ, il y avait l’envie d’écrire une pièce-paysage à la Gertrude Stein qui s’est peu à peu muée en une forme de documentaire par le travail de recherche qu’a fait l’autrice pendant le processus d’écriture. « J’avais une forme de résistance à être tout à fait dans le poème-documentaire et tous les documents ont finalement disparu et ont été soit retraduits soit réécrits. Il y a effectivement parfois des inventions dans les blancs, à partir de ces traces mais je ne voulais pas être dans une quête qui soit celle du réel, si tant est que le réel existe. »
Il y a des enjeux de visibilité très clairs en ce qui concerne les vécus de personnes aux prises avec des systèmes de domination patriarcaux et/ou coloniaux ou post-coloniaux. L’enjeu principal pour l’autrice étant de ne pas écrire « à la place de ». Il s’agissait de toujours rester à sa place tout en rendant sensible la manière dont elle se sent reliée à ces personnes et personnages pris dans des systèmes faits d’injustices nombreuses et de violence physique, morale, symbolique mais aussi sociale, politique et économique. Il y a dans le travail de Charlotte Bonnefon l’envie de dépasser les questions identitaires en essayant de voir ce qui fait qu’on est en lien les uns et les unes avec les autres. « L’écriture se situe à cet endroit, dans cette envie de lever les frontières, de les effacer. Je ne peux pas parler à la place des femmes qui ont été violentées à Hassi Messaoud ou à la place de n’importe qui d’autre mais je peux dire en quoi, pour moi, ça fait lien. »
Il y a quelque chose, dans ces fragments, qui amène à une sensation de communauté. C’est un livre à lire avec une forme d’attention flottante sans s’attendre à entrer dans une histoire, il faut se laisser porter, comme on se laisserait porter dans les salles d’une exposition de peinture, en voyant comme les choses se recomposent dans son imaginaire. « Il y avait vraiment cette idée paradoxale de laisser libre le lecteur, la lectrice. Je voulais que ce soit une forme de liberté ce livre. La main n’est pas toujours tenue et il faut faire sa propre déambulation dans ce qui a plusieurs facettes, au sein de zones multiples. Pour entrer dedans, il faut aimer la liberté. »
Reçois Friction dans ta boîte mail : abonne-toi à la newsletter

