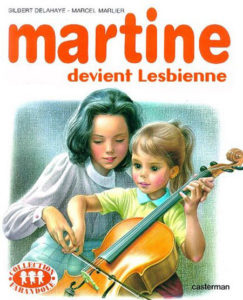Notre rédactrice Fanny s’intéresse aux objets et à leur charge symbolique. Dans cette rubrique, elle raconte l’influence qu’ont les objets sur nos modes de vie et surtout sur les systèmes de domination et d’oppression (en particulier liés au genre et à la sexualité) qu’ils alimentent. Dans ce quatrième volet, elle nous parle des toilettes.

Cet article se place en observation des sociétés occidentales, où les toilettes sont acquises, mais ce ne fut pas toujours le cas et cela ne l’est toujours pas dans beaucoup de pays. Il me semble important de commencer par un panorama spaciotemporel de cet objet.
Les toilettes modernes telles qu’on les connaît, dépendent de deux invention majeures : les égouts et la chasse d’eau. C’est notamment Thomas Crapper qui contribua à l’amélioration, dans les années 1880, du système de plomberie des toilettes. La forme que nous connaissons aujourd’hui à cet objet, n’a presque pas changé depuis les années 1920. D’abord fabriqués en bois, la porcelaine devint rapidement, pour des raisons de durabilité et d’hygiène, le matériau privilégié. Le XXe siècle vit cet objet questionné au regard d’enjeux esthétiques (les couvre sièges en tissu par exemple), sémantiques (Le Corbusier plaçant les toilettes au milieu des pièces de vie) ou techniques (les tentatives de Buckminster Fuller de créer des blocs combinant toilettes, lavabo et douche). Mais les toilettes gardèrent l’environnement qu’on leur connait : un bol de porcelaine blanche rehaussé d’une chasse d’eau et enraciné entre 4 murs d’intimité plus ou moins métaphorique.
Pourtant, cet objet, dans sa conception la plus simple, manque à 4,5 milliards de personnes à travers le monde, obligeant 892 millions de personnes à faire leur besoin à l’extérieur. Ce problème majeur permet de souligner à quel point les toilettes sont un dispositif invisible jusqu’à ce qu’il pose problème.
De nombreuses questions se rapportent à cet objet : Pourquoi les hommes urinent-ils debout et pourquoi ne rabaissent-ils pas la lunette ? Pourraient-ils faire leurs besoins assis ou les femmes pourraient-elles le faire debout ? Pourquoi la file d’attente chez les femmes est-elle plus longue ?
De l’espace privé à l’espace public, politiques des corps qui se vident
Les toilettes, telles que nous les connaissons, sont une invention de la modernité qui accompagne l’évolution de notre rapport à l’intimité : les latrines antiques, par exemple, témoignent d’un rapport à l’intime plus décontracté car ces grands ensemble (jusqu’à 80 places) étaient ouverts.
Elles sont accompagnées de quatre murs proposant une intimité relative et sont également raccordés à un système d’égouts qui s’étendent sous les villes. Les toilettes n’existent donc pas seules, elles créent des rapports au corps et à l’intimité propre à chaque dispositif sanitaire. Ce constat a questionné certains architectes, comme Buckmisnter Fuller, qui considère la maison comme « une buse décorée au bout d’un égout ». On peut considérer que « c’est l’espace où l’intérieur caché du corps entre en contact intime avec l’intérieur caché du bâtiment, deux systèmes de plomberie temporairement connectés » et qu’entrer dans les toilettes « ce n’est pas entrer dans la plus petite pièce d’un bâtiment, mais dans un espace de la taille d’une ville ». Cette construction architecturale témoigne d’un rapport culturel de la honte à nos déchets. Cette soupe d’urine, d’excréments, de sueur, de crachats, de mucosités, de pus, de vomissements, de sperme, de sang menstruel et de fluides vaginaux nous renvoie à « notre animalité et notre vulnérabilité à la mort et à la dégradation ». Nous nous cachons pour les produire puis les dissimulons sous terre pour les déplacer et les éliminer.
C’est plus particulièrement la manière dont nous produisons nos déchets dans l’espace public qui m’intéresse : Paul Preciado constate que les toilettes publiques sont « un espace de 1 × 1,5 mètres qui essaie de reproduire en miniature l’intimité de toilettes domestiques ». Néanmoins, il semble que l’on considère la dissimulation visuelle comme le premier facteur d’intimité, ne tenant souvent pas compte de l’intimité auditive et olfactive. Preciado note que « l’odeur et le son reste public tandis que la vision est privatisée ». Ce constat est très clair en Amérique du Nord, où les cabines de toilettes entament même l’intimité visuelle en imposant des pans de murs tronqués laissant apparaître pieds et têtes. L’intimité est réduite à son minimum et cela a des conséquences sanitaires importantes. La paruresis et la parcopresis, ou l’anxiété clinique liée au fait d’aller uriner ou déféquer en public, touche environ 20 millions de personnes aux États-Unis à différents degrés et 220 millions de personnes à travers le monde, selon Steve Soifer, du département du Travail social de l’université de Memphis et PDG de l’International Paruresis Association. Au Japon, certaines toilettes sont équipées de dispositifs sonore qui jouent le bruit d’un chasse d’eau : ce principe a été doucement nommé « Sound Princess ».
Dans son livre de 1976, The Bathroom, Alexander Kira explique que « la plupart de nos sentiments concernant le corps, le sexe, l’élimination, la vie privée et la propreté sont magnifiés dans ce contexte de “représentation publique” ». Il ajoute qu’en tant qu’utilisateur·ice·s de toilettes publiques, nous recherchons deux types de vie privée : « privacy for » et « privacy from ». Nous voulons la vie privée pour notre propre élimination et la vie privée de ceux qui font les leurs. Ainsi, nous mettons en place des règles de politesse qu’Erving Goffman nomme « inattention civile », c’est-à-dire que nous nous obligeons à ignorer la présence de l’autre pour reconstruire une forme d’intimité. Une étude de 1985, nommée Pendant ce temps-là dans les coulisses: les salles de bains publiques et l’ordre d’interaction, note que « ce ne sont pas les limites physiques, en tant que telles, qui définissent un espace comme une cabine de toilettes, mais la considération comportementale compte tenu de ces limites ». La notion d’intimité et de vie privée dans l’espace public concentre toute sa complexité dans les toilettes, comme peut le souligner l’œuvre de l’artiste italienne Monica Bonvicini, Don’t Miss a Sec, installée à l’extérieur de la galerie Tate Britain de Londres en 2003, qui prend la forme de toilettes publiques dont les murs sont faits de miroir sans tain : on peut donc faire ses besoins en voyant l’extérieur mais les passants ne nous voient pas. Cela produit chez les utilisateur·ice·s une dissonance vis-à-vis de leur intimité.
Uriner avec son genre
Au XXe siècle, les toilettes publiques, divisées en deux pièces distinctes, hommes et femmes, deviennent « de véritables cellules d’inspection qui autorisent l’évaluation de chaque corps au regard des codes de masculinité et de féminité ». Paul Preciado examine les toilettes comme une liste de binarités : public/privé, visible/invisible, décent/obscène, homme/femme, penis/vagin, debout/assis, occupé/libre. Il semblerait qu’alors que « la salle de bain des dames fonctionne comme un mini-panoptique dans lequel les femmes contrôlent collectivement leur degré de féminité hétérosexuelle […], la salle de bain de ces messieurs apparaît comme un terrain propice à la prise de pouvoir politique et à l’expérimentation sexuelle ».
En effet, Paul Preciado pose l’urinoir comme le centre névralgique d’une culture de la virilité, un dispositif de validation du genre. Il explique que « l’urinoir, une invention architecturale perturbante qui se développe hors du mur et s’adapte au corps, agit comme une prothèse de la masculinité, facilitant la posture verticale pour uriner sans éclaboussures. Pisser publiquement en se tenant debout est l’une des préférences constitutives de la société hétérosexuelle moderne. Ainsi, l’urinoir discret n’est pas tant un instrument d’hygiène qu’une technologie de genre qui participe à la production de la masculinité dans un espace public ». Cela nous permet de poser une première réponse à la question de la lunette des toilettes, invariablement levée : uriner debout, notamment dans un espace privé, n’est pas un enjeu d’hygiène ou de temps, mais bien de virilité, comme le montre l’invention de Barney Stinson, dans How I Met Your Mother : des toilettes dont la lunettes se lève automatiquement. S’asseoir pour uriner est donc associé à un comportement féminin ou de défécation.
Ainsi, le design des dispositifs sanitaires ne dépends plus seulement d’un besoin corporel mais bel et bien d’un discours corporel. Ce fut d’ailleurs le cœur du débat autour des Uritrottoir installés dans les rues de Paris durant l’été 2018 : un urinoir rouge et écologique qui en dit long sur la place qu’occupent les hommes dans l’espace public.
De l’autre côté du mur, on s’interroge sur la file d’attente devant les toilettes des femmes, toujours plus longue que devant celles des hommes. En effet, un sondage de YouGov en 2018 met en avant que 59 % des femmes disent faire la queue régulièrement pour aller aux toilettes contre 11 % des hommes.
Plusieurs facteurs permettent de répondre à cette question. Les femmes connaissent de plus nombreuses raisons de se rendre aux toilettes, ce qui les obligent à y retourner plus souvent : en plus d’uriner et déféquer, elles sont soumises à la gestion de leurs menstruations, parfois complexe à cause du manque d’équipements (point d’eaux, poubelles) mais aussi à la gestion de leur apparence. Julie Beck, dans un article pour The Atlantic, décrit les toilettes comme les « backstage of life » (coulisses de la vie) tandis que Rugen Owien, dans un article pour Libération, les désigne comme le lieu de « préparation au théâtre social ».
D’autre part, uriner est plus complexe pour une femme que pour un homme, ce dernier n’ayant qu’à ouvrir sa braguette, tandis que les femmes, en plus de devoir s’asseoir, doivent parfois s’accommoder de vêtements complexes à retirer/enfiler. Ainsi, malgré ces inégalités, les toilettes continuent d’être conçues comme deux pièces en miroir, comprenant le même nombre de cabines. Aux États-Unis, certain·e·s réclament le « potty parity », ou l’égalité à l’égard du nombre de cabines de toilettes. Il s’agit des équipement qui ne sont pas seulement égaux mais équitables. La ville de New York a, par exemple, adopté un projet de loi en 2005 qui oblige tous les nouveaux bars, arénas et salles de cinéma à présenter un ratio de 2 pour 1 d’étals pour femmes et pour hommes. De 1987 à 2006, 21 États ont promulgué une loi sur la « parité des pots ». Ces revendications soulignent les difficultés à allier des considérations techniques, architecturales, sociales et anatomiques.
Pictogramme de l’oppression
L’apparition de toilettes séparées date de la fin du XIXe siècle. Hormis quelques exceptions, (comme une installation de toilettes séparées temporaires lors d’un bal parisien en 1739), on considérait que les femmes n’avaient pas besoin d’uriner dans un espace public. Avec la révolution industrielle et la féminisation de certains secteurs de travail (notamment le textile), la question des toilettes séparées se pose réellement : les femmes doivent faire leurs besoins sur leur lieu de travail. Des enjeux moraux obligent à penser deux espaces distincts. Aux États-Unis, l’État du Massachusetts est le premier à adopter une loi exigeant cette séparation genrée en 1887. En 1920, plus de 40 États avaient adopté une législation similaire. Ces infrastructures perdurent jusqu’à nos jours, et de nombreux arguments continuent de justifier cette séparation. Selon Caroline Flint, députée au Parlement britannique, les toilettes neutres amèneraient une plus grande insécurité pour les femmes et une augmentation du nombre d’agressions. Pourtant, de nombreux lieux publics, notamment des bars et des restaurants ne disposent que d’une seule cabine de toilette mixte. Pourquoi l’espace se scinde-t-il donc automatiquement en deux au delà d’une certaine surface disponible ? Rugen Owien souligne que « la ségrégation de genre aux toilettes, lorsqu’elle existe, est sociale et rétrograde. Elle est soutenue par des normes d’obligation, de permission et d’interdiction dont l’existence est avérée par la peur, la gêne ou la honte qu’on ressent lorsqu’on essaie de s’y soustraire ». Erving Goffman corrobore cette hypothèse, dans son essai The Arrangement Between the Sexes, de 1977 : « Le fonctionnement des organes différenciés entre les sexes est impliqué, mais rien dans ce fonctionnement ne recommande biologiquement la ségrégation; cet arrangement est totalement une affaire culturelle ».
Pourtant, les toilettes genrées sont l’endroit de difficultés pour de nombreuses personnes. Où doit se diriger une personne transgenre ou non-binaire face à ces pictogrammes, une maman accompagnée de son fils, un papa accompagné de sa fille ou encore une personnes en situation de handicap accompagné d’un·e aidant·e ? Qui plus est, face à un pictogramme « toilettes pour handicapé·e·s », coincé entre un pictogramme féminin et un autre masculin, les personnes atteintes de handicaps doivent-elles en conclure qu’elles n’ont pas de genre ? La designeuse graphique Hélène Mourrier a produit un ensemble de pictogrammes alternatifs, permettant de proposer une plus grande diversité de genre mais aussi de genrer les personnes handicapées, dont le handicap ne doit pas monopoliser l’identité. Les cases constituées par les pictogrammes genrés créent des situations de rejet voire même de violence vis à vis des personnes qui se différencient de ces deux silhouettes figées sur la porte.
Ainsi, de nombreuses solutions proposées ne manquent pas de sens. Il est déjà intéressant de souligner que les toilettes sont les seuls lieux désignés, grâce à des pictogrammes, par leurs utilisateur·ice·s et non pas par leur fonction. Paul Preciado propose, par exemple, de s’intéresser à « si les personnes vont uriner ou déféquer, et si c’est le cas, s’il s’agit d’une diarrhée ? Personne ne s’intéresse à la couleur ou à la taille de la matière fécale ». Si l’on s’intéresse à des données anatomiques et non de genre, on peut, par exemple, proposer une séparation selon qu’on fasse ses besoins assis·e ou debout, ou encore selon le type de besoin (uriner /déféquer/changer de protection hygiénique/etc). On peut également imaginer qu’une seule et même grande pièce permette de subvenir à tous les besoins qu’importe le genre.
Cet article entrant dans une série d’articles consacrées aux enjeux liés au genre et aux objets du quotidien, je ne peux néanmoins occulter des enjeux intersectionnels : j’ai parlé de l’histoire, de l’architecture de ce lieu, mais il est nécessaire de rendre visible les personnes qui doivent, au quotidien, entretenir ces lieux, avec toutes les difficultés que cela comporte. Ces personnes sont majoritairement des femmes racisées, ce qui doit nous interroger sur notre rapport occidental à la notion de care qui, associée aux femmes dans la cadre privé, l’est aux femmes racisées lorsque cette notion est professionnalisée. C’est ainsi que les nounous, les femmes de ménages ou les aides à domiciles sont très souvent des personnes racisées. Nous devons questionner la manière dont les femmes blanches se sont émancipées des tâches qui incombaient à « la fée du logis » pour la transmettre à des employées racisées.
Références :
- Castricum Simona, « Public bathrooms are gender identity battlefields. What if we just do it right? », The Guardian, 3 octobre 2018.
- Paris Lees, « Fears around gender-neutral toilets are all in the mind », The Guardian, 2 décembre 2016.
- Owien Rugen, « Aux chiottes la discrimination sexuelle ! », Libération, 14 janvier 2016.
- Jennifer Weiner, « The Year of the Toilet », The New York Times, 22 décembre 2015.
- Paul Preciado, « Trashgender : urinate/defecate, masculine/feminine », The Funambulist, 13, septembre-octobre 2017.
- Joe Pinsker, « The Long Lines for Women’s Bathrooms Could Be Eliminated. Why Haven’t They Been? », The Atlantic, 23 janvier 2019.
- Julie Beck, « The Private Lives of Public Bathrooms », The Atlantic, 16 avril 2014.
- Anna Corbitt, « Bathroom bill’s affect people with disabilities », Paraquad, 30 mai 2016.
- Marni Sommer et Bethany Caruso, « Gender Equality Comes One Toilet At A Time », The Huffington Post, 19 novembre 2015.
- Matthew Smith, « Potty Parity: would it be fairer to make women’s toilets bigger ? », YouGov, 20 mars 2018.
- « The History of the Toilet », Old House Online, 29 juillet 2013.
- Lloyd Alter, « The History of the Bathroom Part 5: Alexander Kira and Designing For People, Not Plumbing », TreeHugger, 15 juillet 2011.
- Beatriz Colomina et Mark Wigley,, « Toilet Architecture : An Essay About the Most Psychosexually Charged Room In A Building », Pin-up Magazine, n° 23, automne hiver 2017/2018.
- Stephanie Pappas, « The Weird History of Gender-Segregated Bathrooms », Live Science, 9 mai 2016.
- Terry Kogan, « How did public bathrooms get to be separated by sex in the first place? », The Conversation, 27 mai 2016.