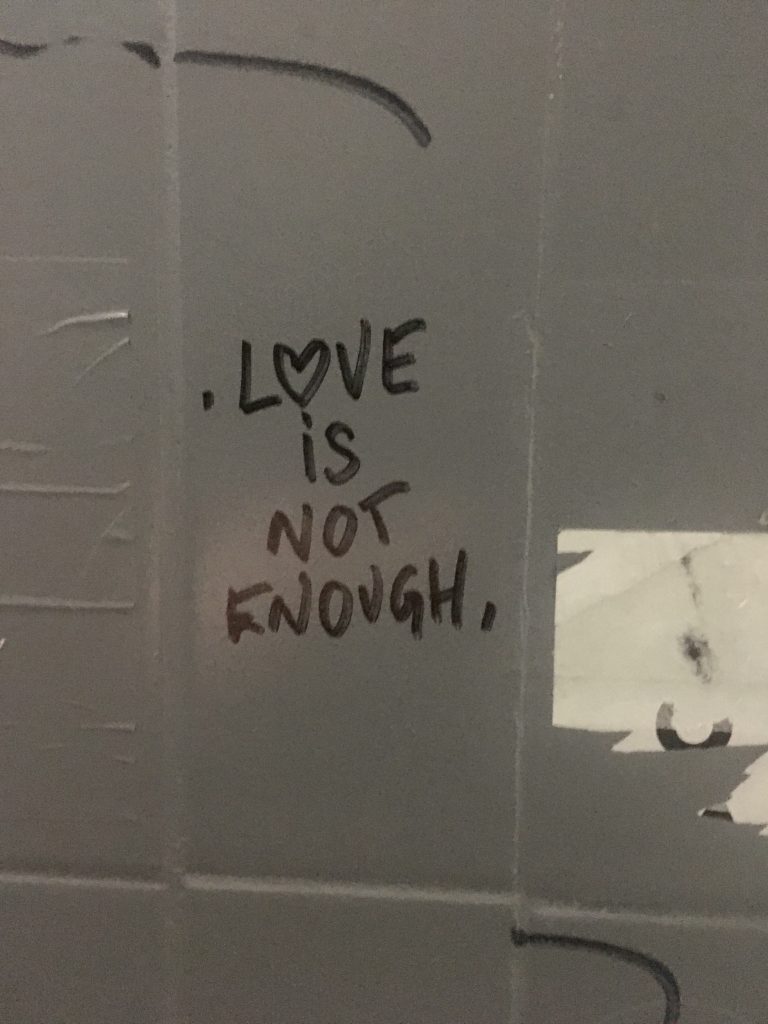
Pour me changer les idées et pour oublier Kamil, je me replonge dans le travail que je n’avais jamais terminé sur le début des années 80 dans le Marais. Je n’ai pas envie de raconter les années sida. C’est déjà fait. Tout le monde connaît ces histoires, et même s’il n’y aura jamais assez de lignes pour dire le traumatisme d’une communauté qui a perdu sa joie de vivre et sa naïveté dans les couloirs d’hôpitaux, ce qui m’intéresse, ce sont les mouvements d’avant, les battements du temps qui ont marqué le quartier avant que le sida n’arrive. Je suis consterné de voir qu’il n’y a personne pour me parler d’avant. Comme si l’épidémie avait jeté un voile sombre sur l’avant. Il n’y a rien eu avant, Achille, avant c’étaient les limbes. Peut-être qu’il n’y a rien eu de collectif, et cette idée m’effraie, je ne peux pas croire que les homos n’aient pas cherché à s’organiser collectivement avant. Il y a bien eu des conquêtes, non ? Des victoires ? Le sida a éclipsé toute la réalité sociale qui le précédait. A lui seul, il semble contenir l’histoire de l’homosexualité masculine moderne. Et c’est à travers lui qu’on la raconte. Je n’ai pas envie de tomber dans ce travers. Il est un facteur explicatif, il est une rupture, mais il n’est pas la totalité de l’histoire. Il y a eu quelque chose avant, et, je l’espère, quelque chose viendra après.
J’ai rencontré JP, un coiffeur de Montreuil qui semble être une source inépuisable d’anecdotes tordantes :
« Un jour, dans un club, le sosie de Stéphanie de Monaco, bourré, commence à emmerder la clientèle. Ça dégénère et le videur le met à la porte et lui interdit de revenir. Le lendemain, la vraie Stéphanie de Monaco vient dans le club, et le vigile la chope par les cheveux avant de la traîner pour la virer du club en lui aboyant dessus. Le soir même, Stéphanie de Monaco déposait plainte et faisait fermer le club. »
Impossible de savoir si ce qu’il dit est vrai, mais il y a dans nos entretiens quelque chose de ludique et de passionnant. Je le vois régulièrement, au salon de coiffure, dans des bars ou chez moi, et nous prisons parfois de la cocaïne alors qu’il laisse se dérouler son flot d’histoires drôles, dans le désordre, en mélangeant des noms et les dates, et mon dictaphone enregistre des heures. JP est une figure de mon quartier. Il est coiffeur dans des festivals, où il propose aux fêtards des coiffures hors normes.
Quand je marche dans le Marais, avec mes fringues froissées et ma coiffure ordinaire, je me sens sous le jugement. Il y a une sorte de violence de classe, une violence symbolique qui s’articule autour de la capacité ou non de faire croire à son appartenance à la caste des riches homos, qui s’habillent en haute couture et qui habitent les beaux quartiers. Ici aussi, l’appartenance de classe a un sens, l’identité gay ne l’efface pas, et je me demande si elle ne la renforce pas. Un jour, on me parle de ce patron de bar et de boites gays des années 80. On ne se souvient que de son surnom : Citizen Gay. Il faisait partie de cette génération d’entrepreneurs qui considéraient que les gays étant sortis du placard, il s’agissait maintenant de consommer, comme tout le monde. C’était une clientèle énorme, mal exploitée, avec un fort potentiel d’expansion, puisque le Marais drainait tout ce que la province hétérosexuelle rejetait. Chez lui se côtoyaient l’ouvrier de chez Citroën, le notaire et l’écrivain. A l’Insolite, dans le quartier Sainte-Anne, par exemple, l’entrée était gratuite. Si on le voulait, on pouvait passer la soirée sans consommer. On ne pouvait pas pour autant oublier qu’ici, comme ailleurs, il s’agissait de gagner du fric.
C’était une ode à la libre entreprise. David jouait au Monopoly, il refusait des saladiers de capotes, il jouait au parfait entrepreneur et ne voulait pas voir la lame de fond. On se faisait rentrer dedans dans les backrooms sans plastique, sans latex, dans la simple odeur des corps bruts. Certaines devenaient des boxons où s’agglutinaient tous les provinciaux venus passer leur weekend de baise. On baisait dans la pénombre et on retournait chez soi, à Reims, à Nantes où à Dijon. David était une grosse enflure de droite. Tout le monde le pensait, mais c’est lui qui avait le milieu. On dit le milieu, comme lorsqu’on parle de la mafia. Chez les militants, tout le monde écrivait contre lui, parfois sous pseudonyme pour pouvoir continuer à entrer dans l’un de ses saunas. Il avait une aversion pour la critique, il fallait être dans son camp ou disparaître. Quand le Megatown a ouvert, en 87, il fallait en être, à tout prix, ou alors le détester. L’ouverture du Megatown, c’était : choisis ton camp, mon vieux. Aujourd’hui, on croit que tout le monde était dans des associations, qu’il y avait une solidarité dans les rues et dans les boites, mais c’était avant tout un milieu de requins ou certains investissaient, et d’autres te voulaient du mal.
Au fil des entretiens, je découvre un monde terrible, un monde semblable, tout compte fait, au reste de l’humanité : la norme est dégueulasse, et c’est seulement dans certains recoins, à la marge, que les humains sont lumineux. La lumière, à l’époque, c’était l’action collective d’auto-défense. Contre les labos pharmaceutiques ou contre ceux qui laissaient les pédés crever du sida sans agir. Les récits des gars que je rencontre me pénètrent et me glacent les os.
Et Kamil m’obsède encore.

