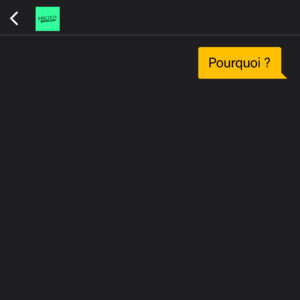Passer un vendredi soir dans un centre Paris Anim’ pour regarder un spectacle qui évoque le processus de guérison de deux jeunes lesbiennes en couple suite à une agression ? C’est ce qu’on a décidé de faire la semaine dernière en assistant à l’avant-première de Guérir (titre provisoire) de la compagnie Les Pieuvres. Un spectacle fort qu’on vous invite à aller voir vendredi 19 janvier au Théâtre de l’Œuvre. En attendant, on vous donne notre avis et on en discute (longuement) avec Jeanni Dura et Mille Zhong qui ont créé le spectacle.

Guérir (titre provisoire) est l’histoire d’un couple de jeunes danseuses victimes d’une agression sexuelle. Mais ce n’est pas tant la question de l’agression qui intéresse ici Jeanni Dura et Mille Zhong qui ont conçu et écrit le spectacle et qui interprètent les deux protagonistes. Ce qui est au centre ici, c’est l’après. Qu’advient-il de la relation une fois la violence subie ? Une fois que c’est dans la violence qu’on s’est retrouvées ? C’est sur l’évocation de cette violence au travers une séquence dansée hypnotique au son de « Je t’obéis » de Sexy Sushi que s’ouvre la pièce qui mêle théâtre et danse.
Le titre à l’infinitif renvoie à cette idée d’action pure, hors du temps. La guérison dans son déroulement, ce processus douloureux et sinueux. Le spectacle s’organise en une succession d’instantanés qui montrent le cheminement de ces deux femmes qui, elles le répètent à l’envi, n’y sont pour rien. Pourtant la culpabilité, pourtant l’impossibilité d’être ensemble. Si le cheminement est personnel et s’inscrit dans une lutte pour aller mieux (on se souviendra longtemps de la tirade de Mille Zhong sur ces choses qu’on fait pour aller bien et qui nous a franchement fait rire tant nous nous y sommes reconnu·es), la guérison dont il est question, c’est aussi celle de la relation. On aurait peut-être souhaité qu’il y ait plus d’ellipses dans ce parcours mais on comprend par cette succession de moments partagés que le chemin est long qui mène à l’apaisement. Et faut-il être apaisée ? Faut-il accepter ? Être en colère ? Changer ? Quel regard porter sur soi-même ? Sur l’autre ? C’est par la danse que le lien entre les corps se restaure peu à peu. C’est par les corps que va se recomposer la relation qui avait été détruite dans les corps.
On aurait peut-être préféré un peu plus d’unité de ton et on a pu être gêné·es par le très grand décalage entre les tirades du début très théâtrales et certaines répliques très orales et familières du dernier tiers du spectacle, même si l’on comprend l’intérêt de montrer ainsi que la violence informe également les structures langagières, peut-être qu’un peu plus de nuances aurait rendu le spectacle plus harmonieux. Mais c’est un spectacle jeune et nous avons eu la chance d’assister à son avant-première. Cette jeunesse et la vigueur des convictions sont ce qui, justement, contribue à faire de Guérir (titre provisoire) un spectacle à ce point touchant. On quitte la salle avec un peu plus d’espoir au creux du ventre. Dog days are over. Les mauvais jours peuvent finir par être derrière nous.

Pour commencer est-ce que vous pouvez présenter le collectif Les Pieuvres ?
Jeanni Dura et Mille Zhong : Le Collectif les Pieuvres est né à l’issue de la création de la pièce VIOLENTES, qu’on a monté d’abord dans un cadre de théâtre étudiant, puis qu’on a professionnalisé de plus en plus entre 2020 (l’année de la création), et 2022 où on a joué la dernière représentation.
Mais les Pieuvres se sont en réalité séparées il y a quelques semaines, en novembre 2023, et l’annonce »officielle » de la fin de ce collectif et du début de l’aventure de 88 mètres/seconde, la compagnie que nous créons toustes les deux, va bientôt avoir lieu.
Donc Guérir (titre provisoire) a commencé a être créé, par Mille et Jeanni, dans le cadre des Pieuvres, mais c’est aujourd’hui devenu la première création de 88 mètres/seconde.
Malgré tout, beaucoup de principes restent les mêmes entre les volontés artistiques des Pieuvres et celles de 88 mètres/seconde, et notamment la volonté de créer du théâtre queer et féministe, et l’insistance sur la co-création. Mais avec 88 mètres/seconde, on insiste plus sur le théâtre-danse, sur la pluridisciplinarité des artistes de la compagnie, et sur l’hybridité des formes. On a pour ambition de porter à la scène des voix singulières, des corps vibrants et des récits politiques. 88 mètres par seconde, c’est la vitesse de croisière des TGV, et pour nous, ça dit quelque chose d’un désir de vie et d’aventure, mais aussi de l’urgence de raconter et de jouer, de mettre en avant les narrations queer et notamment les récits lesbiens, avec des textes puissants et une physicalité intense.
Pourquoi avoir voulu évoquer les violences sexuelles subies par les couples de femmes lesbiennes ?
Parce que en tant que personnes assigné-es femmes, lesbienne et bi, on ressentait d’abord un très fort manque, un creux, dans la représentation – quelque soit le médium artistique, d’ailleurs – de nos corps et de nos histoires. Et puis, les rares histoires queer qu’on a eu l’occasion de voir au théâtre, c’était des récits de coming-in, des voyages intérieurs qui permettent à un-e personnage de se rendre compte de sa queerness. Dans cette catégorie, il y a l’incroyable Ceci est mon corps, d’Agathe Charnet, qui est un chef-d’œuvre du genre.
(Ou des récits de coming out, mais alors toujours sur le même modèle : la galère d’en parler à la famille, la galère d’en parler aux proches, le drame, les larmes, les dissymétries dans la relation au sujet du coming out, l’un-e qui est prêt-e, l’autre pas, et jamais comment ça se passe dans un couple en dehors de ça)
Mais nous, on a su qu’on était queer quand on était jeunes, et souvent ce qui arrive, dans les rares œuvres qui parlent de nous, les personnes sapphiques, c’est que le lesbianisme arrive à la fin du processus de coming-in, comme une solution à tous les problèmes du personnage qui se découvre lesbienne ou bi.
Et c’est pas que c’est pas vrai, que c’est pas d’une immense justesse, mais, disons, ce n’est pas tout à fait notre histoire. Nous on a su qu’on était queer jeunes, voire très jeunes, on a été dans des couples lesbiens jeunes, et le lesbianisme a beau être cet endroit de joie et de communauté qui est décrit à la fin de ces récits de coming-in, une fois qu’on sait qu’on est lesbienne, et qu’on date des personnes assigné-es femmes, il y a un autre type de violence lesbophobe qui commence à s’appliquer sur nos corps, et notamment des VSS très spécifiques (fétichistes, ou ‘’correctionnelles’’, par exemple).
Donc on voulait parler de ça. De l’après ce moment d’immense joie où on a trouvé son identité et sa famille, de tout ce qui reste à accomplir une fois qu’on en arrive là. Mais on voulait aussi que la solution, ça reste la même. C’est la joie queer et la famille choisie, la communauté, la tendresse radicale, le fait de s’appuyer les un-es sur les autres pour « se faire la courte échelle vers le verbe guérir » – c’est une citation d’un poème d’Amédine Sèdes, intitulé Eux ne savent pas, et qu’on cite souvent parce qu’il résonne énormément avec ce qu’on essaye de raconter, de faire sentir, dans la pièce.
La pièce s’intitule Guérir (titre provisoire). Est-ce que vous pouvez évoquer le sens de la parenthèse ?
La parenthèse est là parce que le travail est jamais fini.
[…] On laisse nos personnages dans un état très positif et qui ne fait que s’améliorer depuis quelques tableaux, mais qui pourrait encore s’améliorer. Le titre est provisoire parce que le « on a gagné » de la scène de fin, n’est pas encore complet. Le plus important pour nous, c’était de faire arriver les personnages à un endroit d’intimité plus grand que celui qu’elles avaient quand elles étaient en couple, un endroit où elles peuvent se dire qu’elles s’aiment, et aussi, de les faire arriver à dire toutes les deux « nous n’y sommes pour rien ». Mais avec un peu de chance, on peut imaginer qu’un an après le tableau de fin, elles vont encore mieux que ça, elles ont encore avancé dans le processus de guérison.
Et, bien entendu, il y a aussi les rechutes : on essaye d’en montrer, un peu, dans le temps qu’on a sur scène. Il y a des moments où on pense qu’on est arrivé, qu’on est « guéri-e » et qu’on galèrera plus jamais avec les traumatismes qu’on a subi, et puis une rechute arrive, et il faut remettre le travail sur le métier. Mais on ne voulait pas que ça soit une mauvaise nouvelle – on ne voulait pas que ça ressemble à une tragédie absurde où quoiqu’elles fassent les personnages en reviennent toujours au même point. Au contraire. On a essayé de raconter la guérison comme une spirale. On revisite peut-être les mêmes sujets ou les mêmes souvenirs encore et encore, mais on ne tourne pas en rond. A chaque fois c’est différent, à chaque fois, pourvu qu’on soit soutenu-e et accompagné-e correctement pour, on se libère encore un peu plus.
Comment surmonter le traumatisme des violences sexuelles et sexistes ?
On pourrait refaire la liste du personnage de Millepertuis dans la « Variation de la guérison n°9 »… Mais justement, il nous semble que ce qu’on essaye de dire c’est qu’il n’y a pas de recette précise, de liste hyper organisée de trucs à faire qui fait qu’au bout du chemin, hop on a bien fait toutes les activités, et on est guéri-e. Voire, que « surmonter » ce ne serait pas tout à fait le bon verbe, parce que ça semble mettre toute la responsabilité du fait d’aller mieux dans la seule force de volonté de la personne qui a subi un traumatisme.
Bien sûr, la thérapie, quel que soit le type de thérapie qui résonne le plus avec la personne, ça aide. Bien sûr, les groupes de paroles, les associations féministes, les actions légales, même, si on peut se le permettre, ça aide. Le soutien des proches, aussi, et tous les trucs plus ou moins absurdes, vus de l’extérieur, que la personne sent qu’elle a besoin de faire, ça aide.
Mais l’idée pour nous n’est pas de dire : voilà le protocole vers la guérison, suivez-le, et tout ira bien. Au contraire, c’est de montrer ce que tout ce processus-là peut avoir de bordélique – et pour la personne qui le vit, et pour les personnes qui l’entourent. Et de montrer comment les chemins de guérison ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Et que c’est OK. Parce qu’il y a aussi une manière, dans notre société, de demander aux victimes de se comporter, de parler de leur trauma, de guérir. Une manière socialement acceptable d’avoir vécu un traumatisme. On essaye de réfuter ça, dans la pièce.
En revanche, un truc dont on est plutôt convaincu-es, mais là on parle vraiment en notre nom – peut-être que ça ne fait pas consensus parmi les personnes qui ont vécu des VSS – c’est que la question du soutien extérieur est essentielle. Que peut-être : surmonter (pour de vrai, entièrement) c’est impossible, mais se reconstruire, c’est possible, pourvu qu’on ait autour de nous du soutien et du soin.
La métaphore la plus appropriée, ce serait celle du kintsugi. C’est cette pratique japonaise qui consiste à réparer des objets en poterie qui ont été cassés, en ressoudant les morceaux avec de l’or fondu. La métaphore est souvent utilisée en ne regardant que l’objet final pour dire « regarde ! regarde comme c’est beau alors que ça a été cassé ! ». En sous-texte, nous on lit « ton trauma t’a rendu-e plus fort-e ». Mais le vrai truc important, pour nous, c’est à nouveau le processus. Le pot a été cassé. Et il serait resté comme ça si une ou plusieurs personnes ne l’avaient pas assez aimé pour mettre des heures et des heures d’amour et de soin dans son processus de réparation. C’est pas son « trauma », sa cassure, qui l’a « rendu plus fort ». D’ailleurs il est peut être pas plus fort qu’avant, mais, oui il est réparé. Grâce à l’amour qu’il a reçu ensuite. Dans tous les sens du terme « amour », d’ailleurs. Ici la citation qu’on utilise tout le temps elle vient de Taliesin Jaffe, un acteur voix-off américain, qui dit « ce n’est pas la douleur qui fait les gens, c’est l’amour qui fait les gens. »

Le regard de l’autre tient une place importante dans la pièce. Pourquoi ?
On cite souvent cette phrase de Margaret Atwood, dans The Robber Bride, sur le male gaze, et la sensation qu’on ne peut absolument jamais y échapper, qu’on est, au minimum, « son propre voyeur, qui regarde par le trou de la serrure dans notre propre esprit ». Cette citation semble parler de la manière dont le patriarcat s’imprime sur les corps et les esprits des femmes hétéros, mais en réalité, on peut la prendre d’une manière beaucoup plus générale que ça.
C’est très menaçant, pour le patriarcat, le fait que les femmes (en tant que classe, ici, au sens que Monique Wittig donne au terme de femmes) puissent se désirer entres elles – et donc arrêter d’être des femmes, si on garde la définition de Wittig. Parce que ce désir indique que c’est possible de vivre sa vie sans être contrôlé-e par le « voyeur » permanent dont Atwood parle.
Or le male gaze est un outil de contrôle patriarcal très puissant, et donc, les personnes qui y sont plus immunisées que les autres, parce qu’elles ont d’autres objets de désir que les hommes cis et hétéros, sont ‘dangereuses’ pour le patriarcat.
(C’est là que viennent se loger les VSS spécifiques qui s’appliquent ou peuvent s’appliquer aux personnes sapphiques : d’une part, la fétichisation – c’est-à-dire, le retour du voyeur qui dit « même quand tu penses que tu es seul-e avec taon partenaire, et que tu es libre dans ton désir, ce désir s’adresse en réalité à un homme cis qui, en puissance, vous regarde ». C’est dans ce cadre là qu’une des catégories de porno mainstream les plus populaires c’est lesbiennes. D’autre part, la violence « correctionnelle’ » – c’est-à-dire tout comportement coercitif qui vise à faire rentrer les personnes queer en général, et sapphiques en particulier, dans le rang du patriarcat. Ça va du « simple » : « t’es lesbienne mais…. t’as bien déjà couché un mec ? ou y’a bien au moins un mec avec qui tu pourrais coucher? » aux thérapies de conversion ou encore à ce qu’on appelle un « viol correctif ».)
Mais donc, en ce qui concerne le regard, on voulait à la fois parler de la violence, du joug coercitif qu’est le male gaze, ou plutôt le regard patriarcal, parce que le personnage d’Orion parle surtout du regard d’une « elle », qu’on a souhaité nébuleux et protéiforme. Parce qu’il représente toutes les manières dont les femmes, certaines femmes, à certains moments, dans certaines situations, peuvent se faire les défenseuses des structures patriarcales. Et que ce qui nous importait le plus, c’était surtout de décrire cette sensation-là, de se sentir piégé-e dans le regard de quelqu’un et les exigences que ce regard représente, et l’impression d’être sans cesse en train de performer (de mettre un masque) la personne que tel ou tel regard voudrait qu’on soit. Ce qui implique qu’on ne sait plus vraiment qui on est, ou qu’on a jamais eu l’occasion de se poser la question.
Et donc, à ce regard patriarcal, féminin ou masculin, on voulait opposer une thématique qui nous semble centrale dans la culture queer, qui est d’être vu-e. Non pas regardé-e, surveillé-e, ou utilisé-e comme surface de projection d’exigences patriarcales (ou en l’occurrence ici, lesbophobes), mais réellement vu-e, et pris-e en compte pour qui on est réellement. Et ce regard-là, il doit se construire entre soi et soi, et aussi entre soi et l’autre. Parce que, même dans une relation queer, entre personnes queer, le regard patriarcal peut continuer à exister, ou alors, d’autres projections peuvent être mises en place. Dans ce qu’on raconte de ces personnages, par exemple, c’est qu’elles ont beaucoup utilisé l’autre comme surface de projection pour gérer des blessures ou des traumatismes antérieurs, et que ça aussi, ça a atteint la confiance qu’elles pouvaient placer l’une dans l’autre et dans leur relation.
Donc parmi les choses qu’elles ont à réparer, il y a le regard qu’elles posent l’une sur l’autre, et la manière dont elles reçoivent le regard de l’autre, lorsqu’il se pose sur elles. Il s’agit pour elles deux d’arriver à un endroit de confiance dans leur relation où elles peuvent accepter de se voir elles-mêmes, et de se laisser voir par l’autre. Une fois qu’elles ont atteint cette intimité, cette confiance-là, on peut faire le noir et les laisser continuer leur histoire en dehors du plateau.
Parlez-nous un peu de la pièce en tant que telle ? Comment l’avez-vous pensée ?
Comme on l’a un peu évoqué plus haut, on l’a pensée comme une spirale. On voulait que ça commence avec ce moment extrêmement dur dans la vie de ces personnages, ce traumatisme terrible qui aurait pu les tuer, mais, par chance pure, au début, elles survivent. Et ensuite, on voulait que ça soit comme une spirale vers de plus en plus de prise de liberté par rapport à ce souvenir traumatique commun, et par rapport à des souvenirs traumatiques plus profonds ou antérieurs à la rencontre des personnages. Une spirale, à nouveau parce que ça permet de repasser sur les mêmes questions plusieurs fois, depuis différents moments dans ce processus de guérison qui ne termine peut-être jamais.
Que la construction de la pièce refuse le désespoir, mais qu’elle rende justice à tous ces moments de rechute, toutes ces dates anniversaire où il arrive qu’alors qu’on se sent tout à fait ailleurs dans sa vie et dans son esprit, le corps se retrouve à retraverser le souvenir – mais avec plus de distance, ou dans un environnement qui, de fait, est un environnement où on est en sécurité, par exemple.
On voulait aussi tresser trois fils : le texte/la parole, le corps/la danse, et la respiration, que ce soit la nôtre sur scène, ou celle apportée par la présence des percussions live. On souhaitait que la pièce commence et que ces trois aspects soient parfaitement disjoints, et que petit à petit, au fur et à mesure que les personnages se reconstruisent, et guérissent, ces trois fils soient tressés de manière de plus en plus serrée. Ce qui, si on fait bien notre travail au plateau, donne un code de jeu qui va de plus en plus vers le naturalisme, parce que, dans la vie, ces trois aspects sont toujours liés : on parle, nos corps, bougent, on respire, de manière naturelle, sans y penser. Tout est toujours en mouvement.
Enfin, une des choses centrales dans notre travail, c’était de raconter la guérison non seulement des personnages, de Millepertuis et Orion, mais aussi de leur relation, qui est souvent symbolisée par Alissia Pervozvanski-Dangles, notre percussionniste. Il ne s’agit pas que de montrer le processus de reconstruction de chaque personnage, seule et en s’appuyant sur l’autre, mais aussi donc, de montrer comment la relation elle-même guérit pas à pas. Et comment parfois, lorsque la relation guérit plus vite que les personnages, ça peut mener à des rechutes, comme c’est le cas dans la scène de flashback du personnage d’Orion, par exemple.
Elle est à la frontière entre le théâtre et la danse ? Pourquoi avoir voulu mettre en jeu le corps dans la pièce à travers la danse ?
Oui, on essaye de se placer sur la ligne entre le théâtre, la danse, et la danse-théâtre, qui est encore une troisième discipline. La danse est venue assez naturellement dans le processus de création d’abord parce qu’on a toustes les deux une formation de danseureuses, et puis surtout, au départ, parce qu’on voulait l’utiliser pour raconter l’indicible du traumatisme. Pas tant dans le sens de « il y a des choses qui ne se disent pas », dans un sens de politesse ou de pudeur, mais vraiment dans le sens propre du terme. Il y a des sensations, des émotions, des histoires, qui ne peuvent pas se dire par les mots. C’est là que la danse entre en scène. Ca nous permettait aussi de nous donner une exigence d’écriture qui nous intéressait. Si un tableau peut être dansé et raconter exactement la même chose, alors les mots ne sont pas nécessaires. Donc si une scène jouée doit être écrite, elle doit avoir une valeur autre, dire et raconter autre chose, que ce que la danse peut raconter, et inversement. Si un tableau dansé peut correspondre à deux phrases de texte joué, alors il ne passe pas la barre de ce qu’on essaye de faire.
L’idée de la danse, c’était aussi d’insister sur la nature physique, voire physiologique, de ce que c’est qu’un traumatisme, et plus largement, de ce que c’est qu’une personne. On voulait d’abord raconter une guérison des corps, parce que, pour nous, c’est là que ça se joue. Dans le sens où on est toustes d’abord des corps matériels.
On peut comprendre comment nos traumatismes nous affectent, d’une manière très intellectuelle et être encore complètement empêtrés dans l’impact, la trace corporelle, qu’ils ont eu sur nous. Donc la présence de la danse est venue très vite.
Puis l’idée de faire de ces personnages des danseuses qui sont engagées sur le même spectacle nous permettait de, tableau par tableau, prendre la température d’où elles en sont, dans leur guérison personnelle et dans celle de leur relation. Et de raconter cette relation qui se reconstruit, la confiance et l’intimité qui peu à peu est récupérée, puis devient, par le biais du travail corporel qu’elles effectuent ensemble, plus grande que ce qu’elles avaient avant l’agression, quand elles étaient en couple.
Comment voulez-vous que les spectateurices reçoivent cette pièce ?
On espère que les spectateurices sortent de la pièce à la fois en ayant récupéré pour elleux quelque chose de cet amour, ce soin, cette tendresse radicale, cette joie queer qu’on évoquait plus haut – mais qu’iels sortent aussi avec un plein d’énergie pour la lutte, pour la suite, pour la vie. Quelque chose de l’ordre de ce que la rage – la rage de vivre – peut avoir de positif et de constructeur. C’est-à-dire pas l’envie de tout détruire, ou de se battre contre, mais au contraire de tout construire, et de se battre pour. Pour nos droits, et pour raconter nos histoires, dans un monde où, malgré les avancées réelles auxquelles on assiste, les histoires queers, les histoires féministes, ou « pire », les histoires qui sont les deux, sont encore trop peu autorisées à exister.
Quel regard portez-vous sur la création théâtrale actuelle ?
Pour ce qui est de la France, parce que c’est le paysage qu’on connaît le mieux, sans prétendre à une exhaustivité, on trouve que la création théâtrale est asymétrique. Le manque de moyens financiers et la violence politique actuelle touche tout le monde, mais donc ça ne fait que creuser l’écart entre les compagnies reconnues, subventionnées et programmées sans trop de prises de risque, et les compagnies dites émergentes, voire immergées, selon les mots de la Fédération des pirates, qui nous inspire beaucoup.
De la création théâtrale queer, féministe, il y en a, et à foison : on a cité Agathe Charnet, on peut bien sûr évoquer également Laurène Marx et son remarquable Pour un temps sois peu, Lucien Fradin avec Portraits Détaillés ou encore Rébecca Chaillon et la déflagration qu’est Carte Noire Nommée Désir, et qui vient, après le In d’Avignon, de passer à l’Odéon, théâtre national, et part en tournée internationale. La reconnaissance institutionnelle à laquelle accède ce magnifique spectacle est une porte entrebâillée pour la création queer féministe et racisée : mais les opportunités sont rares et on le sait, il faut lutter, sans relâche, pour être entendu-es, pour être payé-es, pour être reconnu-es. Ca nous donne beaucoup d’espoir, le succès de Carte Noire Nommée Désir, mais ça nous affecte aussi beaucoup, la violence qu’il peut susciter.
L’idée maintenant c’est de foutre le pied dans la porte et de ne plus laisser personne nous la fermer au nez. Et bien sûr, c’est une question de solidarité : la Fédération des pirates, la galère des jeunes compagnies, la galère de la création quand on subit des discriminations systémiques (qui – surprise ! – ne s’arrêtent pas au seuil du plateau ou des bureaux de programmation), c’est un combat qu’on mène avec des compagnies amies, avec des adelphes. Comme souvent, la réponse c’est la communauté : on chemine avec la compagnie Devant Nous, par exemple, menée par Mona Taïbi, avec les Adelphes de la Nuit, avec Anthony Martine et son renversant premier spectacle Un léger picotement au niveau de la nuque.
La création théâtrale actuelle est riche, et inventive, et exigeante, et nous voulons qu’elle le soit encore plus, et qu’une place encore plus grande soit donnée aux récits qu’on entend pas ou peu, aux corps qu’on ne voit pas ou peu : les histoires, les voix et les vies des personnes queers, féministes, racisées. On pousse aussi pour un décloisonnement entre les disciplines, pour plus de liberté dans l’hybridation des formes, ce qui n’est pas facile à faire reconnaître dans les dispositifs d’aides ou de soutien…
Parce que la création théâtrale actuelle est encore parfois bien sclérosée dans un théâtre bourgeois, consensuel, élitiste et fainéant, et qu’elle est là, la raison pour laquelle les théâtres sont toujours fréquentés par les mêmes catégories de population. On en a marre d’entendre et de voir encore et toujours les mêmes variations sur les mêmes histoires sur des grands plateaux avec des grands moyens. On veut que la création théâtrale puissante, radicale, innovante puisse elle aussi avoir les moyens de ses ambitions, avec toute la rigueur artistique et professionnelle que ça demande. Et on sait qu’on est légions, à être au rendez-vous pour ça.
Comment fait-on du théâtre queer et féministe ?
On pourrait encore faire une liste comme Millepertuis dans la « Variation de la guérison n°9 », mais on n’a pas de recette miracle. On sait juste comment on essaye, nous, de faire du théâtre queer et féministe. Et ça commence par regarder autour de nous : qui en a fait, qui en fait, de qui on a envie de porter l’héritage, qui nous inspire et nous donne joie et puissance. Mais aussi, qu’est-ce qui ne nous parle pas, qu’est-ce qui nous met en colère. Où sont les manques, où sont les trous, les creux, les ratés, qu’est-ce qui n’est pas dit, qui n’est pas montré, qui ne sonne pas juste pour nous. Qu’est-ce que nous, on a à dire et à raconter. On ne crée jamais seul-es, mais on crée aussi avec ce qu’on est : à partir de nos vécus, de nos mots, de nos observations.
On travaille avec des outils d’écriture de l’intime, et le principe de la parole située : on sait d’où on parle, sociologiquement et politiquement, et on sait aussi ce qu’on veut que nos personnages incarnent, les histoires qu’on veut leur faire traverser, et le public avec. Nous, au sein de 88 mètres/seconde, on fait du théâtre queer féministe en regardant autour de nous, dedans nous, et en travaillant avec une exigence accrue parce qu’on sait, qu’on va être jugé-es, qu’on va être étiqueté-es, qu’on va être scruté-es. On prend toute la colère que nous procure les dynamiques des violences systémiques et on l’injecte dans nos spectacles.
C’est aussi notre manière de militer : tous nos spectacles sont politiques par notre engagement à ce qu’ils le soient. Notre axe de travail, c’est les représentations : c’est travailler non seulement à de la visibilité des paroles et des corps, mais aussi à complexifier ces récits queers et féministes, à densifier le tissu des expériences dans lesquelles on peut se retrouver, s’identifier, trouver des réponses, se protéger ou se prendre des baffes. On fait aussi du théâtre queer et féministe en ne cédant pas à la facilité, à l’attendu, en étant queer au sens révolutionnaire, en étant féministe au sens radical, en se dérobant à la bienséance. On fait du théâtre queer et féministe en luttant, entre autres, pour réussir à en vivre.