Dans mes errances internet, en cherchant quelque chose de nouveau à lire, j’ai entendu parler de Journal sexuel d’un garçon d’aujourd’hui, écrit par Arthur Dreyfus et sorti en ce mois de mars. Il ne s’agit pas de son premier roman, loin de là, puisqu’il a publié de nombreux textes auparavant, y compris en tant que journaliste.
Jusque-là, l’idée de lire 2294 pages de la vie sexuelle de n’importe quelle personne ne m’attire pas forcément, je dois l’admettre… Bien que j’aime comprendre la vie sexuelle potentiellement flamboyante des personnes queers. Et pourtant, ma curiosité a été vraiment piquée lorsque je suis tombé sur des extraits dudit ouvrage.
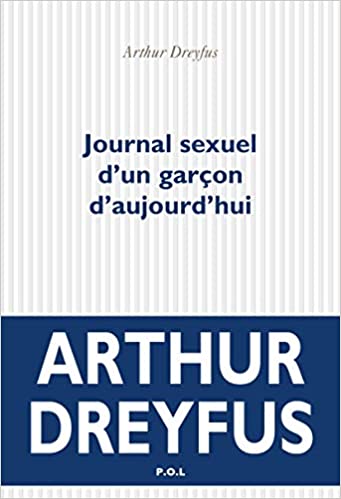
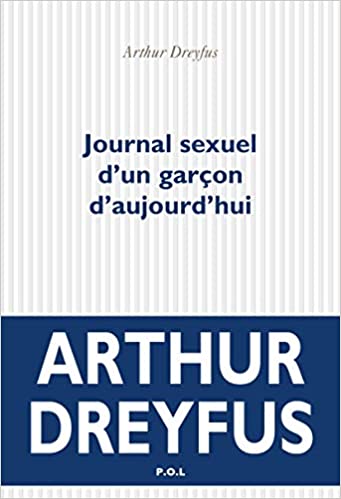
Dans ce dernier, Arthur Dreyfus parle surtout de ses nombreux plans cul. Et, pour ceux qu’ils partagent avec des hommes asiatiques, on peut lire ces mots : « son corps est splendide : trait pour trait celui d’un samouraï dans les films d’action de Bruce Lee […] visage de manga » ou encore « son couvercle ne se dévisse pas — je pense il est asiatique, il est malin, il va trouver ».
Quant aux hommes arabes, il raconte aussi qu’un « lascar à capuche » lui envoie « une photo de sa bite — qui est minuscule. Par esprit civique, craignant d’engendrer un djihadiste frustré, je réponds aussitôt : Ouah trop belle bébé ! »
Tout ceci est accompagné de quelques autres expressions fétichisantes, notamment des références aux « noirs à la bite énorme ».
Bref, je n’avais pas envie de le lire et après ces découvertes, j’en avais encore moins envie mais j’étais furieux.
Car cet ouvrage est autobiographique si bien qu’ici, personne ne pourra agiter sous notre nez la sainte licence artistique, l’auteur confessant au JDD que : « Ce livre n’est pas une autofiction, c’est un livre de vérité. »
Alors je me suis dit qu’il fallait bien que j’écrive là-dessus, qu’on en parle. Parce qu’on a encore édité ces mots, parce qu’on les a encore utilisés comme si de rien n’était, parce que des années après Dustan (car Dreyfus, d’après Libération, le cite très fréquemment) et compères, certains mecs continuent de penser qu’ils peuvent déshumaniser les personnes racisées avec qui ils couchent. Et les écrivains d’avant, eux, avaient peut-être l’excuse de la fameuse « autre époque ». Qu’on publie ça aujourd’hui, je trouve ça aberrant.
Mais dans mon agacement, je me suis ainsi heurté à la question suivante. Allais-je devoir lire 2294 pages de cet homme pour parler de ces extraits ? Puis-je être en colère contre un texte dont je n’ai lu que des morceaux ?
Car en me mettant à mon clavier, je me suis dit qu’on allait forcément hurler l’heure du tribunal populaire, de la grande « cancel culture ». Et je me suis rappelé qu’en fait, ça a toujours existé. Des critiques artistiques, il y en a toujours eu et on s’est toujours basé là-dessus pour savoir ce qu’on avait envie de lire, ou non. Et je pourrais disserter aussi bien sur le caractère raciste des expressions utilisées que de leur platitude stylistique.
La question que je me suis posée était surtout celle-ci : pourquoi je m’infligerais cela ? Pourquoi je me forcerais à entrer dans la tête de quelqu’un au dépend du bien-être de mon propre esprit ? Pourquoi m’intéresser à ces œuvres, là où des individus de ce genre ne le feront jamais pour nous ? Pourquoi me réimposer de la douleur afin d’expliquer la mienne, que je connais si bien pour la vivre en tant qu’homme asiatique, pour montrer patte blanche à un discours qui, de toute façon, peu importe le contexte, me nuit et nuit collectivement aux personnes racisées.
Politiquement, s’infliger de tels textes, c’est pour moi leur donner de la puissance. S’en imposer la lecture, espérer relever une vision humaine de nous, c’est déjà leur accorder une importance plus grande que notre bien-être personnel et notre dignité. Je refuse désormais de brader l’opinion que j’ai de moi-même et de mes pairs pour passer du temps à analyser celle des hommes qui nous considèrent comme seuls aliments de leurs machines à fantasmes. Mon indulgence et ma patience s’arrête là où leur ignorance devient une violence aveugle.
Et bien que j’ai réfléchi à tout ça, dans ma colère, j’ai aussi culpabilisé. J’ai aussi voulu croire que ça allait s’expliquer. Alors j’ai décidé d’au moins juger l’écrivain. Par ses discours, par ses apparitions dans les médias. Je sépare l’œuvre de l’auteur, en somme, pour faire plaisir à tous ceux qui l’exigent, même si je considère que c’est impossible.
Arthur Dreyfus, lorsqu’il s’agit de s’expliquer sur la déshumanisation littéraire de ses amants racisés, se défend donc ainsi : « Ce qu’on appelle “essentialisation” fait partie intégrante du désir. Les Arabes et les Noirs qui baisent des petits-bourgeois blancs essentialisent aussi un fantasme inversé. »
Ce discours, je le connais assez bien, je l’ai entendu maintes et maintes fois dans ma vie intime. Ce que je réponds, c’est que l’essentialisation fait partie de « leurs » désirs, pas forcément du nôtre. Les fantasmes exotisants qu’ils projettent sur nous ne sont pas aussi bénins que ceux que nous partageons tous en tant qu’individus, qui eux s’inscrivent dans le cadre du fantasme sexuel consenti (domination, BDSM, jeux de rôles…).
Je peux accepter et concevoir que le fétichisme racial est un effet de notre société et que les hommes n’y sont pour rien s’ils en ont. Mais le territoire des désirs est un univers d’absolution où leurs fantasmes raciaux sont constamment pardonnés, là où les nôtres ne sont pas discutés, généralement parce qu’ils sont beaucoup moins puissants voire inexistants chez beaucoup d’entre nous (moi y compris). Le fait que les personnes blanches forment la grande majorité des personnes ayant des fantasmes basés sur l’ethnie n’est pas anodin. Et qu’ils soient les seuls à pouvoir les publier montre bien une domination évidente qu’Arthur Dreyfus n’a pas le droit de mettre sous le tapis. Pour mettre en parallèle deux choses, il faut qu’elles soient un minimum égales, sinon, ça n’a aucune valeur.
Et puis il y a des choses, peu importe le contexte, où les propos d’Arthur Dreyfus sont graves, bien plus graves que tout ce que je viens de raconter. On apprend ainsi dans son livre qu’il a couché avec des adolescents de seize à dix-sept ans, alors que lui est âgé de trente-quatre ans aujourd’hui. Toujours au Journal du dimanche, il répond : « Sur l’âge, je ne suis pas allé chasser mes partenaires à la sortie des lycées ; tout se passe sur Grindr, les rencontres sont sollicitées des deux côtés. »
Chez Pariscilaculture, à propos d’autres textes, le journal l’interroge sur des personnages homosexuels de ses écrits qui désirent souvent des jeunes enfants.
Il explique que selon lui, « On n’écrit pas pour avoir peur ou non du public. Tout ce qui réside dans un livre échappe à la vie. »
Quelle belle façon d’user de cette impunité que le patriarcat a construit aux hommes artistes. Quelle pernicieuse et paradoxale façon de s’en sortir par une œuvre qu’on élève à la fois comme vérité et comme échappée à la réalité.
Et pour finir, le détail qui mets la puce à l’oreille, chez L’Obs, on informe le lecteur qu’Arthur Dreyfus, dans son livre, cite Matzneff dans son roman autobiographique.
Dans le JDD, l’écrivain trentenaire finit par dire : « De toute façon, si j’ai fait œuvre de tout cela, c’est par besoin de convertir cette part ignoble des tréfonds en matière noble. Aujourd’hui, j’aimerais qu’on voit l’écrivain avant le monstre. Que l’objet littéraire prenne le dessus. »
J’ai la profonde conviction que lorsqu’on est artiste, on a une responsabilité vis-à-vis de ceux qui n’écrivent pas. Car la littérature, quand on s’inspire des gens qui nous entourent, c’est les déposséder un peu de ce qu’ils sont pour en faire notre création.
Qui sont ces hommes dont on a capturé une part de leurs sexualités sans leur demander leurs avis ? Ils n’ont pas le droit de répondre, parce que beaucoup n’ont pas la même puissance politique et médiatique. Ou tout simplement pire : parce que certains étaient mineurs. Étaler sur 2294 pages ses désirs sans considérer la réception des personnes concernées, c’est les déposséder d’une expérience dont ils sont aussi auteurs. Se cacher derrière la sainteté du désir, du fantasme, qu’il ne faudrait surtout pas remettre en question, est un argument intellectuellement pauvre et moralement discutable. Car cette sainteté n’est offerte qu’à la sexualité des hommes blancs de pouvoir. Les autres, eux, n’ont jamais l’occasion de prétendre que leur sexualité est une force à ne surtout pas contraindre, à ne surtout pas interroger. La considérer en plus comme publiable sous forme d’un kilo cinq de papier montre bien une chose : votre liberté de raconter vos « parts ignobles » est bien plus grande que la dignité des autres.
Et c’est pourquoi nous, nous utilisons notre liberté de nous élever contre cela et de refuser de les lire.

