En 2010, alors que j’étais étudiant en histoire du cinéma, j’ai terminé un mémoire de recherche portant les représentations du VIH/Sida au cinéma. Ce sujet soigneusement choisi ne m’a plus quitté, présent dans l’ensemble des projets dans lesquels je me suis investi depuis, en lien avec le cinéma ou ailleurs. Au printemps dernier, j’étais donc curieux d’apprendre que Didier Roth-Bettoni s’apprêtait à publier son nouvel ouvrage, Les années sida à l’écran[i].
Proposant une méthodologie différente de la mienne, je me réjouissais à l’idée de découvrir une nouvelle perspective sur un corpus qui m’était familier. Au cours de la lecture, je m’aperçus que l’ouvrage m’apportait quelque chose de plus inattendu encore : la typologie qu’il mettait en place me permettait d’identifier la colère que m’avait inspiré, lorsque je le découvrais en juillet dernier, le grand prix du dernier festival de Cannes, 120 Battements par minutes.
Dans cet ouvrage, les films traitant du VIH/Sida chez les hommes homosexuels sont regroupés en grandes familles correspondant à leur contexte de production et de diffusion, aux publics auxquels ils seraient adressés et à la fonction qu’ils auraient assurée pour ce public. Intuitivement, c’est dans l’une des dernières catégories, celle des films dits « militants », que j’aurais classé 120 battements par minutes. Un film sur l’association de lutte contre le Sida ACT UP-Paris et dont le récit prend place lors d’une de ses époques les plus intenses semblait ne pas pouvoir échapper à une certaine forme d’engagement.


Le deuil et l’empathie
Pourtant, dès les débuts de l’ouvrage, je fus frappé de m’apercevoir que ce n’était pas le cas. Le premier chapitre se consacre aux films qui racontent les débuts de l’épidémie et 120 battements par minutes partage beaucoup avec ceux-ci. A travers les exemples d’An early frost (John Erman, 1985), Longtime Companion (Norman René, 1990), And the band played on (Roger Spottiswoode, 1993), The Normal Heart (Ryan Murphy, 2014) ou Les Témoins (André Techiné, 2007), Didier Roth-Bettoni commence par exposer le contexte de l’arrivée de l’épidémie et de son développement, avant de parcourir les différentes dynamiques en jeu dans son évolution. Ces films sont décrits comme assurant la diffusion de la synthèse des savoirs acquis sur l’épidémie auprès d’un large public et prenant parfois en charge d’autres fonctions, telles que celles du deuil et de l’empathie.
À la lecture de ce chapitre, je comprenais pourquoi ma colère envers le film 120 Battement par minute me mettait aussi mal à l’aise : l’une des fonctions du film, celle du deuil, est directement adressée à des personnes que j’admire et que, pour certaines, j’ai la chance de côtoyer, les ancien.ne.s et actuel.le.s militant.e.s d’ACT UP-Paris qui ont connu cette époque. Sans aucun doute, le film constitue une occasion de rendre hommage aux luttes menées à l’époque et aux personnes qui les ont portées, et par extension à celles et ceux qui ont vécu de près la violence de ces années. À ce niveau, le film leur semble adressé, sans ambigüité et à juste titre – sans même parler de l’importance qu’il peut représenter pour ses auteurs, appartenant eux-mêmes à ce groupe. Je redoutais donc que l’expression de mes réserves ou d’une opinion critique ne soit un affront à ces personnes que je respecte pour leurs accomplissements, que j’apprécie tant pour celles que je connais personnellement et dont certaines sont mêmes des amies.
Il me semblait aussi délicat d’être critique envers une œuvre qui parvenait à partager avec un large public une synthèse du rôle essentiel joué par ACT UP-Paris dans la lutte contre l’épidémie, celle-ci fût elle subjective, comme ne manque pas de le préciser son réalisateur. Même si ma maigre connaissance de la période, forgée à partir de la lecture de récits – eux aussi subjectifs – de certain.e.s militant.e.s[ii] s’est parfois trouvée en désaccord avec le récit du film, il ne s’agira pas ici de critiquer les partis pris quant à sa subjectivité. Et si, dans un récent article, le chercheur en cinéma David Faroult faisait toutefois la remarque que bien qu’ « un film de fiction n’est pas comptable des libertés qu’il prend avec l’histoire, ses écarts vis-à-vis des faits connus ou établis sont, au moins, interprétables »[iii], un travail de cette nature pourrait être mené par d’autres personnes que moi, bien plus légitimes pour porter ces débats. Je pense surtout que le retard qu’a pris la France dans l’initiation d’une discussion à propos de son histoire avec l’épidémie et l’ignorance des enjeux politiques qu’elle a soulevés[iv] sont trop considérables pour faire de ces points un débat général. Il me semblait ici encore compliqué d’émettre des réserves face au film qui permettait enfin d’engager cette réflexion.


C’est la dernière fonction de ces films telle qu’elle est définie par Didier Roth-Bettoni qui suscite un malaise chez moi : l’empathie et la compassion. Il définit longuement en quoi les films de cette typologie permettaient au public non directement en lien avec l’épidémie d’en prendre conscience à travers l’émotion que permet la fiction et ses personnages « universels » aux émotions desquels tout le monde pouvaient s’identifier[v]. L’exemple central de la démonstration sera An Early frost dont l’objectif sera de permettre au spectateur « universel » non directement exposé (entendre blanc, de classe moyenne et surtout hétérosexuel) de s’identifier à travers l’expérience du personnage d’une mère blanche, de classe moyenne et hétérosexuelle.
Pourquoi tant de larmes ?
De façon quasi unanime, les spectateur.ice.s de 120 Battements par minute à qui j’ai eu l’occasion de poser la question[vi] ont pleuré pendant le film. La structure du récit et les outils dramatiques et techniques choisis (traitement du son, par le silence et la musique, longues scènes dédiées à la mort d’un personnage attachant) qui produisent cette émotion sont plus parlant que les larmes elles-mêmes. Ils montrent que le film permet à tous les publics d’entrer dans le champ de la compassion, cette fois à travers l’expérience du personnage d’un nouveau militant qui découvre ACT UP-Paris.
Mon intérêt ne se portera pas sur les larmes des personnes qui revivent pendant le film des moments de leur histoire, celles qui ont à voir avec le deuil évoqué précédemment. Je n’interrogerai pas non plus les larmes de ces jeunes – militant.e.s mais pas seulement – tant évoqué.e.s dans les interviews et qui, tenu.e.s à l’écart de cette histoire qui ne leur a jamais été racontée, découvrent la réalité d’une épidémie qui leur est toujours apparue comme lointaine et révolue alors que le film la conjugue enfin dans un passé simple qui se confond avec le présent.
Les larmes qui m’importent ici sont celles des autres, des personnes qui ne sont plus assez jeunes pour penser ces années comme une histoire antérieure à leur existence et qui semblent quand même découvrir les réalités de l’épidémie, sa violence humaine, sa nature politique et l’importance du travail mené par ACT UP-Paris. Comment est-il possible que l’empathie de ces personnes ne soit sollicitée qu’aujourd’hui, que ces larmes soient les premières versées et que leur admiration pour ces militant.e.s dans les colonnes de la presse et dans les palmarès des festivals ne se soit pas exprimée plus tôt ? Je vais faire ici l’hypothèse que ce public faisait à l’époque partie de ceux qui laissaient mourir les personnages qu’ils pleurent aujourd’hui au cinéma.
Pour ma part, je me suis accroché à ma colère envers le film pour ne pas verser à nouveau les larmes que j’ai tant pleurées alors que j’écrivais mon mémoire, en 2010. Intitulé Analyse politique des représentations filmiques du Sida, je m’intéressais alors à un corpus non exhaustif de films produits en occident entre 1985 et 1996 (l’arrivée des trithérapies qui, comme l’explique très clairement Didier Roth-Bettoni, modifie les modalités de récits). Je posais une question unique à ces films, une qui me travaillait aussi comme cinéaste : comment les représentations filmiques étaient-elle capables de rendre compte des réalités politiques et idéologiques de l’épidémie de sida ? Cet humble travail de maîtrise, que je relis aujourd’hui conscient de ses imprécisions, avait comme projet d’envisager ces films depuis les questions conjoncturelles qui se posaient à leur auteur au moment de leur création.
Cette conjoncture étaient envisagée selon trois axes : celui du contexte idéologique dans lequel était arrivée l’épidémie, l’évolution du rapport aux corps dans les images de l’épidémie et celle de la prise en charge par les films du rapport de force entre les personnes engagées contre l’épidémie et les institutions de pouvoir.
La source des émotions qui me gagnaient alors était multiple. Sans aucun doute, j’étais ému à l’idée de personnes (jeunes et pédés comme moi, mais aussi enfants hémophiles, femmes noires, héroïnomanes, travailleuses du sexe, artistes, parents, etc.) condamnées à mourir si tôt. Je partageais la colère des militant.e.s face à la lenteur d’institutions qui n’avaient pas pris la mesure de l’urgence de l’épidémie et s’étaient trop longtemps attardées à défendre leurs propres intérêts, que leurs motivations soient électorales, économiques ou idéologiques. Mais j’étais surtout fortement bouleversé par ces artistes et intellectuel.le.s qui évoluaient dans cette tempête et qui parvenaient à cerner et représenter dans leurs œuvres les enjeux structurant leur présent.
Représenter l’ennemi
Parmi eux, Douglas Crimp et son texte fondateur, celui du numéro de la revue October intitulé « AIDS: Cultural Activism / Cultural Analysis »[vii] dans lequel il définit l’épidémie de VIH/Sida comme une crise de représentation, tant la nature du virus, de ses modes de transmission et de ses implications politiques étaient multiples et complexes. C’est autour de cette observation qu’ont émergées beaucoup des productions militantes, théoriques et artistiques, comme le développe de façon éblouissante l’ouvrage Ce que le sida m’a fait d’Elisabeth Lebovici[viii]. Parmi ceux-ci, la création d’ACT UP à New York, en amont du collectif parisien, mais aussi celui de Queer Nation, auteur entre autres de History is a Weapon – The Queer Nation Manifesto.
Dans ce manifeste, on peut lire cette phrase : « Les hétéros sont l’ennemi. Ils sont l’ennemi quand ils ne tiennent pas compte de notre invisibilité et continuent à vivre dans une culture qui nous tue. Chaque jour l’un d’entre nous est pris par l’ennemi. Que ce soit une mort du sida due à l’inaction du gouvernement […] [ix]» Cette phrase fait référence à une conscience accrue, dans cette période, de l’identité des ennemis des séropositifs dans la lutte contre une épidémie explicitement politique[x]. On retrouve la même énergie dans beaucoup des pensées de l’époque[xi]. Au delà des adversaires de l’époque clairement identifié.e.s (les laboratoires, les élu.e.s et institutions politiques, les représentant.e.s religieux.se.s), ce sont aussi les personnes qui avaient le privilège de pouvoir ignorer l’épidémie qui sont ici désignées.


Voici le cœur de ma colère envers 120 Battements par minute : en ne représentant pas (ou trop peu) ces personnes, le film leur permet non seulement de ne pas avoir à rendre de compte sur leur comportement pendant l’épidémie mais aussi de partager ces larmes et de faire le deuil de morts dont ils sont complices. Où sont, dans le film, les homophobes (ils ne peuvent pas se limiter à l’homophobie ordinaire d’une lycéenne) ? Les élus qui refusaient les campagnes de prévention qu’ACT UP-Paris faisait elle-même ? Où sont les familles qui abandonnaient les leurs ? Assis dans la salle de cinéma, à pleurer[xii]. Les élu.e.s n’ont pas pleuré devant Portrait d’une présidente (Brigitte Tijou, 1995) parce qu’on les y nommait et qu’on voyait leur inaction face à l’épidémie. Les cadres de l’Office National du Sang ne pouvaient pas pleurer devant Facteur VIII (Alain Tasma, 1994) parce que leur responsabilité dans l’affaire du sang contaminé était flagrante. Même les séquences d’homophobie explicite des films comme An Early frost ou Philadelphia devait rester en travers de la gorge de celles et ceux qui avaient tourné le dos à un.e membre de leur famille, un.e collègue, un.e ami.e.
Le seul ennemi présent explicitement dans le film, ce sont les laboratoires. Et même si on les voit présents pour des négociations avec les militant.e.s, on expose clairement leurs motivations capitalistes. Il apparaît clairement qu’ils n’ont pas cédé par bon sens ou par compassion mais bien face à la détermination de celles et ceux qui les tenaient en bras de fer à coup de campagnes de mobilisation, d’action médiatiques coléreuses et désespérées.
Un film militant ?
Mais voici un second nœud à ma colère : si on reprend la classification de Didier Roth-Bettoni des films militants comme des films cherchant à « construire un discours cinématographique rageur qui soit un prolongement (voire un dépassement) des luttes politiques et sociales portées par les associations les plus en pointe dans ce corps-à-corps avec le virus. »[xiii], 120 battements par minute n’est pas un film militant. J’aurai voulu d’un film sur ACT UP-Paris qu’il le soit.
D’ailleurs, quand la rumeur se répand dans Paris que le film est en préparation, au printemps 2016, c’est ce qu’il nous est permis d’espérer. Ma toute première rencontre avec le film s’est fait alors qu’une des chargées de casting m’a reçue chez elle après m’avoir contacté par téléphone. Elle avait trouvé mon contact par un système de réseau, en raison de ma participation passée au groupe transpédégouine Les Panthères roses. Elle m’expliquait alors que, selon la demande du réalisateur, elle procédait à un « casting sauvage » (j’apprécie maintenant le choix de l’expression) dans l’idée de recruter des militant.e.s pour le film.
Je ne comprendrai que devant le film que cette recherche était probablement poussée par des envies de réalisme, ce qui explique que le casting soit finalement majoritairement occupé par des acteur.ice.s professionnels, des personnes dont c’est le métier. J’en ai peut-être eu l’envie ou l’espoir, mais je n’ai jamais eu la prétention de savoir jouer comme les professionnel.le.s. D’ailleurs, ma déception dépassait le fait de ne pas avoir été retenu et sa source s’est confirmée à la vision du film : j’avais espéré que leur volonté de faire intervenir des militant.e.s d’aujourd’hui correspondait à une intention d’inscrire le film dans les luttes contemporaines, comme l’aurait fait un film militant.
Mais bien au contraire, le film installé dans le passé ne fait aucun lien avec le présent politique. Le meilleur exemple reste pour moi, précisément, celui de la question des laboratoires. Lors de la sortie du premier extrait, à quelques jours de la première cannoise, je me souviens très bien chercher sans succès quel affrontement s’était joué entre ACT UP-Paris et Melton Pharm, pour finalement comprendre que ce laboratoire est fictif. Toutes les personnes, sans exception, à qui j’ai exposé ce fait ont pris la défense du film en présentant des arguments juridiques et le risque d’attaque en diffamation. J’aurai aimé entendre, autour du film, l’équipe raconter qu’ils auraient aimé utiliser les noms des vrais laboratoires comme ils ont nommé ACT UP-Paris.


J’aurai aimé entendre que Gilead était déjà un ennemi à cette époque, et qui l’est encore aujourd’hui. Ironie de l’actualité, quelques semaines après la première mondiale du film à Cannes, la version contemporaine d’ACT UP-Paris bloquait le char de Gilead à la Marche des Fiertés LGBT de Paris. Voilà le cinéma dont je suis curieux : celui qui penserait cette période historique et le présent en tension. Celui qui permettrait une discussion sur les politiques du VIH/Sida aujourd’hui, sur cette épidémie qui continue, sur les populations les plus exposées à de nouvelles contaminations, sur l’état des dynamiques internationales, les moyens de lutte, les obstacles à la prévention.
Les autres corps
Je suis curieux de voir un film avec les corps des militant.e.s d’aujourd’hui, aussi parce que la majorité de celles et ceux que je connais parmi les personnes qui ont été auditionnées ont des corps qui ne correspondent ni au casting définitif, ni à la réalité historique (dont l’importance semble, finalement, être à géométrie variable). Ces personnes sont racisées ou trans. Là où ces corps sont dans le film relégués au rang de caution (ou, comme le disent les anglophones, de token), une femme trans, un homme noir, un homme arabe, quel aurait été l’impact visuel de voir les réunions hebdomadaires d’ACT UP-Paris peuplées de ces corps qui sont politiquement en danger aujourd’hui ?
Tout comme les corps affectés par les VIH/Sida à l’époque, ces corps sont aujourd’hui en crise de représentation, en témoignent les différents débats, controverses, recherches autour de la visibilité des personnes trans et racisées au cinéma. J’avais envie d’espérer que ce film sur ACT UP-Paris serait engagé y compris dans le champ des représentations. Heureusement, comme le disait Bams au moment de la controverse sur Exhibit B, les personnes noires ont toujours su se projeter dans les récits des blancs, dans les récits des autres, et il semble que 120 Battements par minute trouve un écho dans tous les milieux militants (je n’en espère pas moins). Mais elle ajoutait aussi qu’il serait temps que les blancs apprennent à se projeter dans les nôtres.[xiv]
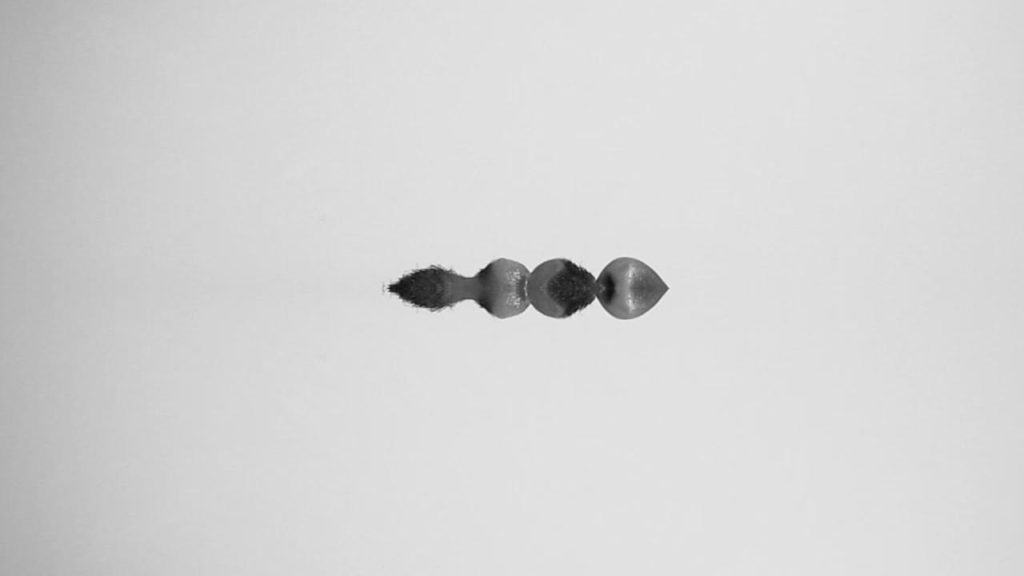
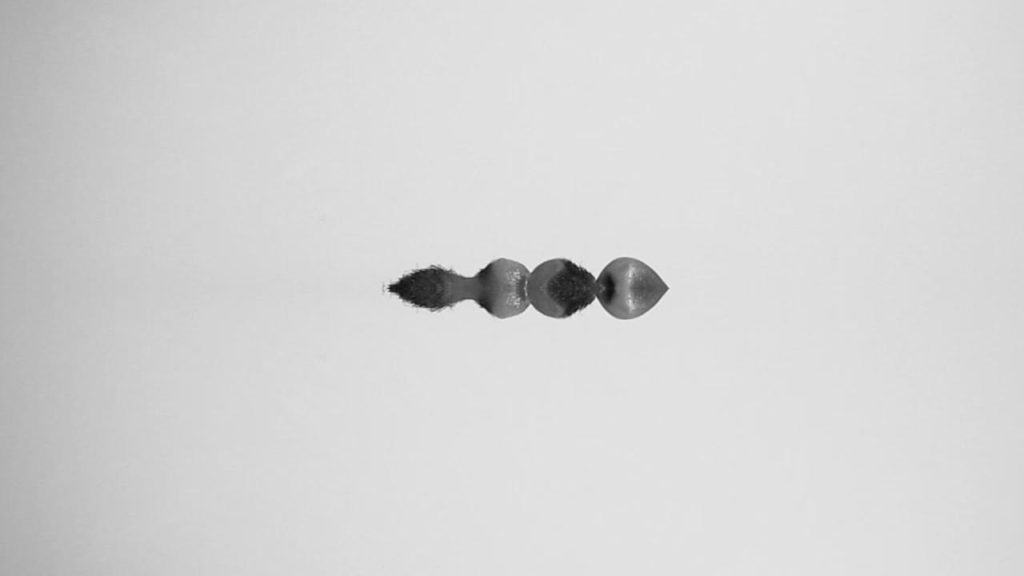
Pour conclure, je préfère m’essayer à une analyse antiraciste du rapport du film au présent. Quand je pense en ce moment aux corps qui meurent dans l’indifférence, à la faveur d’un régime discriminatoire, orchestré par les pouvoirs en place, produisant des richesses pour les entreprises et en dépit de l’information du grand public, c’est vers les réfugié.e.s que mon engagement se tourne. Aujourd’hui, des entreprises françaises s’enrichissent de la production de dispositifs anti migration. Aujourd’hui, on met en place des procédures nouvelles qui rendent irréalisable les demandes d’asile. Aujourd’hui, les médias représentent la crise des réfugié.e.s comme un problème insurmontable et donnent trop peu la parole aux premières personnes concernées.
Aujourd’hui, ces personnes meurent aux frontières ou dans les rues et personne ne semble s’en émouvoir, comme si ces corps ne méritaient pas qu’on les pleure. Un peu comme on ne méritait pas de pleurer les homosexuels mourant du Sida ? Comme on n’autorise pas à pleurer les mort.e.s de violences policières ? Quand je vois 120 Battements par minute, le sang qui remplit la Seine, c’est encore celui du corps des Algériens qu’on y a noyé le 17 octobre 1961. Quand j’entends Robin Campillo dire que son film est un film indigène[xviii] et citer les Indigènes de la République[xix], je regrette que le rapprochement se limite à l’opposition rencontrée par les deux groupes et aimerais que l’ancien militant d’ACT UP-Paris qu’il est profite de l’espace de parole qui lui est donné dans le cadre de la promotion du film pour se risquer à une analyse plus explicite des liens avec les mouvements décoloniaux.
J’ai envie qu’il soit répété ce qui est si justement écrit dans Une colère noire de Ta-Nehisi Coates : que nous vivons dans un monde dont l’idéologie de la blanchité qu’il appelle le Rêve « pèse sur notre dos, repose sur le lit de nos corps » et où le racisme « détruit les cerveaux, empêche de respirer, déchire des muscles, éviscère des organes, fend des os, brise des dents », où il se demande « comment vivre avec un corps noir dans un pays perdu dans le Rêve ? »[xx]
Il y a beaucoup de slogans d’ACT UP-Paris qui m’ont marqués, et ils me reviennent régulièrement : « J’irai danser quand même », « j’ai envie que tu vives », « Action = vie ». Mais aujourd’hui, il en est un qui me revient sans arrêt à l’esprit : « Que cesse cette hécatombe. »
120 battements par minute m’a mis en colère après m’avoir d’abord déçu. J’étais déçu dès l’annonce de sa sélection à Cannes parce qu’on sait déjà qu’un film qui reçoit une telle validation de l’industrie ne peut pas tenir les engagements posés par un groupe comme ACT UP-Paris. Je suis déçu que son succès en salle et que la visibilité du film ne soit pas l’occasion d’une discussion politique plus large sur le VIH/Sida mais aussi sur les droits des personnes trans, les prisons, les réfugié.e.s, la santé des femmes, le racisme, le travail sexuel, la santé et le capitalisme, les drogues, les rapports Nord-Sud, ces sujets pour lesquels l’épidémie interprète le rôle du révélateur dans un film dont la fin reste à écrire.
Stéphane Gérard, cinéaste
***
[i] Les années sida à l’écran, Didier Roth-Bettoni, 2016, Ed. Eros Onyx.
[ii] Principalement à partir des récits de celles et ceux qui sont encore vivant.e.s, même si je ne peux m’empêcher de m’interroger sur les perspectives qui auraient été choisies par les militant.e.s qui ne le sont plus.
[iii] David Faroult, « De la fiction à la falsification », 30 août 2017, Débordements. http://www.debordements.fr/De-la-fiction-a-la-falsification
[iv] L’un des point souvent soulevé à l’occasion de la sortie du film est l’absence d’archives LGBT permettant de préserver et valoriser de manière adéquate les fonds relatifs à cette communauté et de générer des recherches en vue de l’écriture de cette histoire. Au cours de mes études, c’est cette démarche qui m’a mené à participer à la sauvegarde au sein des archives de la Bibliothèque nationale de France, du Journal Annales de Lionel Soukaz, qui contient des passages où apparaît ce qu’était ACT UP-Paris à l’époque du film. Un chapitre leur est consacré dans le livre Ce que le sida m’a fait d’Elisabeth Lebovici.
[v] « Ce dispositif traditionnel de tant de mélodrames va s’avérer ici particulièrement opérant, forçant les spectateurs à l’identification à ces gens qui leur ressemblent et dont les problèmes, ces problèmes inimaginables que sont l’homosexualité et la séropositivité pour les gens « normaux » qui regardent la télévision, pourraient donc potentiellement être les leurs. » p. 48.
[vi] Cette observation est purement empirique auprès des personnes de mon entourage plus ou moins proche qui ont vu le film. Je ne fais pas de sociologie de la réception et ne prétend pas que cette remarque ait une valeur scientifique.
[vii] Douglas Crimp, « AIDS: Cultural Analysis / Cultural Activism » dans October, vol. 43 (hiver 1987), p. 3-16.
[viii] Elisabeth Lebovici, Ce que le sida m’a fait, 2017, Ed. JRP Ringier.
[ix] « It is easier to fight when you know who your enemy is. Straight people are you enemy. They are your enemy when they don’t acknowledge your invisibility and continue to live in and contribute to a culture that kills you. Every day one of us is taken by the enemy. Whether it is an AIDS death due to homophobic government inaction or a lesbian bashing in an all-night diner (in a supposedly lesbian neighborhood), we are being systematically picked off and we will continue to be wiped out unless we realize that if they take one of us they must take all of us. »
[x] La référence historique principale de ma recherche de master était l’ouvrage de Patrice Pinell (dir.) et Christophe Broqua (dir.) Une épidémie politique, 2002, Presse Universitaires de France.
[xi] Dans le cadre de mon mémoire, je traduisais par exemple cet extrait du Discours à Albany de Vito Russo filmé par DIVA TV en 1989 : « Ces trois dernières années, depuis que j’ai été diagnostique, ma famille pense deux choses a propos de ma situation : un, ils pensent que je vais mourir et deux, ils pensent que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour l’empêcher. Et ils ont faux sur les deux tableaux. Alors, si je meurs de quelque chose, je meurs à cause de l’homophobie. Si je meurs de quelque chose, je meurs à cause du racisme. Si je meurs de quelque chose, c’est de l’indifférence et de la bureaucratie car ces facteurs font obstacle à la fin de cette crise. Si je meurs de quelque chose, je meurs à cause de Jesse Helms. Si je meurs de quelque chose, je meurs à cause Président des Etats-Unis. Et particulièrement, si je meurs de quelque chose, je meurs à cause du sensationnalisme des journaux et des magazines et des émissions de télévision qui ne s’intéressent à moi pour des témoignages qu’a condition que je veuille être une victime désespérée et pas quand je me bats pour ma vie. Si je meurs de quelque chose, je meurs du fait que pas assez d’hommes riches blancs et hétérosexuels n’aient attrapé le sida pour que qui que ce soit s’en inquiète.»
[xii] Les récits de résistance semblent toujours occuper la mémoire collective des guerres, comme il semble plus confortable de s’imaginer de ce côté que de celui des collaborateurs. A ce titre, ce choix de récit pour raconter la guerre contre l’épidémie de Sida s’inscrit sans peine dans un récit national plus vaste qui va de la révolution au maquis.
[xiii] Et il continue : « De Rosa von Praunheim à Gregg Araki, de Derek Jarman au duo Olivier Ducastel-Jacques Martineau, en passant bien entendu par John Greyson, ces cinéastes font le choix de films de combat plus que de réconfort. » p. 79.
[xiv] Citation extraite de l’enregistrement d’un débat organisé en décembre 2014 figurant dans le film La Machine avalée (http://gstphn.net/la-machine-avalee/)
[xv] Villanelle est un court-métrage du réalisateur américain Hayat Hyatt dans lequel il s’intéresse aux impacts intergénérationnels de l’épidémie de Sida chez les hommes gays noirs de New York. Programmé en 2017 par le collectif What’s Your Flavor?, il est distribué par le Collectif Jeune Cinéma.
[xvi] Discours de Giovanna Rincon à la conférence 2017 de l’International Aids Society : https://www.facebook.com/HCAILLC/videos/709709842551465/
[xvii] 21 octobre 2017, 14h.
[xviii] Interview Les années sida à l’écran, dans Les Grandes tables de l’écran, autour de 21 minutes.
[xix] « Act Up était très minoritaire. On nous a accusés de communautarisme, de vouloir rester entre nous – pas toujours à tort d’ailleurs –, voire de fascisme. On était considérés comme infréquentables. A ce titre, je ne pense pas qu’on puisse comparer Act Up à quoi que ce soit. Sauf peut-être aux Indigènes de la République. » – Robin Campillo : « Il m’a fallu du temps pour parler du sida », propos recueillis par Isabelle Regnier, Le Monde, 22 août 2017.
[xx] Ta-Nehisi Coates, Une Colère noire (titre original : Between the World and Me), 2015, Ed. J’ai Lu, p. 28-30.

