A l’occasion des Ateliers-Débats pour la création d’un centre d’archives LGBTQI ayant eu lieu à Paris les 4 et 5 mai, nous publions les interventions et tribunes de plusieurs participant·es à ces journées, parmi lesquel·les Sam Bourcier, Renaud Chantraine et Paola Bacchetta.

Archives = vie
Le pouls de l’archive, c’est en nous qu’il bat.
Sam Bourcier, sociologue, université de Lille, membre du collectif Archives LGBTQI
Un film qui pulse sur Act-Up. 120 battements. Et boum. Soudain tout le monde trouve légitime ces histoires d’archives. C’est oublier que les premiers concerné.e.s y pensaient très fort dès les années 80 et que la fièvre des archives a connu une forte poussée en 2002-2003 avec le projet Le Bitoux, l’épisode Delanoé et la mobilisation de Vigitrans, Loppataq et Archilesb. Ce qui a changé depuis, ce qui se passe en 2018, c’est que les institutions, les archives nationales, les archives publiques manifestent un intérêt pour les GL à condition qu’ils aient une tête de mouvement social. Quant à l’intérêt des politiques, la sincérité de leur investissement sur le sujet voisine avec bien d’autres choses : le pink washing, le management de la diversité, le calendrier électoral municipal et une obsession de contrôle universaliste des minorités sexuelles et de genre portée par le PS, la gauche qui ne se refait pas et a déjà planté le projet.
Donc tout n’est pas rose. Il y a du noir dans le rose. Paradoxalement, à un moment où faire archives mobilise, la question de la violence archivale, de la dépossession est centrale. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça à un moment où tout le monde a l’air d’accord pour réduire les silences et les invisibilisations qui sont au cœur des cultures LGBTQI+ ? Parce que toutes les formes de visibilité ne se valent pas. Parce que tout dépend de la forme de présence que nous allons prendre. Parce que l’archive n’est pas synonyme de mémoire, de se tourner vers le passé. Parce que qui dit visibilité dit sélection, interprétation, autorité. Parce que tout dépend du modèle d’archive que l’on se choisit et qu’il y en a qui vous ramènent direct au placard ou dans la tombe alors qu’il y en a qui vous donnent de la force et vous projettent dans le futur. Qui vous permettent de contrer les censures productives, comme dit Foucault, dont les LGBT ont fait l’objet au XIXème, mais aussi d’anticiper celles qu’on nous prépare. Les archives qui sont la vie, c’est back to the future sinon c’est la mort avec ses croque-morts et ses chambres froides.
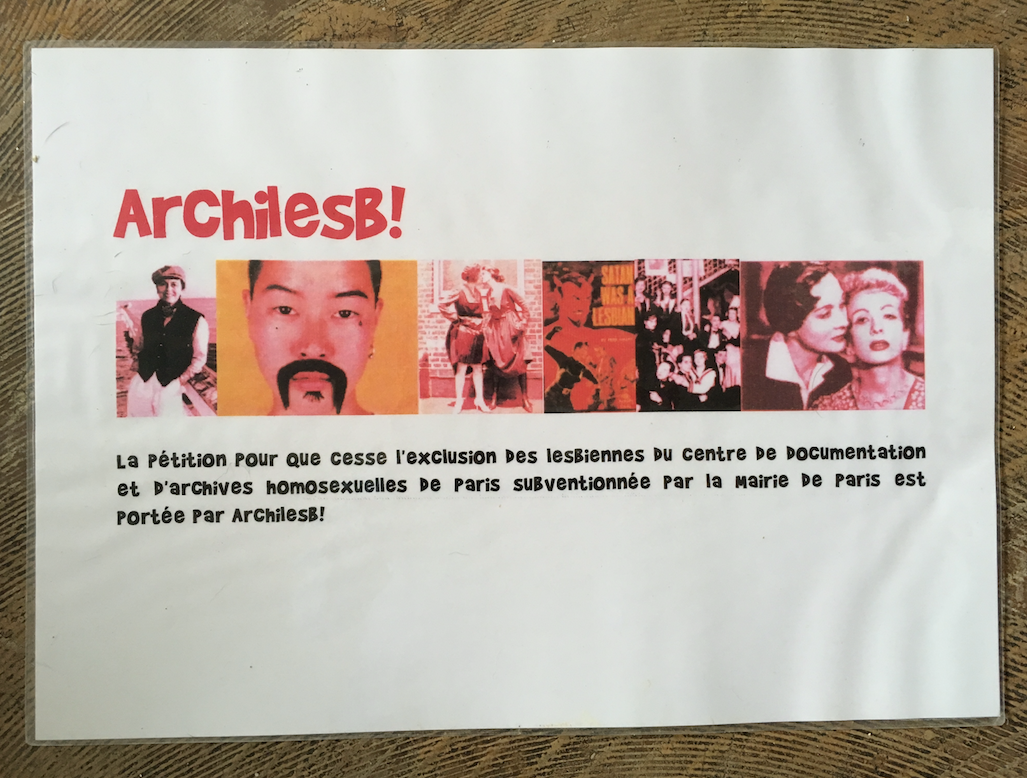
Pour comprendre les enjeux que pose un centre d’archives LGBTQI+ aujourd’hui, la violence archivale, épistémique, administrative que ça déclenche, il faut revenir sur les trois modèles, les trois philosophies de l’archive : le modèle archéologique, le modèle administratif et le modèle productif.
« Les archives qui sont la vie, c’est back to the future sinon c’est la mort avec ses croque-morts et ses chambres froides. »
Le modèle archéologique est le plus connu, le plus classique, le plus imposé. Il tomberait sous le sens. L’archive représente un accès au passé et elle va permettre de reconstituer l’histoire, factuellement, scientifiquement. Avec ce modèle, c’est le temps linéaire de l’existence, biologique, « naturel » qui déclenche l’archive, la rend possible, la légitime. On se pose la question des archives post-mortem, on s’inquiète des ruptures de transmission des archives. Cette conception est très liée à la mort (c’est son côté nécrophile) et elle valorise le passé tout en produisant une injonction, une morale plutôt qu’un plaisir : ce que reflète très bien la notion de « devoir de mémoire ». C’est l’archive de papa.
Le modèle administratif est proche du modèle archéologique. Il s’agit de valoriser le passé, « notre mémoire commune » dans une logique patrimoniale. Il impacte la façon de gérer les archivé.e.s qui deviennent illico des donateurs de leur vivant ou post-mortem. Il régule les opérations de collecte et de tri. C’est le modèle des archives institutionnelles verticalistes. C’est aussi l’archive de papa, du papatrimoine. Il pose le don comme une obligation, avec une codification juridique à la clé et des histoires de propriété, quelquefois de fric. Il favorise la donation/délégation et une dépossession du côté des archivé.e.s. En donnant ses archives comme il faut, on obéit aux archontes, aux experts officiels de l’archive. On délègue à l’état son pouvoir archivistique, personnel et politique.
Le 3ème modèle est celui de l’archive vive, vivante, productive. Il génère une promesse archivale très différente et des archivé.e.s nettement moins passifs. Avec ce modèle, quand on parle archive, on parle futur parce que la promesse est d’intervenir sur la découpe de l’archive là maintenant, en fonction de nos besoins et de notre passé. En fonction de ce que nous savons des invisibilisations et des visibilisations dont nous avons fait l’objet : tout le XIXème siècle et une bonne partie du XXème a visibilisé les inverti.e.s et les homosexuel.le.s, les racisé.e.s à travers le discours médical et le discours juridique pathlogisants et criminalisants. Et ce sont ces archives qui bénéficient d’une survisibilisation dans les archives et les rares expos parisiennes institutionnelles. Et qui font vivre les croque-morts que peuvent aussi être les historiens et les archives institutionnelles a fortiori quand ils/elles sont straight. Ils nous disent : mais de quoi vous plaignez vous ? On a tout ce qu’il faut aux archives nationales. A quoi il nous faut répondre : vous parlez uniquement de l’histoire de la violence. Il y a autre chose à faire que de traquer les traces de la violence et les histoires cachées dans les archives de la police, de la justice, de la psychiatrie, des archives de l’Etat qui avaient pour objectif de nous surveiller, de produire nos identités et les savoirs sur nous. Merci beaucoup.
Ce sont les mêmes qui font l’impasse sur les spécificités des archives LGBTQI+ ou qui n’ont pas pris le tournant patrimonial et archivistique de ses dernières années. Alors bien sûr, il est difficile d’archiver les trous, les silences. Et c’est tout le problème de l’archive des minorités et des sans-voix, des subalternes. Il faut se décoller des archives officielles, « nobles » et se reposer la question de ce qui fait archives et de qui fait l’archive. Car la simple identification de l’archive constitue immédiatement un en-dehors de l’archive avec son cortège d’oppositions discriminantes : important/secondaire, ancien/récent, élitiste/populaire, document/objet, imprimé/oral, monument/document, fait/témoignage, célèbre/anonyme. Et poser de nouvelles questions: comment archiver les sexualités, l’affect…
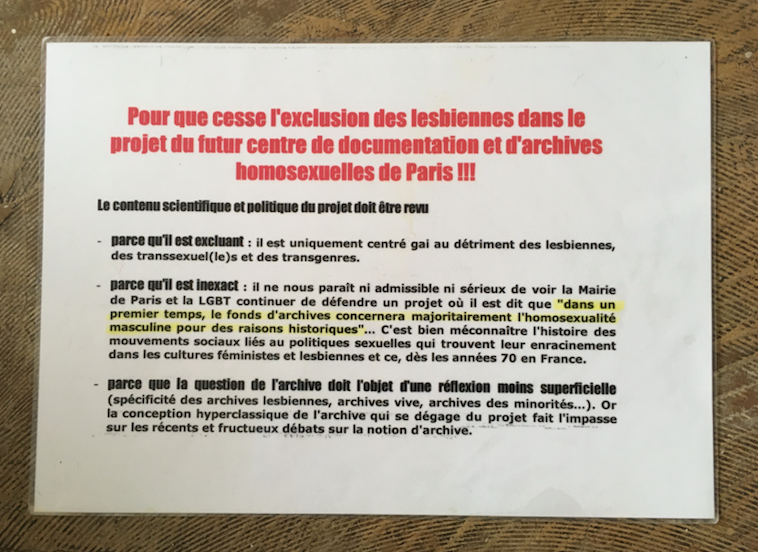
L’archive est toujours incomplète : qu’on ne nous accuse pas avec agacement de ne pas comprendre comme des enfants gâtés que l’on ne peut pas tout garder… Mais cette incomplétude nous appartient. Les opérations que doit subir l’archive pour exister et qui dessine son et notre futur sont masquées ou confisquées par les archontes, les experts attitrés de l’archive, les savants qui nous méprisent. Mais on peut tout à fait y associer et on doit y associer d’autres acteurs. Nous. Nous sommes les archives. Nous sommes des foyers d’archives. Nous sommes les sources diverses et variées des thématiques d’archives que nous souhaitons faire émerger. Nous sommes tous possiblement des archivés archivants. Archivivantes ! Et c’est aussi de cela que l’on veut nous déposséder. Il suffit d’avoir fait un atelier d’archive avec un archiviste professionnel pour se rendre compte de l’empowerment que procurent notre volonté et notre savoir archivistiques.
« Nous sommes tous possiblement des archivés archivants. Archivivantes ! »
Nous savons indexer. En mieux. Nous ne pensons pas que c’est une bonne idée ni respectueux d’envoyer des archivistes straight dans nos maisons ou à l’Académie Gaie et Lesbienne pour choisir trois cartons dignes d’intérêt national. De prendre Act-Up Paris sans les objets mais pas Act-Up Alsace. Les archives, c’est aussi des corps vivants et pas simplement des autorisations de dépôt ou des conventions de dons pour que les archives finissent par terre dans un box où personne ne peut les pratiquer. C’est le fait de déclencher des archives écrites, visuelles sonores, filmées enregistrées pour les mettre en circulation large. Ce n’est pas simplement pour faire de l’histoire orale en complément. C’est pour réduire les zones de silences qui viennent, prévisibles et qui nous sont déjà infligées par les archives institutionnelles et straight. C’est ne pas se laisser déposséder de nos archives et de la manière de les faire. C’est archiver nos communautés, nos cultures et nos formes de vie. C’est admettre que le renversement d’expertise qu’imposent les minorités sexuelles, de genre, racisé.e.s, comme à Act-Up, comme dans la production des savoirs, universitaires compris, se produit aussi pour les archives LGBTQI+. Notre philosophie de l’archive, notre temporalité, notre épistémologie, ce n’est pas celle qui valorise l’archive et les corps trépassés. Act-Up aussi a fait autre chose de la maladie et de la mort.
C’est ça l’archive vive. Celle qui prend en compte le point de vue des archivé.e.s. Celle qui ne produit pas, comme c’est le cas actuellement, une subjectivité d’archivé.e, en dépossédant les personnes et les associations LGBTQI+ des émotions, de la créativité, des savoirs qui sont les leurs pour produire nos archives au moment même où elles sont reconnues. Avec une morale de l’archive pauvre et triste, avec l’inoculation d’un nouveau devoir qui consiste à abandonner ses archives aux gants blancs des archivistes comme si, désormais, les regarder c’était les abimer ou les désintégrer avec nos sales pattes ou comme si les garder, c’était péché… L’archive vive, c’est tout autre chose. C’est de décider collectivement de la découpe de nos archives. De nous autoriser à investir l’incomplétude spécifique des archives LGBTQI+. De dire : archives= vie.
De créer, d’organiser et d’animer l’espace pour produire ensemble les archives dont nous avons besoin. Après le qui, le comment, le où ? On nous dit que les lieux existent déjà et on nous parle de catafalques où règnent la température idéale et des chercheurs encartés. Un box qui coûte 16.000 euros a été loué par la mairie de Paris pour « sauver » « en urgence » quelques archives triées sur le volet. Il est l’allégorie exacte de la mort de nos archives et de la philosophie dépossédante, straight, mortifère, naphatalinesque, catacombesque, congélo qui va avec. Dans Mal d’archive, le petit livre rose et noir de l’archive pour les LGBTQI+, pour décrire la mise en place du dispositif de la violence archivale, Derrida parle de « l’illusion d’un commencement et de l’arrivée du commandement » et d’une assignation à demeure, d’une domiciliation, de la demeure des magistrats supérieurs, les archontes grecs qui commandent et exercent leur pouvoir de consignation ». Ce sont les mêmes qui remettent les archives au placard avec le box fermé à clé, avec les ors des archives institutionnelles à destination des chercheurs et qui refusent que les archives soient prises en main par le collectif des archives LGBTQI. Nous ne nous laisserons pas consigner. Pas d’urgence sans notre fièvre des archives, pas la fièvre-maladie mais la fièvre-désir collective et récurrente. Le pouls de l’archive, c’est en nous qu’il bat.
Sam Bourcier, sociologue, université de Lille, membre du collectif Archives LGBTQI

